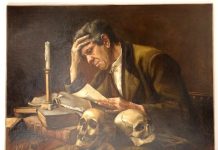J’essaie de ne pas trop parler de ce que je ne connais pas — quoique parfois, je cède à la tentation. Mais il y a des sujets sur lesquels je sais si peu, alors même qu’ils sont primordiaux, qu’il vaut mieux encore s’en remettre aux spécialistes.
La musique, par exemple…
Avant toute chose, disait Verlaine. Il semble bien que les expérimentateurs de Sainte Pédagogie l’aient entendu.
Mais encore ?
J’ai donc demandé à deux éminents (forcément !) enseignants de la chose musicale, Christophe Sibille, bien connu ici, et Emmanuel Protin, non moins notoire, de donner leurs points de vue successifs sur la question.
À chacun, à partir de là, de se faire une idée — et de la donner !
L’ordre des deux textes m’avait paru, au premier abord, aléatoire. Cependant, à force de les relire, je pense que le premier est de l’ordre des (bonnes) intentions, et le second est le choc en retour de la réalité.
Jean-Paul Brighelli
Un mot encore : je voudrais bien sincèrement remercier l’un et l’autre contributeurs, qui ont fait de leur mieux pour être profonds avec légèreté.
Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. » (Frédéric Nietzsche)
Quand notre hôte m’a demandé de participer à la rédaction de cette nouvelle note, je me suis dit : « Pourquoi moi ? Sur ce blog, je suis sans doute celui qui a été successivement le plus insulté, méprisé, ignoré, (mais finalement accepté, apparemment), pour la seule raison que j’avais commis LE crime impardonnable : enseigner dans un IUFM, organisme dont la première mission serait de décérébrer les étudiants et les stagiaires qui s’y inscrivent. Et la deuxième, concomitante, d’en profiter pour faire d’une pierre deux coups en garnissant allègrement le compte en banque des décérébreurs avec l’argent du contribuable, ainsi doublement floué… »
Ce « pourquoi » s’est assez rapidement transformé en un « justement ».
Puis, au cours des réflexions consécutives, j’ai réalisé que la seule chose dont j’étais sûr, c’est que je ne savais à peu près rien, à part que la musique était la discipline la plus difficile à enseigner (1), à l’exception de toutes les autres.
Bon, je sais, c’est un peu facile de paraphraser Socrate et Churchill. Surtout dans la même phrase. Mais un des rares points communs de ces deux grands hommes n’était-il pas de n’avoir pour l’art d’Euterpe qu’une attirance tout à fait limitée (2) ? Contrairement à Nietzsche, par exemple, (à qui je donnerai volontiers raison), pour qui, « sans la musique, la vie serait une erreur ».
Mais, au fait, (pour atterrir en douceur), une petite question:
– Pourquoi les professeurs d’éducation physique et sportive, d’arts plastiques et d’éducation musicale sont-ils souvent si méprisés, alors qu’ils sont les seuls enseignants à avoir suivi un double cursus, à la fois universitaire, et en clubs, en écoles d’arts, en conservatoires?
Puis une autre, que je laisserai en suspens, la livrant à la sagacité des contributeurs à venir :
– Pourquoi s’obstine-t-on à parler de « professeurs d’éducation musicale » et « professeur d’éducation physique et sportive », alors que, dans le même temps, on dit : « professeur d’arts plastiques »?
« L’exemple vient d’en haut », dit-on. Mais quand on voit les références musicales mises en avant par notre président de la République (3), qui ne sont, pour des raisons simples à comprendre, (outre son inculture « inouïe », stricto sensu, à ce niveau de responsabilités), que le reflet de celles d’une frange assez large d’électeurs, on se dit qu’il est urgent, avant tout, de former des auditeurs un peu critiques. Et c’est vraisemblablement le premier rôle des « professeurs d’éducation musicale » que de procurer des chocs esthétiques qui fonderont les bases, en faisant découvrir à nos chères têtes multicolores J .S. Bach, Claudio Monteverdi, John Dowland, Henry Purcell, Johannes Brahms, Louis Armstrong, Miles Davis, Maurice Ravel, Herbie Hancock — cette liste n’étant heureusement pas limitative. Et, en complément, en faisant chanter autre chose que Goldman ou Diam’s, cela va sans dire ! (Malheureusement, la liste n’est pas non plus limitative). Il y a suffisamment de bons auteurs de chansons dans l’histoire ! Et tout professeur de musique digne de ce nom doit pouvoir réaliser des arrangements à trois voix mixtes sur des chansons de son choix ou, à défaut, en choisir de pas trop mauvais.
Et c’est l’autorité qui est la seule garantie potentielle d’obtenir ce résultat. « Faire autorité », par sa culture musicale, (au moins générale, c’est la plus utile) la plus étendue possible pour faire avancer tous les élèves en fonction de leurs connaissances (4), et « avoir de l’autorité », (autorité qui, même si, pour des raisons un peu longues à développer ici, nous en sommes pourvus de manière totalement inégale à la base, peut réellement être développée.) Une autorité digne de ce nom semble en effet indispensable pour pallier les carences éducatives, de plus en plus fréquentes, sans se sentir obligé de devenir « Entrelémurien ». Même si, dans certains établissements, la situation devient tellement difficile qu’on doit être souvent tenté de faire comme Adjani dans « la Journée de la jupe ».
Et on peut se demander si le nouveau CAPES (5), par l’abaissement du niveau « connaissances » de ses épreuves, et la suppression de l’année de stage « en alternance » (qui, si on y remplaçait le mémoire professionnel par de vrais cours de « culture générale d’écoute musicale», insuffisants à l’université, ainsi que par un réel travail de pratique théâtrale, prendrait un vrai sens) peuvent rendre réellement optimiste vis-à-vis d’une optimisation de ces deux pôles que revêt l’autorité.
Bon, pour conclure, je dirai que Jean-Paul m’a autorisé tellement peu de signes que j’ai à peine la place de vous dire que je n’ai fait qu’effleurer le sujet. Mais les commentaires compléteront.
Christophe Sibille
(1) On rappelle que les élèves n’ont qu’une heure de musique par semaine, ce qui implique les complexités de mémorisation des noms, d’évaluation, (et administratives de tous ordres.)
(2) Si l’on excepte une comparaison sonore hasardeuse entre ces deux poisons que sont cigare et ciguë.
(3) Sa présence au concert de Julien Doré, son amitié avec Johnny Halliday, Michel Sardou, Didier Barbelivien, Gilbert Montagné, Mireille Mathieu… N’en jetez plus ! Une overdose de génies.
(4) Carl Rogers, dans son livre « Liberté pour apprendre », ne dit pas autre chose, quand il rappelle que tenir un minimum compte des parcours des différents élèves demande, de la part de l’enseignant, des connaissances d’autant plus gigantesques dans la ou les disciplines qu’il est chargé d’enseigner.
(5) Qui aura encore moins le goût d’un concours efficient que le beaujolais du même nom ressemble à du vin.
II. Cours de musique : du pédagogisme avant toute chose
Les nuisances du pédagogisme dans les matières dites traditionnelles sont évidentes pour tous les observateurs attentifs, mais peu sont au fait des dégâts produits par cette idéologie délétère dans les matières dites « secondaires ».
Par exemple le cours de musique au collège…
Pourquoi cette méconnaissance, sinon ce mépris ? Nous autres profs de couacs n’avons pas attendu le fameux sketch de Gad Elmaleh (1) pour avoir une image désastreuse auprès du grand public. Depuis fort longtemps, de nombreux collègues soucieux de bien faire et de démontrer que leur discipline est à la pointe de l’innovation ont fait entrer le loup dans la bergerie. « Il faut être absolument moderne » semble être le leitmotiv inépuisable dont le but plus ou moins avoué était de river leur clou aux professeurs de souris ou de SMS (chacun reconnaîtra sa matière) qui entendaient reléguer notre matière « secondaire » (comme celles des professeurs de référentiel bondissant ou des profs de taches) au rang de vague utilité dans les conseils de classe : nous l’avons tous vécu.
Alors nous avons joué à fond — à donf, diraient les djeun’s — mais en tout cas à tort, cette carte de la « modernité » : elle s’est révélée être biseautée. Exit le solfège (2), exit l’histoire de la musique et sa chronologie, jugées et condamnées par avance comme « élitistes » : exit Mozart-le-ringard et Chopin-qui-craint ! Bienvenue au rap et aux musiques « de banlieue » pour être « proche des jeunes », bienvenue à la « transversalité » (3) sans queue ni tête et à l’élève-client qui « construit lui-même ses propres savoirs » sous prétexte de s’exprimer, alors que par ce refus explicite de transmission on le prive en réalité de tout moyen de le faire. Le professeur doit selon les programmes actuels fonder son cours sur « le plaisir musical partagé » (sic !). Le bonheur, au contraire de la connaissance, est donc obligatoire. Comme dans les dictatures ou dans les sectes, on se base avant tout sur la manipulation par les émotions pour être heureux — sur ordre ! Comme si le plaisir ne pouvait pas être — n’était pas, par définition, une conséquence du travail et de la connaissance ! Hélas, il ne se décrète pas : il ne peut être un pré-requis, et seuls de tristes pédagos en dehors de toute « réalité scolaire », comme dirait un certain Cambert devenu complètement fou, ont pu fantasmer le contraire : loin, très loin des vraies classes avec de vrais morceaux d’élèves dedans.
Résultat : le pédagogisme devait nous servir, il s’est au contraire servi de nous. Censé valoriser la matière, il l’a au contraire vidée de sa substance : sommés d’être des génies créatifs sortis tout droit d’une lampe à huile dans un conte oriental, les élèves sont vite amenés à animer/bordéliser un pseudo-cours haché en séquences-zapping où on ne leur apprend rien, ou si peu. Le tout étant aggravé par des « évaluations » complaisantes : la plupart des collègues notent rarement en dessous de 15/20 quelles que soient les « performances » de leurs rappeurs en herbe, de peur d’être mal vus par leur hiérarchie. Comment être pris au sérieux dans ces conditions ? Comment être crédible lorsqu’au lieu de transmettre des connaissances progressives et structurées, on cherche à n’importe quel prix à jouer les animateurs sympas, y compris en refusant parfois toute autorité parce que nous enseignons prétendument autrement (notre enseignement se réduisant ainsi à une posture) ?
« Voici venu le temps des rires et des chants », braillait Casimir dans l’Île aux enfants en manquant à chaque fois de faire écrouler le décor en carton-pâte du plateau de télévision sur lequel il dandinait son gros derrière. Voilà un tableau apocalyptique que ne renieraient pas la plupart des inspecteurs qui nous somment de divertir les enfants du peuple plutôt que de les instruire : refus de la discipline, du par coeur, des connaissances jugées « élitistes », de la « réalité scolaire » sous un emballage de jargon imbuvable (4). Refus de l’École, au final. Refus de la réalité aussi : le pédagogisme n’a jamais été autre chose qu’une religion du pauvre. A nous de refuser d’en être les adeptes. Car nous sommes au service de la République. Pas d’une secte.
Emmanuel Protin
(1) Sur l’usage de la flûte en cours de musique.
(2) Extrait des nouveaux programmes, applicables à la rentrée 2009 et consultables sur http://www.education.gouv.fr/cid22115/mene0817080a.html : « La connaissance théorique et abstraite des langages et des règles […] ne peut être l’objet de l’éducation musicale au collège » (page 3).
(3) Extrait des programmes de 3ème en vigueur, collection collège, CNDP, 1999, livret 1, P. 114 : « Voyager dans l’espace et dans le temps en choisissant par exemple des thématiques telles que : musique sacrée, musique de fête, musique de danse, musique populaire, musique de scène, etc. ». De fait, cette approche « thématique » ou « transversale » interdit toute chronologie : elle est bien sûr totalement déstructurante pour les élèves. Inutile ensuite de leur demander s’ils ont déjà entendu de la musique baroque, de citer Bach ou Wagner ou de comparer telle période avec la suivante ou la précédente.
(4) Les nouveaux programmes font… 20 pages au total. Le « projet » n’en faisait que 25, ne nous plaignons pas. On y parle entre autres de « champs de compétences », de « séquences » et « d’objectifs » (sic). Il ne s’agit pas de faire de la musique mais de « produire du son musical » (re-sic). Il ne s’agit pas de transmettre des connaissances mais de les « mettre en regard » par rapport aux « référentiels de compétences »qui lui sont liés (page 3). Ça promet : voilà qui annonce de futures inspections particulièrement rock’n’roll par les missi dominici du pédagogisme.