
Pasolini, Salò, 1975.
Les photos qui illustrent cette page sont toutes tirées de ce film, l’une des œuvres-limites qui paraissent parfois dans les arts comme des astres noirs dans un ciel enflammé. Je l’ai vu dans une salle qui n’existe plus, du moins tel qu’il était, la Pagode (rue de Babylone) et j’ai souvenir de ces homosexuels venus en couple ou en groupe pour Pasolini et quittant l’un après l’autre le cinéma, impossible de se confronter à ce que montrait le cinéaste. C’est bien sûr un film que notre modernité peureuse ne se risquera pas à revoir, ou seulement en catimini, le seul acquis réel depuis les années 1970 étant une épaisse couverture d’hypocrisie jetée sur les désirs — qui sont toujours là et toujours les mêmes, n’en déplaise aux féministes, aux wokes et aux imbéciles de toutes farines.
J’ai écrit en 2000, pour Larousse, une bio-analyse de Sade. J’emprunte ci-dessous l’un de ses chapitres, afin de préciser mon idée de ce que les imbéciles appellent « sado-masochisme » — et qui, de fait, n’existe pas.
Quant au « milieu » du BDSM, il est puéril. Les vrais masochistes n’y participent pas, sinon par dérision. Quant aux vrais sadiques, il est évident qu’ils n’en ont que faire.
On doit à Gilles Deleuze, dans une éblouissante Présentation de Sacher-Masoch sous-titrée « le Froid et le cruel » (1967), l’analyse définitive des relations (ou de l’absence de relation) entre sadisme et masochisme — qui génère, en regard, une biographie complémentaire de Sade qui vient s’inscrire dans les trous de son histoire.
Sade et Masoch sont, dit Deleuze, non seulement de grands cliniciens, en ce qu’ils ont rassemblé, et nommé, des symptômes jusqu’à eux épars, mais aussi de grands anthropologues et de grands artistes — capables d’imaginer un nouveau langage. Partant du principe qu’il est plus redoutable d’être touché que vu, et plus terrible d’être parlé que vu, Deleuze s’interroge sur la conjonction de la sexualité et de la violence dans le langage de Sade et de Masoch : « Comment rendre compte de cette violence qui parle d’érotisme ? » Se référant à Georges Bataille qui, dans L’Érotisme (1957), affirme que le langage de Sade est paradoxal « parce qu’il est essentiellement celui d’une victime », Deleuze dénie d’abord toute légitimité à la mise en rapport de la littérature de Sade avec le nazisme, avant de noter que seules les victimes peuvent décrire les tortures tandis que les bourreaux emploient nécessairement « le langage hypocrite de l’ordre et du pouvoir établis. »
Au langage du bourreau qui excuse, justifie et masque hypocritement la violence, s’oppose donc, chez Sade, la parole de celle et de celui qui refusent la tricherie, la parole de ceux qui auraient dû se taire et que Sade énonce pour les lecteurs. Non seulement Sade parle, mais de surcroît il raisonne. Il ne se contente pas d’une écriture pornographique (toujours réduite, rappelle Deleuze, « à quelques mots d’ordre — fais ceci, cela… — suivis de descriptions obscènes » où « violence et érotisme se rejoignent, mais d’une façon rudimentaire »), mais d’une écriture élaborée — philosophique. Car Sade ne raconte pas, ou ne fait pas que narrer, il démontre, dispose, entre deux scènes décrites : « la démonstration, comme fonction supérieure du langage », intervient au moment où l’on se repose pour établir une rigueur du pamphlet, mettre en scène une dispute argumentée entre bourreau et victime, ou énoncer une constitution. Mais dans le même temps, Sade démontre que la démonstration n’est qu’une feinte, ou une apparence, parce que le libertin, en empruntant la posture de celui qui persuade, voire qui éduque (dans La Philosophie dans le boudoir), n’a, dans les faits, aucune intention pédagogique.
Le libertin ne cherche pas à convaincre Justine, qui est tout entière dévouée à la Vertu. Mais les mêmes raisonnements continuent dans Juliette, où certes le libertin qui discourt ne cherche que les applaudissements — tant il est vrai, et Sade le démontre jusqu’à l’étourdissement, qu’il y a une volupté particulière à la parole, qui s’écoule aussi impétueusement que les flots de foutre qui l’ont précédée et la suivent, ordinairement. Mais cette volupté du dire ne vient-elle pas du fait que le mot lui aussi blesse ? Ce que montre ou démontre Sade, c’est donc que « le raisonnement est lui-même une violence, qu’il est du côté des violents, avec toute sa rigueur, toute sa sérénité, tout son calme. » La démonstration tourne à vide et se confond avec l’attitude de celui qui démontre et qui installe, par son discours comme par ses actes, sa toute-puissance. « À tous égards, poursuit Deleuze, l « instituteur » sadique s’oppose à l’ « éducateur » masochiste. » Ainsi, les violences infligées aux victimes sont les images parlantes d’une violence plus haute, celle du langage, et qui prend pour forme la démonstration : les bourreaux démontrent, seuls, et les victimes assistent à la manifestation discursive, au sein d’une froideur perverse.

« Il jeta sur elle le regard froid du vrai libertin », écrit Sade. Roger Vailland, dans une étude très superficielle du libertinage et de Laclos (le Regard froid, 1963), lit dans la phrase la distance inhérente à l’intellectualisation d’Éros. Deleuze, étudiant la fameuse « apathie » du libertin, « le sang-froid du pornologiste » en tant qu’il s’oppose « au déplorable « enthousiasme » du pornographe » — type Rétif —, note que « Sade, au moins, n’a pas montré le vice agréable ou riant : il l’a montré apathique. Et sans doute de cette apathie découle un plaisir intense ; mais à la limite, ce n’est plus le plaisir d’un Moi qui participe à la nature seconde (fût-ce un moi criminel participant à une nature criminelle), c’est au contraire le plaisir de nier la nature en moi et hors de moi, et de nier le Moi lui-même. » C’est là, dans cette « froideur », que Deleuze voit l’essentiel de la structure perverse qui fonde le sadisme.

Cette froideur permettrait-elle de définir enfin la perversion comme une absence aux autres ? Deleuze ne pense pas que la perversion puisse être définie par une simple absence d’intégration. Pour lui, Sade montre que nulle passion, l’ambition politique, l’avarice économique, etc., n’est étrangère à la « lubricité » : « non pas que celle-ci soit à leur principe, mais au contraire parce qu’elle surgit à la fin comme ce qui procède sur place à leur resexualisation. » Ainsi, les libertins de Sade aiment volontiers l’or, les honneurs, les charges honorifiques. C’est que le sadique, d’après Sade, joue volontiers au plus près du pouvoir. Il en est même peut-être la représentation. On sera donc en droit de se demander si, durant la Révolution, les « vrais » sadiques sont ceux qui opèrent en catimini, sous les arcades du Palais-Royal, ou plutôt ceux qui agissent au grand air de la guillotine. Le héros sadique devient ainsi celui qui se donne pour tâche de penser l’instinct de mort, comme négation pure, par la démonstration et par la multiplication de ses actions destructrices.
Alors, qu’en est-il en fin de compte du « sadomasochisme », si courant dans la conversation qu’il a fini, à l’époque actuelle, par se condenser en deux consonnes indissociables — S.M. ? « Le marquis, dit plaisamment Sollers, se retrouve marié malgré lui avec un médiocre écrivain du dix-neuvième siècle qu’il aurait, s’il avait pu le lire, profondément méprisé. » Appellation d’autant plus mensongère, explique Deleuze, qu’elle semble tomber sous le sens.
Jean-Paul Brighelli
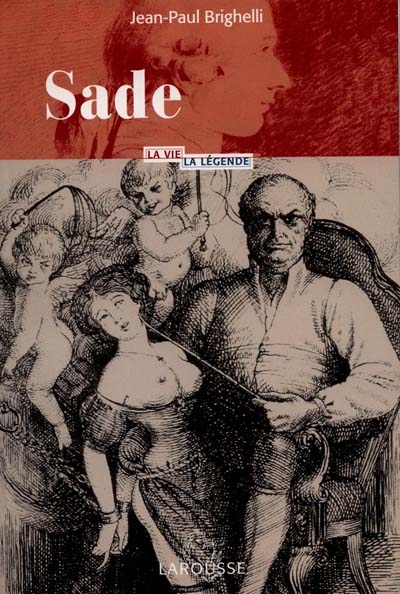




JPB parle de Restif ou Rétif de la Bretonne dans ce billet. Sans trop d’éloge. Et aussi des sadiques révolutionnaires.
Dans les Nuits révolutionnaires de Restif il y a un passage remarquable ( les journalistes d’aujourd’hui diraient » glaçant « ) : on est pendant les massacres de septembre, et Restif est chez lui et n’arrive pas à dormir. Il entend des hommes réunis sous sa fenêtre et à leur discussion il comprend que ce sont des massacreurs.
» Quelques-uns de ces tueurs criaient : « Vive la Nation ! » Un d’entre eux, que j’aurais voulu voir, pour lire son âme hideuse sur son exécrable visage, cria forcènement : « Vive la mort ! »
Les massacreurs de septembre ont massacré les pensionnaires des asiles.
une bio-analyse de Sade.
Une bio-analyse n’est pas une simple biographie.
Le sigle BDSM n’implique pas l’existence de sado-masochistes.
JP Brighelli Sade La vie La légende
Comme disait un marchand de papier (un patron de journal) dans un film:
« When the legend becomes fact,print the legend.)
Certains en font une pensée philosophique .
https://blog.causeur.fr/bonnetdane/wp-content/uploads/sites/25/2025/10/423327cf859b756fc9e89da70a8ba692bb0272add5d37ba273942b76690b8dbc.jpg
Se complaire dans l’asservissement :
je t’ordonne, tu exécutes,
parfois même dans la jouissance, d’un côté comme de l’autre (!), jusqu’à tendre l’autre joue, voire le bras (!),
se prostituer, se prosterner aux pieds du (des) maître(s), toujours plus implacable(s). Ainsi fonctionnent bien des humains, au sein de sociétés qui n’en finiront jamais d’être bancales, ne connaîtront sans doute jamais l’équilibre.
BDSM selon un site de » medievistes » ( ???)
» Attestées au moins depuis le XVIIIe siècle, les pratiques érotiques consistant à administrer et à recevoir de la douleur (ligotage, fouet, fessée, etc.) ou à adopter des rôles de dominants et de soumis sont historiquement marquées du sceau de la pathologie. À partir des années 1990, le terme « sadomasochiste », trop entaché de connotations psychopathologiques, est progressivement rejeté par ses adeptes et remplacé par l’acronyme BDSM, qui englobe l’ensemble des pratiques érotiques non conventionnelles ayant comme point commun une forme d’échange contractuel de pouvoir, et qui utilisent la douleur, la contrainte, l’humiliation ou la mise en scène de divers fantasmes dans un but érogène, éducatif, disciplinaire ou amoureux. BDSM est formé à partir de trois autres acronymes : « B/D » pour « Bondage et Discipline », un ensemble de pratiques organisées autour de châtiments corporels et de restrictions physiques ; « D/s », pour « Domination et soumission », un ensemble de pratiques où un « Dominant » prend le contrôle d’un « soumis ».
Etc
https://uca.hal.science/SHMESP/hal-03069449v1#:~:text=BDSM%20est%20form%C3%A9%20%C3%A0%20partir,d'un%20%C2%AB%20soumis%20%C2%BB.
Pipeau.
Mais pourquoi » pipeau » ?
» …la mise en scène de divers fantasmes dans un but érogène, éducatif, disciplinaire ou amoureux »
Où l’éducation va-t- elle se nicher?
Et que veut dire ici » disciplinaire » ?
« Où l’éducation va-t- elle se nicher? »
Elle va se nicher dans ses torchons.
Oui…
Tsssssssss !
L’idée est que la Soumise doit être éduquée, et punie lorsqu’elle obéit mal.
L’aspect pédagogique m’a toujours rebuté.
Jean-Paul Brighelli 16 octobre 2025 à 16h28
L’idée est que la Soumise doit être éduquée, et punie lorsqu’elle obéit mal.
La soumise est perverse, elle obéit mal, le fait-elle exprès? On ne sait pas, mais ça énerve les millimaîtres qui redoublent de cravache ou d’outrances grotesques, quelquefois même dangereuses, sans deviner un instant qui mène la danse…
Bien des mémètres ne sont que des pantins, pris dans les rets subtils et implacables d’une gourgandine (y’en a des pas toute jeune…), ils ne savent pas que le bout du fouet qui attache l’esclave c’est la poignée…
Certes. C’est pour ça que je dis que les vrais maîtres sont rarissimes. Les autres n’ont pas lu Hegel.
Moi j’ai lu Hegel, et ce que j’en a retenu n’a pas grand-chose à voir avec le sadisme. Le maître hégélien cherchant la reconnaissance et la liberté impose sa volonté à l’esclave, mais par le jeu dialectique l’esclave développe sa conscience en travaillant sur le monde et trouve ainsi liberté intérieure et autonomie. La domination n’est jamais un outil de contrôle moral ou de punition : elle ne sert pas à « éduquer » l’autre, et encore moins à imposer des désirs arbitraires.
Si vous décrivez une relation consensuelle, ça n’a rien à voir avec Hegel puisque celle-ci ne produit ni lutte existentielle ni développement de la conscience. Et si c’est une relation non consensuelle, cela ne conduit qu’au traumatisme et à l’aliénation, soit exactement l’inverse de ce que décrit Hegel.
Et « pipeau » parce qu’il ne s’agit pas de jeu, mais de la réalisation de désirs.
Je comprends mieux.
Il y a donc une sorte d’élevage ou de dressage de la soumise ( ou du soumis), en principe.
Et » jeu » ( de rôles )est une formulation qui rend acceptable socialement la pratique ( c’est un amusement) mais qui ne correspond pas à la personnalité de tous les pratiquants.
À 90%, les pratiquants s’en accommodent. On ne manque pas de masochistes dans ces jeux, mais on manque singulièrement de vrais maîtres sadiques.
S’envoyer en l’air :
(JPB est-il l’auteur de la photo ? 😁)
https://www.facebook.com/photo?fbid=769333595927787&set=a.108734718654348
Non, moi, j’étais au sol.
La Passion de la méchanceté de Michel Onfray – Editions Autrement https://share.google/hEFeweDIUzd9K8GWA
Roland Barthes lit Sade. Vite, tirons la chasse! https://share.google/b9PGqTuRAsUJyLb1F
Vite, tirons la chasse! Et la fête !
Oui…
(facile pour Lormier)
Le rythme des commentaires reprend un peu depuis le retour du Luxembourg de WTH qui est revenue avec sa soeur WSNS
Tsssssssss !
Ce n’est certainement pas chez les Luxos que j’aurais pu acquérir mon super hâle ! 😁
Ma soeur pas spécialement fan de BdÂ.
Il est donc inadmissible que quelqu’un ait osé utilisé ce W, d’autant que WSNs = Wireless sensor networks ;
re Tsssssssss !
(du grain à moudre pour Lormier et ECHO ?
Un revenant que ce W ?)
WSN
Wireless sensor network
Un réseau de capteurs sans fil est un réseau ad hoc d’un grand nombre de nœuds…
On reste dans une thématique particulière et familière…
Le sigle BDSM n’implique pas l’existence de sado-masochistes.
Autrement dit, quand on développe l’acronyme,on ne met pas de trait d’union entre Sadiques (S) et Masochistes (M).
La linguistrerie a fait un grand pas.
WTH 16 octobre 2025 à 12h01
Se complaire dans l’asservissement …
parfois même dans la jouissance… jusqu’à tendre… le bras (!),
=========================================================
Si vous voulez parler des moutons lobotomisés, je ne pense pas qu’ils éprouvent une quelconque jouissance;d’ailleurs ils n’ont pas consience d’être asservis. Comment pourraient-ils en avoir conscience,lobotomisés qu’ils sont ?
Dans une pharmacie aujourd’hui, j’en ai vu quelques uns venir prendre rendez-vous ou se faire piquer, contre la grippe notamment. Des voisages hébétés, sans expression.
Plus rien d’humain.
Si j’étais plus jeune,je photocopierai l’article du Canard et le collerait sur la vitruine de la pharmacie.
Le Canard…qui fut si vaccinolâtre pendant la plandémie!
page 4, édition du mercredi 15 octobre 2025.
« L’infectiolgue star…des plateaux de télé,….Anne Claude Crémieux…supprime un paragraphe entier défavorable au vaccin de Sanofi et modifie certains passages. »
Quand les piqueurs disent-ils que la protection offerte par le vaccin anti-grippe est cette année, au miux de 25 % ?
Enfin utiles en ris d’agneau !
Depuis, vous êtes devenu un vieux con
Du Luxembourg,beaucoup de vols partent vers des terres baignées de soleil . En 68 ,on allait à Cuba voir la révolution;aujourd’hui,on y va pour bronzer et manger des langoustes pêchées clandestinement par des mecs qui les cachent dans leur maillot de bain.
https://www.topescortboys.com/
Et les pinces de homard ?
« vers des terres baignées de soleil »
Lombrics ? Ether pré-relativiste ? Cuba ou cualtiers ? (Dard)
https://www.youtube.com/watch?v=tGbRZ73NvlY
« Ménage tes méninges » ou espionnage sous les Tropiques – (😁)
(« Buena Vista » : ouahou !)
Enfin utiles en ris d’agneau !
IAL n’a toujours pas été doté d’un Caterpillar D9. Il serait dommage que ce terminator de bonne volonté reste frustré de ses (grandes) capacités d’arasement
https://www.lemonde.fr/videos/video/2025/10/16/gaza-le-d9-israelien-un-bulldozer-de-guerre-au-service-de-l-aneantissement-de-l-enclave_6647187_1669088.html
Lormier
Quand les piqueurs disent-ils que la protection offerte par le vaccin anti-grippe est cette année, au miux de 25 % ?
Piqueurs d’autrefois
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5759
Magnifique !
Oui !
Lormier
Quand les piqueurs disent-ils que la protection offerte par le vaccin anti-grippe est cette année, au miux de 25 % ?
Je ne sais pas quand les piqueurs disent cela mais c’est qui est enseigné en fac de médecine ou dans les cours d’épidémiologie. Globalement, cela varie selon l’indicateur choisi, consultations ou hospitalisation, et la classe d’âge, l’efficacité du vaccin est de l’ordre de 40 à 50%. Cela peut sembler peu mais en cas d’épidémie n’avoir à prendre en charge que 2 millions de cas au lieu de 4 est un avantage certain.
Le virus est très variable et les vaccins sont élaborés avec 6 mois d’avance sur la saison grippale (hiver pour nous français) de l’hémisphère concerné (nous c’est Nord) en prenant en compte les recommandations de l’OMS qui observe les souches circulants dans l’autre hémisphère (Sud) pendant l’hiver australe. C’est empirique et le virus est joueur, au dernier moment des recombinaisons inattendues peuvent se produire obérant l’efficacité de la vaccination, voire la thèse de ce médecin bordelais qui explique ça très bien même pour un non scientifique.
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01611698/document
A vez-vous vu l’article du Canard (15/10/2025) intitulé: « Un rapport truqué sur le vaccin anti-gripe Sanofi ».
Une infectiologue de plateau,Madame Crémieux a effacé des paragraphes du compte-rendu d’experts et modifié certains termes afin de cacher certains inconvénients de ce vaccin et d’en exagérer l’efficacité…Tout ça pour qu’il soit remboursé à 100% et que sanofi en vende plus.
Sanofi, comme vous le savez, est dirigé par Oudéa, mari de Madame Oudéa Castera.
C’est le grand mystère de l’amour:un type très intelligent, ancien X, épouse une pauvre khonne et s’entend très bien avec elle.
Amine Umlil, le pharmacien de l’hôpital de Cholet révoqué pour avoir expliqué aux seénateurs lors d’une commission d’enquête que le produit dit vaccin anti-covid a vait été mis sur le marché en violant la règlementation sur les produits de santé a posté l’article du Canard.
https://x.com/amine_umlil/status/1979136574966075548
Lormier :
« Cuba », fini depuis lurette ; plus de touristes ; en train de crever plus que jamais, lentement mais sûrement.
Luxair fait de très bonnes affaires avec ces gros Lux cargos.
De plus, une banque chinoise bien installée, et dans l’épicerie bio (la mieux approvisionnée *) vu un petit groupe de touristes chinois très intéressés faisant quelques emplettes.
Vous avez écrit : « Des visages hébétés, sans expression.
Plus rien d’humain »
Rappel : coincée 2h24 en gare de Vierzon,
« les autres (reste) humains n’ayant pas bougé, pas ouvert la bouche sauf pour enfourner le « repas » et regarder un deuxième film sur leur tablette. »
Descendue plusieurs fois sur le quai, presque personne ;
n’y avait que moi pour papoter avec le chef de gare (😁) – aucune question posée au personnel Sncf, etc…
* et bien achalandée (😁)
« pour papoter avec le chef de gare »
Parce que vous êtes très entraînée à papoter au tennis et que vous redoutez peu les gares ?
Oui…
(deux)
(tapoter penis regouter dards –
Lormier ne répondant plus, je m’y colle, momentanément)
papoter au tennis
Tapoter au Pénis
NB Tapoter est plutôt transitif ; »tapoter le pénis » irait mieux.
vous auriez pu proposer « tapoter haut pénis «
Si Cuba crève que dire de Vierzon ?
Amélie Nothomb:
« Pour aller à Vierzon, il faut s’arrêter à la gare de Vierzon, c’est au-dessus de mes forces »
(lefiga, 13/08/25)
https://france3-regions.franceinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/vierzon/un-neant-insoutenable-amelie-nothomb-charge-la-gare-de-vierzon-en-reponse-la-ville-l-invite-3200583.html
(😁)
Intercausement avec le chef de gare de Vierzon :
Y décarre quand le dur ?
-Maybe two morros (il est en formation globish #3.14)
(« je devrais être à la retraite ! 19 mois de boulot en sus ! C’est la faut’ à Macron »… etc…)
vous redoutez peu les gares ?
vous reGoûtez peu les Dards ?
(Vous avez oublié le 15h57* et le 16h20* du 16 oct d’abcm’ –
* hors horaires sncf)
Et pourtant Vierzon est un lieu singulier du point de vue ferroviaire :
https://lautomobileancienne.com/18-mars-1976-une-traction-coute-3-milliards-a-la-maif/
Et en complément :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_du_tunnel_de_Vierzy
Perpignan peut-il en revendiquer autant ?
(😂)
M’en souviens. La maif avait fait un appel au peuple en expliquait que ce genre d’accident nécessitait une solidarité
(Lormier : pour les courageux – 😁 – une conf’ de 4h, avec entre autres, le Dr R. Malone)
https://www.francesoir.fr/sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2025-10/FS102025%20%2821%29.png?itok=FdJJ2aj-
« Lormier : pour les courageux – 😁 – une conf’ de 4h »
Lormier n’ira pas jusqu’au bout .
Pour parvenir au but, il faut beaucoup de courage.
Oui…
NB:
Merci à vous de continuer à palier les insuffisances de Lormier.
(PS plutôt que NB.)
Prononcer but comme s’il n’y avait pas de t
Evitons le bourrage de crâne.
Pour parvenir au but, il faut beaucoup de courage.
Pour parvenir au bOUt, il faut beaucoup de cUrage.
Bonne performance de Lormier.
Bout ou boues ?
Non aux boues de curage !
Oui…
Curage;pour fixer les idées:ils vont jusqu’au bout.
https://www.youtube.com/watch?v=-Q74D7QyS6w
Dugong 17 octobre 2025 à 7h09
Et les pinces de homard ?
Exportées à Versailles,photographiées par les touristes japonais;
Jipé nous recause encore une fois du marquis et de ses Justine..tout le monde comprend que pour lui c’est pas des livres qui fleurent bon les vacances, les maisons de famille, les grands-parents, les drames étouffés, les petits et les grands moments, les allégresses collectives et les tristesses en solitaire…
hélas pour lui sa cousine elle voulait pas à jipé..hurkhurkhurk !
Ici dans son blog, de vieux marquis décatis et des comtesses défraîchies se parent de toutes leurs fiches de lecture comme se chamarraient de broderies les futurs guillotinés de la Révolte Française des gueux…
Pouffons ! Pouffons ! mes frères et mes sœurs devant l’inanité de ces comportements de castrats…uhuhu !
Pasolini, Salò, 1975.
Salò, jlavais vu ya plus de 10 ans dans une rétro Paso près djussieu ou vers odéon ce film. À sa sortie en 75 son côté pornochic permettait sans doute aux spectateurs de l’époque de passer un moment salace, tout en ne se sentant ni vicelards ni voyeurs, mais se persuadant de vivre une expérience esthétique, avec l’impression gratifiante d’être capable d’un regard distancé sur ces choses.
Parmi ces mateurs yavait surement dudu et jipé planqués derrière leur acné juvénile et leurs lunettes antirouille. Maintenant y préfèrent mater iouporn dans leur piaule où y’a pus ddoute sur l’espérience nonesthétique..c’est ça d’ête fauxcul..dans l’âme..ça se soigne pas..hurkhurkhurk !
Dugong 17 octobre 2025 à 11h47
Si Cuba crève que dire de Vierzon ?
C’est drôle le nombre d’endroits dont on dit: »c’est fini » Capri…
Pour le « sanky-panky », ilsemble que les meufs défraîchies aillent surtout en République dominicaine maintenant.
Je me demande d’ailleurs pourqoi et comment « hanky-panky » a donné la variante « sanky-panky ».
Grand merci pour cette information Lormier.
Ignorant l’existence du sanky-panky et renseignement pris auprès de maître google,
lu que la « motion picture » * s’étant intéressée au sujet date de près de 20 ans.
Et avec Haïti si proche, les vieilles donzelles seraient de nos jours promises à la broche.
* rappel : « anglais obligatoire, après le triomphe du grand faiseur de paix… »
Que se passe-t-il ? Rien de grave j’espère ; à moins que vous ne soyez très occupés à converger sur Paris (*) pour manifester votre désapprobation à l’incarcération de Sarko (😁)
(* méfiance avec la Sncf)
C’est la malédiction de JG
En quittant le blog il a jeté un sort et les commentateurs languissent, frappés d’aboulie.
Les voix languissent ?
De qui parlez-vous exactement ?
De WTH, je suppose.
Oui…
Les voix languissent ?
Les vIts l’angOIssent ?
NB Sur les plages de la République Dominicaine, ce n’est pas en montrant leurs bites que les « beach boys » attirent les meufs qui veulent du « sanky-panky ». C’est en exhibant leurs pecs.
« good, good, good, good vibrations »… (ouaf !)
« sanky-panky »
Oui…
Jean-Paul Brighelli 16 octobre 2025 à 17h50
Non, moi, j’étais au sol.
D’où vient l’expression « claqué au sol » ?
Deleuze dénie d’abord toute légitimité à la mise en rapport de la littérature de Sade avec le nazisme…
Pasolini,peut-être pas. « Salo ou les 120 journées de Sodome. C’est Hitler qui a installé Mussolini à Salo…et les sadiques du film,s’ils ne sont pas nazis, sont fascistes.
Grave question: Pasolini aurait-il pu représenter le sadisme dans un contexte communiste ?
En faisant de ses « héros » des fascistes, il ne prenait pas de risque.
Sa mort en 1975 intervient dans le contexte des « années de plomb » – même si on a discuté des implications politiques de cette mort (simple « fait-divers » , drague qui a mal tourné ?) .
Pour l’extrême gauche de l’époque, dont une partie céda au terrorisme, même les démocrates chrétiens étaient des fascistes, les américains étaient des fascistes…
’ils ont rassemblé, et nommé, des symptômes jusqu’à eux épars
épars,épars…le mot est quasiment préempté. On se demande si les Maestro n’a pas eu quelque réminiscence … un eu comme Lacan;d’ailleurs la phrase sonne un peu lacanien.
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.
Lacanerie ? Mallarmisme ?
œuvres-limites qui paraissent parfois dans les arts comme des astres noirs dans un ciel enflammé
L’espace à soi pareil qu’il s’accroisse ou se nie
Roule dans cet ennui des feux vils pour témoins
Que s’est d’un astre en fête allumé le génie.
« Que s’est d’un astre en fête allumé le génie. »
Leur verbe est génie .
Oui…
« Dans la Salle du Consistoire, le Pape François avait réuni les cardinaux présents à Rome ce lundi 1er juillet pour un consistoire ordinaire public, concernant plusieurs causes de canonisation. »
Peut-être ne nous a-t-il pas tout dit ?
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2024-07/canonisation-20-octobre-2024-elena-guerra-carlo-acutis.html
Incontournable même si trop connue :
Dialogue de deux prêtres en action dans un urinoir :
– Tu n’aurais pas un peu forci ?
– Non, je rentre encore sans problème dans un 12 ans.
Ouf!
Sanky-panky serait un mot-valise hispano-anglais:
The term Sanky Panky is derived from the English expression “hanky panky” (to fool around) and the Spanish expression “saca panty” (takes panty).
https://girlservesworld.wordpress.com/2015/08/03/beware-of-the-sanky/
La photo d’illustration est parfaite.
abcmaths
19 octobre 2025 à 14h17
« sanky-panky »
Oui…
Leur verbe est génie .
Leur verGe est Bénie .
Pecs
https://0c530c5e4e.clvaw-cdnwnd.com/6532166fdebd83f118128e499785abeb/system_preview_detail_200003291-8cf568df80/Sanky%20panky%20real.jpg
Jean-Paul Brighelli 16 octobre 2025 à 17h50
Non, moi, j’étais au sol.
https://tbi.sb-cd.com/t/3634626/3/6/w:500/t6-enh/extreme-high-heel-worship.jpg
Claqué au sol
(contenu explicite)
https://0f30eea4.delivery.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2025/01/mixed-femdom-blog.cc-28301.mp4-preview.webp
Come on! Step on it!
https://0f30eea4.delivery.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2025/09/premium-mixed-femdom-blog.cc-37493-poster.jpg
Déqueulasse !
Step on it ! « it »,c’est l’accélérateur. Une phrase classique des films-poursuite flics voleurs. Appuie sur le champignon!
Sorti récemment:
« Le Monde » s’est plongé dans les 1 482 pages de l’arrêt rendu le 7 juillet par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République. Au-delà du non-lieu prononcé en faveur d’Agnès Buzyn, Edouard Philippe et Olivier Véran, ce texte, appelé à faire date, relève de graves manquements…
Les trois magistrats de la CJR étrillent une gestion gouvernementale émaillée, selon eux, de multiples dysfonctionnements. Révélant les erreurs – et, parfois, les mensonges – de l’exécutif, ils concluent que nombre de décès, sur les 32 000 recensés de janvier à juillet 2020, auraient pu être évités. »
Faudra lire les 1482 pages pour comprendre pourquoi ça s’est terminé par un non-lieu général.
Il faut dépasser la logique simpliste selon laquelle les gestionnaires ont une responsabilité dans la gestion.
« La conclusion du rapport est sans appel : les 32 000 morts liés au coronavirus auraient pu être empêchés. Le texte pointe le « manque d’anticipation crucial des autorités », comme premier et principal grief. « Chacun sait que le temps en matière d’épidémie est primordial, […] la vitesse de réaction fait tout » postulent les magistrats, qui affirment que « plus le temps de réaction est long, et plus la question d’une éventuelle qualification pénale se pose. » En somme, la lourdeur de la faute est proportionnelle au manque de réactivité des dirigeants. En la matière, le texte rappelle que le gouvernement connaissait dès Noël 2019 le caractère létal du virus, alors que les premiers cas sur le sol français ont été recensés le 24 janvier, soit un mois plus tard. Or, 10 à 20 avions en provenance de Chine atterrissaient quotidiennement en France…. »
Source:
https://www.lejdd.fr/Societe/manque-danticipation-crucial-un-rapport-choc-etrille-la-gestion-du-covid-19-par-le-gouvernement-163050
« Il faut dépasser la logique simpliste selon laquelle les gestionnaires ont une responsabilité dans la gestion. »
Ça, c’est drôle !
En « rire » ou en pleurer ? La cour de justice (hors de question de mettre des majuscules) à l’égal du reste…
Claqué au sol,suite…et c’est loin d’être fini.
https://godsofadult.com/wp-content/uploads/2019/06/Under-Mistress-High-Heels-Under-Feet-Femdom.jpg
« sanky-panky »
« samPAN kiKI » (un sampan nommé Kiki)
ou KIKI PENSANT
Belle performance de Lormier: La contrèpeterie n’était pas facile.
contrepèterie.
kiki pensant
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8qo8ouq_DDyTCCu3n6B-GfSHgNuypHFSMNw&s
Bijoux (de famille ) : ne pas confondre avec ceux qui ont été dérobés au Louvre – d’une « valeur inestimable » ; « une attaque contre notre patrimoine » (le Nollandais)
C’était juste une pub pour Kiloutou.
Gaza… Maintenant que les otages ont été rendus… Fin du cessez-le-feu…
« Les nuits de Topkapi » (sieur JP Brighelli) – courts extraits :
. « Nos tenues arabes nous distinguent trop, dans ce pays sans Arabes. »
. «… les localités de Palestine. – Des Juifs et des chrétiens, voilà la vérité ! (…) Des Arabes (…) petits groupes de bédouins (…) A Gaza, j’ai décompté cinq cent cinquante habitants, moitié juifs, moitié chrétiens. Et à Jérusalem, cinq mille habitants, presque tous juifs (…). C’est une terre juive. »
. « – Il faudrait, lui confia-t-il, un peuple autrement industrieux pour donner vie à des terres si inhospitalières et y faire pousser l’olivier et la vigne. Un jour peut-être… »
(😁)
C’est ça, la double historicité dans les romans historiques !
Au passage, c’est le témoignage d’un voyageur hollandais en Palestine début XVIIIe.
Depuis le « voyageur » du XVIIIe, changement d’ordre quantitatif, mais guère d’ordre qualitatif.
Gaza a (sur)vécu, grâce au brouzouf venu d’ailleurs (de l’UE entre autres),
et les pays du Golfe qui nagent dans le brouzouf,
grâce aux technologies en pointe fournies par l’Occident.
D’autres, comme le Maroc, en plaquant (mal) le XXIe siècle sur des modes de vie quelque peu archaïques.
(Ci-dessus, défoulement en mode JG, et en globish ; so what ? Vaut mieux écouter 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=zqNTltOGh5c
(« défoulement » mis à la poubelle – merci !)
WTH
Depuis le « voyageur » du XVIIIe, changement d’ordre quantitatif, mais guère d’ordre qualitatif.[à Gaza notamment ]
J’avais lu (où ?) que la majeure partie des habitants actuels de Gaza (il faut en défalquer un certain nombre depuis le 7 octobre 23) n’était pas originaire de cette zone. Il s’agit de réfugiés palestiniens venus d’un peu partout depuis ces dernières décennies.
Les habitants d’origine (s’il en reste) doivent leur dire merci…
Lu dans le Vespéral :
« Rien ne changera vraiment, confie Ahmed, 61 ans, père de sept enfants et marchand d’herbes ambulant. La guerre va continuer, et le Hamas est la seule vraie réponse pour défendre notre cause. Peu importe ce que cela coûte. »
« Ce que cela coute » à qui ?
En voilà un à qui il faudrait esspliquer les bienfaits de la contraception sauf si le but est de fabriquer à la chaîne de la chair à canon
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2025/10/15/pour-evaluer-le-nombre-ideal-de-deputes-la-racine-cubique-est-la-cle-d-un-debat-parlementaire-de-qualite_6646955_1650684.html
Perso, les excédents de putés et de sénateurs, je les offrirais en sauce à des papous anthropophages qui les suceraient jusqu’à l’os.
75% environ des règlements (normes etc) qui… s’imposent à la France,
car émanant des instances décisionnaires de l’UE,
le nombre des putés (et sénateurs) devrait être (au moins) diminué… en conséquence !
La question est : (de) combien faut-il en (r)abattre ?
Article creux.
Comme les « maths » sous-tendues…
Je connais un peu l’auteur.
Son obsession est de changer les maths.
Oui…
(à Springfield, Ohio, sept. 2024, Trumpy accusait les Haïtiens de manger les chats et les chiens – 😁)
WTH
20 octobre 2025 à 18h05
75% environ des règlements (normes etc) qui… s’imposent à la France,
car émanant des instances décisionnaires de l’UE
L’UE n’est pas d’accord…
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/fact-checking-80-des-lois-francaises-viennent-elles-de-l-union-europeenne/
Chiffres, pourcentages, calculs : compliqué !
J’en reviens donc à de plus simples affaires… vestimentaires.
Après le tee-shirt de Lavrov (avant la réu en Alaska),
« russian tie’ » ou « ties with Russia » ?
(le figaro) :
« La cravate de Hegseth, ornée de larges rayures blanches, bleues et rouges disposées dans le même ordre que sur le drapeau national russe, se démarquait de la tenue par ailleurs sobre de la délégation américaine », (agence Tass).
« Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe d’investissement direct russe, a publié une photo de Pete Hegseth :
‘Looks like the Russians like his Russia tie.
It’s not red-white-blue either. It’s red-blue-white. Like the Russian flag. For a meeting with Zelensky‘ »
(amusant de lire la fiche wiki de K. Dmitriev !…)
https://pbs.twimg.com/media/G3im-YIWYAABoah?format=jpg&name=medium
Par contre le motif de la pochette de Hegseth est le drapeau américain , stars and stripes
Voir photo de WTH
Ou celle ci
https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/10/19/pete-hegseth-tie-causes-diplomatic-spat/
Je n’avais pas remarqué ! ahaha !
Dugong 20 octobre 2025 à 12h17
… si le but est de fabriquer à la chaîne de la chair à canon
HPI palestinien (6 ans !)
https://www.facebook.com/StandWithUs/videos/palestinian-child-has-already-been-brainwashed-to-hate-jews-and-israel/741479389733542/
Selon Mearsheimer, Trump essaie maintenant de se désengager vis à vis de l’Ukraine:que l’Europe discute avec la Russie et l’Ukraine,les EU se retirent.
Selon Mearsheimer toujours,ni une paix,ni un cessez-le-feu ne peuvent être atteints par la négociation: Poutine exige d’annexer une partie de l’Ukraine, il exige qu’ele devienne un état « neutre » etc.
Exigences inacceptables pour l’Ukraine.
Le conflit ne se règlera que sur le chmaps de bataille ( probablement,selon Mearsheimer) par la capitulation de l’Ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=nvkmSlpvRRo
Non, le conflit se règlera par la mort de poutine.
La russie n’a aujourd’hui strictement aucun moyen d’obtenir la reddition de l’Ukraine, que ce soit sur le plan militaire ou diplomatique. Même avec l’appui de Krasnov, celui de l’Iran et de la Corée du Nord.
Depuis trois ans, c’est la russie qui s’est affaiblie et l’Ukraine qui a monté en puissance, pas l’inverse.
Quand le rat du Kremlin sera enfin crevé, de mort naturelle ou moins naturelle, son successeur ne tardera pas à se désengager d’une guerre entreprise pour des motifs aussi monstrueux qu’imbéciles et qui coûte bien plus qu’elle ne peut désormais apporter à son pays. Ce n’est pas une prédiction, mais c’est bien ça le scénario le plus probable : poutine ne peut pas s’arrêter parce que ça signifierait la chute de son règne, mais son successeur ne pourrait pas se permettre de poursuivre exactement pour la même raison.
Les vieilles raclures impérialistes finissent par calancher ; l’Ukraine demeure.
M. comme Zélensk’ s’accroche…
Rappelons à M. que la (sainte !) Russie est née à Kiev,
et Odessa est l’oeuvre de la grande Catherine II.
Accorder un peu plus de crédit à Mearsheimer qu’à M. semble aller presque de soi.
Qui vivra verra, mais oser écrire :
« Depuis trois ans, c’est la russie qui s’est affaiblie et l’Ukraine qui a monté en puissance, pas l’inverse. »
…
Heureuses les simples d’esprit.
Eh oui coconne, Mearsheimer a beau avoir une OPINION différente de la mienne, sur le plan des FAITS c’est bien moi qui ai raison:
Croissance 2025 : Russie +0,6 % vs Ukraine +2 % (FMI).
Le secteur privé russe en récession (PMI 46,6, d’après le Moscow Times).
La Russie vit sur la dépense militaire, pas sur une économie saine.
La guerre vide la Russie de ses forces vives : 1,5 million de travailleurs manquent, dont 400 000 dans l’industrie d’armement (PISM).
Les pertes militaires russes sont massives.
Oryx : plus de 3 800 chars russes détruits ou capturés (contre env. 1 100 ukrainiens).
ISW / CSIS : seulement ~5 000 km² gagnés en 2024, soit < 1 % du territoire ukrainien.
Des pertes matérielles et humaines sans précédent pour des gains dérisoires.
L’Ukraine, elle, a gagné en puissance militaire. Depuis 2022, l’armée ukrainienne a triplé son volume d’artillerie lourde et de défense antiaérienne occidentale. Elle dispose désormais de chars Leopard 2, Abrams, Challenger 2, de F-16 en cours de déploiement, et d’une industrie de drones très performante.
Alors que l'Ukraine n'a même plus de marine de guerre, elle a neutralisé la flotte russe de la mer Noire à plus de 50 %, forçant Moscou à retirer ses navires de Sébastopol (UK MoD, Naval News).
L’armée ukrainienne est aujourd’hui plus technologique, mieux entraînée et plus interopérable avec l’OTAN que celle de 2022.
L’Ukraine rebondit économiquement. Après −28 % en 2022, PIB +5,3 % en 2023, +2,9 % en 2024 (Banque mondiale, OCDE). L’EBRD prévoit encore +4,7 % en 2025.
Politiquement : la Russie se ferme, l’Ukraine s’ouvre.
L’Ukraine reste soutenue par l’UE, le FMI et la Banque mondiale, avec un cap clair vers l’intégration européenne.
En trois ans, la Russie s’est affaiblie sur tous les plans : économie stagnante, pertes colossales, armée usée, isolement diplomatique.
L’Ukraine, malgré tout, a renforcé son armée, relancé son économie et consolidé son avenir européen.
Oser écrire ça, c'est simplement rendre compte de la réalité. Et aucun argument d'autorité n'y changera rien.
🤪! M. heureux comme un « simple d’esprit » 🤪!
WTH 20 octobre 2025 à 10h21
La cour de justice (hors de question de mettre des majuscules) à l’égal du reste…
Claquée au sol la CJR ?
https://www.kinkytrampling.com/post_images/post-94.gif
changer les maths.
Manger les CHattes.
abcmaths 19 octobre 2025 à 17h27
Déqueulasse ! (Des queues lasses) Belle performance d’abcmaths.
https://xxgasm.com/wp-content/upload/2020/10/limp_cock_and-3433.jpg
Ces salopards de koalas baisent sans capote depuis des lustres et ils s’étonnent des conséquences…
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-taux-de-contamination-peut-aller-jusqu-a-80-chez-des-populations-en-australie-un-vaccin-anti-chlamydia-pour-sauver-les-koalas-20251003
Un vaccin ? IAL est contre…
Vol des bijoux, Louvre … Dugong (10h03) : « C’était juste une pub pour Kiloutou. »
Kiloutou « propose des matériels responsables qui participent à la réduction des émissions de CO2 et qui contribuent à la préservation de notre planète » et à « oeuvrer à un monde plus responsable ».
Bravo ! De plus, Kiloutou ne « propose » pas de chair (de préférence) fraîche.
« La vie heureuse est la vie conforme à la vertu (Aristote),
précepte auquel Dugong s’est efforcé de rester fidèle –
à l’inverse des « koalas ».
J’ai lu ça :
Le pénitencier de Sarko, c’est la Santé .
Ça alors, l’abus des élites aurait du bon ?
Oui…
(deux, faciles pour Lormier)
Le pénis entier ?
La bite des élus ?
Un mois au moins, c’est gros pour la taule !
Oui…
C’est fini, il ne dansera plus jamais, c’est ballot.
Oui…
Mendax 21 octobre 2025 à 12h37
Heureuses les simples d’esprit.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Rappel: Lormier ne sait pas ce qui se passe en Ukraine, qui « gagne »,qui « perd »; il sait seulement que beaucoup de Russes et d’Uktrainiens meurent.
« L’Ukraine, elle, a gagné en puissance militaire. Depuis 2022, l’armée ukrainienne a triplé son volume d’artillerie lourde et de défense antiaérienne occidentale. »
Sur ce point, vous semblez d’accord avec Poutine: la Russie ne se bat pas seulement contre l’Ukraine, mais contre une bonne partie de l’Occident qui fournit des armes, des satellites…
Sur Mearsheimer…j’aurais tendance à le croire sur un point:les exigences de Poutine sont telles qu’actuellement des négociations de paix (et même un cessz-le-feu) sont impossibles.
Trump ne voit pas d’intérêt (pour les EU) dans cette guerre. Il se désintéresse de l’Ukraine. Il a peut-être pris au sérieux l’avertissement de Poutine sur les armes à longue portée (type Tomahawk). La doctrine stratégique de la Russie a changé: une attaque massive sur le territoire russe peut entraîner une réponse nucléaire; ceux qui livreraient de telles armes seraient considérés comme partie prenante au conflit.
Je crois que Trump n’a pas du tout envie de se battre contre la Russie.
Quant à la situation politique intérieure de la Russie, Mendax semble avoir des informations. Poutine a certainement des ennemis…Sont-ils prêts à l’assassiner ?
Je n’ai pas d’information sur la politique intérieure de la russie.
Mearsheimer enfonce des portes ouvertes. C’est sa conclusion qui est dépourvue de fondement. Quant à dire que la russie se bat contre tout l’Occident, c’est le vieux mythe de la forteresse assiégée que ces pauvres types entretiennent depuis au moins deux siècles pour des raisons faciles à deviner. Désolé, je n’y souscris pas.
La proposition de Trump de vendre des Tomahawks à l’Ukraine est idiote depuis le départ : Ces missiles sont tirés depuis des sous-marins ou de destroyers. Or, l’Ukraine n’en a pas. À supposer que les Ukrainiens aient trouvé un moyen de les tirer depuis le sol, cela n’aurait pas changé grand-chose à ce qu’ils font déjà subir à la russie : pour un seul Tomahawk, il peuvent se payer trente FP-1, soit huit fois plus de charge d’explosifs. Et au moment où j’écris ces lignes, une trentaine de drones et une dizaine de missiles ukrainiens ont pénétré l’espace aérien de la région de Moscou. Non, la doctrine nucléaire de la russie n’a pas fondamentalement changé : Ce n’est ni la première ni la dernière fois que les Ukrainiens frappent dans la profondeur et l’apocalypse nucléaire que nous a promis le rat du Kremlin n’a toujours pas eu lieu.
Mais j’oubliais : « Ce n’est pas du bluff ». 🤯
Détails de l’histoire (et non Histoire) contée par le M. concernant… l’emploi des majuscules et minuscules :
passé de « SS » pour Russie, à « russie », mais suivi de… « Moscou » !
Il n’a pas d’info mais il sait qu’une « trentaine de drones et une dizaine de missiles ukrainiens ont pénétré l’espace aérien », « au moment où j’écris ces lignes » !
Sacré M. !
https://www.dialog.ua/war/322634_1761058951
Je parlais de la politique intérieure, coconne. Pour ce qui est de l’action militaire, je suis ça d’assez près. Vous en saurez plus demain, lorsque vos propagandistes préférés diront « même pas mal! »
merdre alors !
bis :
🤪! M. heureux comme un « simple d’esprit » 🤪!
gros pour la taule
Trop pour la Gaule
Dugong 21 octobre 2025 à 10h24
Ces salopards de koalas baisent sans capote…
Ah ça,dès que ça parle de maladie sexuellement transmissible, le rescapé de Treponemus africanus s’agite.
A noter:le bébé koala, dans la poche de sa mère peut être contaminé.
Les jolies colonies de vacances:
https://www.youtube.com/watch?v=lJPRxDAlYZc
Lost generation, si on observe ce qui est advenu.
il ne dansera plus jamais, c’est ballot.
il ne BanDera plus jamais, c’est Salaud.
il ne bande plus, il est incarcéré dans le quartier d’isolement, il ne peut donc même pas guetter la taule de son voisin, puisqu’il n’a pas de voisin, c’est salaud !
Oui…
Pourvu qu’il ne craque pas mentalement, parce que s’il ne bande plus et qu’il est fêlé, la libération va être compliquée, malgré le talent et la grande expérience de sa compagne.
Oui…
Il a emporté le livre « Le Comte de Monte-Cristo » paraît-il et heureusement aucun livre de Verne Jules.
Oui …
(au contraire des esprits forts de ce blog, la petiote Sarko qui vient d’avoir 14 ans – anniv fêté au George V – et « d’une immense intelligence » selon son frère Loulou, serait nezenmoins incapable de décoder le méchant abcm’!)
Lormier semble débordé, merci de pallier
Mendax 21 octobre 2025 à 18h02
La proposition de Trump de vendre des Tomahawks à l’Ukraine est idiote depuis le départ : Ces missiles sont tirés depuis des sous-marins ou de destroyers. Or, l’Ukraine n’en a pas. À supposer que les Ukrainiens aient trouvé un moyen de les tirer depuis le sol…
=========================================================
Ce sont les Américains qui ont mis au point (en 2023) des systèmes permettant de lancer des Tomahawk depuis le sol.
« The Army has developed a ground launcher called Typhon, which can launch Tomahawk missiles, among others. Since its initial testing in 2023, the system has been deployed to the Philippines in 2024 and has participated in military exercises in Australia and Japan this year. »
NB En fait, le principe de base est celui du lance-grille-pain de Dugong;l’échelle est dférente et il y a beaucoup d’ajouts.
https://www.csis.org/analysis/will-tomahawks-save-ukraine#:~:text=The%20Army%20has%20developed%20a,Source%3A%20U.S.%20Army.
Il me paraît évident que si Zelensky disposait de telles armes, la guerre changerait complètement de tournure.
Justement, Trump est revenu sur la proposition.
(remarque : Zélensk’ a encore changé de tenue, et de nouveau avec les félicitations de Trumpy ;
fini l’allure du combattant-ex(!)Président en treillis ! )
Les Typhons sont coûteux, très peu nombreux et Trump n’a jamais évoqué la possibilité d’en vendre aux Ukrainiens. Par conséquent, le problème du lancement demeure.
Non, les Tomahawks auraient été utiles mais n’auraient pas magiquement changé le cours de la guerre. Par rapport aux missiles SCALP, Neptune et Storm Shadow que possèdent déjà les Ukrainiens, les Tomahawks ont une portée beaucoup plus longue. C’est en gros l’équivalent américain du Kalibr que les russes utilisent à l’envi mais qui n’a pas modifié la dynamique de manière décisive.
Il n’y a pas d’armes magiques. Comme je vous l’ai déjà dit, la grande innovation de cette guerre, ce sont les drones. Et nous sommes désormais tous menacés : Que pourrions-nous faire si plusieurs nuées de drones venaient frapper des villes françaises ? Mais le problème est toujours le même : on peut investir massivement aujourd’hui dans la production d’une arme terrible pour laquelle on trouvera demain une parade efficace. L’UE investit désormais dans le projet d’un « mur de drones », mais qui sait s’il ne sera pas obsolète d’ici peu ?
Je répète encore votre phrase;quand vous l’avez écrite,vous ne connaissiez pas l’existence du Typhon.
Maintenant que vous la connaissez, vous changez d’argument: c’est très cher.
Mendax 21 octobre 2025 à 18h02
La proposition de Trump de vendre des Tomahawks à l’Ukraine est idiote depuis le départ : Ces missiles sont tirés depuis des sous-marins ou de destroyers. Or, l’Ukraine n’en a pas. À supposer que les Ukrainiens aient trouvé un moyen de les tirer depuis le sol…
Je connaissais l’existence des Typhons. Michel Goya en a parlé dans son dernier article et souligne déjà qu’ils sont onéreux, en quantité limitée et que de toute façon Trump n’a jamais évoqué la possibilité d’en fournir aux Ukrainiens – par conséquent, cet argument n’en est pas un et je n’ai pas besoin d’en « changer » puisque l’on revient au premier problème : même si d’hypothétiques Tomahawks étaient livrés, comment les Ukrainiens pourraient-ils les utiliser ? C’est bien pour ça que je n’ai pas évoqué l’existence de ces Typhons : leur existence ne change strictement rien à la situation. Trump proposait de livrer des boîtes de conserve sans ouvre-boîtes. Les ouvre-boîtes ont beau exister quelque part, qu’est-ce ça peut faire si on n’en aura jamais un seul entre les mains ?
En réalité, Trump n’a jamais eu l’intention de vendre des Tomahawks aux Ukrainiens. A-t-il FAIT la moindre chose pour aider concrètement l’Ukraine depuis son retour au pouvoir ? Bien au contraire, il n’a fait que favoriser la ruSSie, sous couvert de discours faussement agressifs à son égard, mais qui n’ont jamais été suivis d’actes significatifs. Et ça va continuer comme ça jusqu’à la fin de son mandat : il va aboyer, prétendre proposer des éléments concrets pour aider l’Ukraine, tout le monde fera mine de croire qu’il a « enfin compris » puis en définitive, il ne fera rien du tout, tout simplement parce qu’il ne peut rien faire à part essayer de grappiller du temps supplémentaire pour son grand copain le rat du Kremlin. Il aimerait beaucoup forcer Zelensky à signer un « deal » léonin en faveur de la ruSSie mais ne peut pas le montrer trop ouvertement parce qu’il sait très bien que même chez ses électeurs, un tel degré de traîtrise passerait mal, sans même parler du fait que les USA de Trump ne sont pas (encore) la russie de poutine et que les institutions gardent pour l’instant une marge de manœuvre et une indépendance assez grandes. Le second problème pour lui, c’est que l’Ukraine est VRAIMENT un pays souverain, voyez-vous, et que personne ne rejouera Munich ou Yalta tant que les Ukrainiens reçoivent du soutien.
Nous sommes bien obligés de composer avec lui mais cela ne nous oblige pas à surestimer son pouvoir.
Il n’y a pas d’armes magiques…mais les livraisons d’armes à l’Ukraine lui permettent de tenir.
Le but des « livreurs » n’est pas clair. Macron a l’air de penser (ou de vouloir donner à penser) que la Russie menace l’Europe occidenrtale et qu’il faut donc qu’elle soit « battue » par l’Ukraine
mais il n’est pas prêt à envoyer l’armée frnçaise en Ukraine.
Qunat aux autres membres de la « coalition des volontaires… »
Les EU ont plus ou moins retiré leurs billes…
guetter la taule
Téter la Gaule
Jean Noël Barrot, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ,vient d’annoncer un plan de livraisons d’armes à la Russie sur les trois ans à venir. Il est financé par un emprunt…emprunt garanti par (?) (ou qui sera remboursé grâce aux ?) avoirs russes gelés en Europe.
La guerre enrichit les Etats Unis (qui vendent les armes à l’Europe) affaiblit l’économie russe et
affaiblit aussi l’économie européenne.
Ha, ça…
Il y avait une solution très simple pour éviter ce bourbier, mais il fallait agir au bon moment.
Début 2022. Voire beaucoup plus tôt. Quand le rat a commencé à jouer au con avec la Géorgie.
Verne Jules.
VerGe Nulle.
Mendax 21 octobre 2025 à 18h57
https://www.dialog.ua/war/322634_1761058951
J’ai regardé;c’est un site ukrainien qui a publié ,en russe, une information relative à des attaques de drones sur la Russie.
Information sans doute vraie.
Mais incomplète.
Quels sont les dégâts réels ?
Il y a certainement des gens qui savent,oui, mais nous,nous ne savons pas.
On nous présente constamment des « informations » qui sont ensuite remises en cause.
Voyez l’affaire des gazoducs. Seymour Hersch, grand journaliste d’investigation,universellement reconnu et bla bla bla, nous livre un récit bien ficelé,bien convaincant: ce sont des troupes spéciales américaines,encore plus spéciales que les Navy Seals, qui ont fait le coup. Il nous raconte l’opération, le choix de la date, le camouflage…comme s’il avait été présent.
Quelques années plus tard,un tribunal inculpe des Ukrainiens.
Hersch a-t-il tout inventé ? S’est-il foutu de notre gueule ?
C’est bien possible. Sur cette question, nous ne savons pas grand-chose, dès lors, la prudence devrait être de mise.
Il n’empêche qu’il y a des informations difficilement contestables, parce qu’elles sont très largement documentées et que la majorité des personnes dans le monde s’accordent à considérer qu’elles sont vraies.
« Sur cette question, nous ne savons pas grand-chose »
Voulez-vous parler des gazoducs Nord Stream (ce serait « logique » puisque vous me répndez…) ?
Si oui, votre « C’est bien possible. » s’explicite ainsi: C’est bien possible que Hersch ait tout inventé et se soit foutu de notre gueule .
Donc, le célèbre, l’adulé Hersch ment et nous embobine. Ne lui faisons plus confiance.
Vous apportez de l’eau à mon moulin. A moins d’être agent de la CIA ,du Служба внешней разведки Российской Федерации,ou d’une institution de ce genre, on ne peut rien savoir de sûr et c’est pas marrant.
Ce qui est sûr, c’est que si c’est les Ukrainins,c’est pas des forces hyperspéciales américaines,venues hyper-spécialement des EU en Baltique. Et lycée de Versailles.
Pendant que j’y suis, je demande m^me si les gazoducs ont vraiment été cassés,tiens !
« Pendant que j’y suis, je demande m^me si les gazoducs ont vraiment été cassés,tiens ! »
« embobiner », « confiance »…
Y’en a des meilleurs que d’autres : ainsi le kolonel Goya(ve) qui s’essprimait sur certains plateaux, semble avoir disparu –
mais pas de la surface de la terre comme ce pauvre E. Dénécé qui ne racontait que des mensonges.
Quand les têtes bouillonnantes surchauffent, le gaz part…
Mendax 22 octobre 2025 à 5h39
Je connaissais l’existence des Typhons.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alors pourquoi avoir écrit le 21 octobre 2025 à 18h02
« La proposition de Trump de vendre des Tomahawks à l’Ukraine est idiote depuis le départ : Ces missiles sont tirés depuis des sous-marins ou de destroyers. Or, l’Ukraine n’en a pas. À supposer que les Ukrainiens aient trouvé un moyen de les tirer depuis le sol… » ?
C’est illogique.
Cela dit,
i) votre illogisme est modéré,donc tolérable
ii) L’illogisme dans ce genre de conversation sur le net ne me dérange pas particulièrement. C’est quand j’y suis confronté dans la vie réelle et que cela a des conséquences concrètes sur ma santé ou mon confort, que je suis obligé de dépenser de l’énergie pour le contre-carrer.
Je constate que les jeunes générations pataugent dans l’illogisme comme des hippopotames dans les bourbiers d’Afrique;c’est leur élément, elles y sont heureuses.
Je vous ai expliqué le raisonnement que j’ai fait : Je n’ai pas évoqué les Typhons parce que je savais qu’il y avait encore moins de chances que les Ukrainiens puissent en récupérer que d’avoir des Tomahawks et qu’à mes yeux ça revenait donc strictement au même. Tout ça pour gagner du temps, ce qui était manifestement un mauvais calcul de ma part puisque je dois maintenant me justifier. Mais j’étais bel et bien conscient de leur existence. C’est illogique, si vous voulez. En tout cas, j’ai perdu plus de temps que j’en ai gagné à éluder cet élément de la discussion.
Mendax 22 octobre 2025 à 5h44
Il y avait une solution très simple pour éviter ce bourbier, mais il fallait agir au bon moment.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Puisque vous avez lu Hegel (à la différence du Maestro) je suppose que vous admettrez que ce qui est advenu ne pouvait pas ne pas advenir.
Cela n’interdit pas la réflexion spéculative sur ce qui aurait pu se passer si…
Chose que vous faites de manière elliptique:
« il fallait agir au bon moment.
Début 2022. Voire beaucoup plus tôt. Quand le rat a commencé à jouer au con avec la Géorgie. »
Mearsheimer a une autre hypothèse. (Rappelons qu’il avait annoncé,bien à l’avance, l’invasion de l’Ukraine…ce qui donne un peu de crédit à ses analyses.)
Si les EU avaient cessé de provoquer l’ours russe (« poke the Russian bear in the eye ») c’est-à-dire cessé d’organiser de grandes manoeuvres militaires en Ukraine, Poutine n’aurait pas envahi.
Toujours selon Mearsheimer, la stratégie des présidents démocrates américains (« baiting and bleeding ») consistait à provoquer les Russes jusqu’ à ce qu’ils entrent en guerre, puis de faire durer cette guerre afin de faire tuer le plus possible de Russes et d’affaiblir le plus possible l’économie russe…sans bien sûr prendre part au conflit.
Apparemment, Trump a abandonné cette doctrine.
Il a hâte de s’entendre avec Poutine pour profiter des ressources de l’Ukraine. C’est un prédateur cynique qui, à propos de l’Irak, s’était indigné que les EU n’aient pas profité de la vicroire pour piquer le pétrole.
J’ai lu La Phénoménologie de l’Esprit, sans avoir la présomption d’avoir tout assimilé. En revanche, la dialectique du maître et de l’esclave, ça reste à ma portée.
Je ne me rappelle pas avoir lu chez Hegel la phrase que vous citez. Pour moi, cela ressemble plutôt à Diodore Kronos.
Quant à Mearsheimer, s’il a annoncé l’invasion de l’Ukraine AVANT 2014, tenez-moi au courant. Parce sinon, je suis aussi extralucide que lui : 2014, c’était déjà une invasion, et je savais que le nain scrofuleux ne s’arrêterait pas là.
En ce qui concerne la théorie du « bait and bleed », c’est un bon exemple de rationalisation a posteriori. Sur le plan logique, c’est assez fragile car cela suppose une capacité de contrôle des acteurs absolument stupéfiante (comment voulez-vous anticiper la façon dont réagiront les états que vous poussez à la guerre ? comment pouvez-vous être sûr que votre stratégie affaiblira les deux adversaires et pas d’autres acteurs ?) Sur le plan historique, nous n’avons aucune preuve de « bait and bleed » réussi : la plupart des exemples proposés par Mearsheimer sont largement discutables (et tous rationnalisés a posteriori, aucunement « prédits »). D’ailleurs Mearsheimer pensait que la guerre contre l’Ukraine affaiblirait l’OTAN : perdu, elle l’a renforcée. Enfin, sur le plan purement stratégique, le « bait and bleed » serait extrêmement hasardeux à long terme : En épuisant les autres, on déstabilise le système international dont on dépend soi-même.
Il existe pléthore d’autres exemples historiques qu’on a présentés comme inéluctables a posteriori pour des raisons controuvées : la crise de 1929 comme châtiment du capitalisme ou au contraire, la chute de l’URSS comme la preuve de son omnipotence. Ce sont de belles fictions mais elles restent fausses.
La théorie de Mearsheimer, c’est une machine à transformer la contingence en fatalité. De la métaphysique déguisée en science. Si Mearsheimer avait raison, la guerre d’Ukraine aurait clarifié le rapport de force mondial, mais si l’on regarde honnêtement, elle l’a dissous dans un chaos de conséquences imprévues.
Récré –
« Ces Français qui ne quittent jamais leur animal » (lefiga). Pffffff :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=774915952036218&set=a.162826603245159
Nord Stream,Thierry Mariani, au Parlement européen:
https://fr.linkedin.com/posts/thierry-mariani-41592a33_3-ans-apr%C3%A8s-le-sabotage-du-nord-stream-activity-7371216519818788865-gztU
Tout le monde sait que ce sont les navy seals maliens qui ont saboté les gazoducs en profitant de l’effet de surprise conféré par la saison des pluies.
Et si les gazoducs n’avaient,en fait,pas été saboté ?
s
Une petite plongée en mer baltique pour vérifier ?
https://www.lefigaro.fr/lyon/pres-de-lyon-une-mysterieuse-ecole-montessori-masque-t-elle-un-projet-d-ecole-musulmane-20251022
Les volets clos font plutôt penser à un bordel.
(« volets clos » en attente de moucharab(i)éhs ?)
Ce projet…a le soutien soutien du maire de Givors, Mohamed Boudjellaba.
Mendax 21 octobre 2025 à 10h48
le conflit se règlera par la mort de poutine.
Quand le rat du Kremlin sera enfin crevé, de mort naturelle ou moins naturelle, son successeur ne tardera pas à se désengager d’une guerre entreprise pour des motifs aussi monstrueux qu’imbéciles et qui coûte bien plus qu’elle ne peut désormais apporter à son pays. Ce n’est pas une prédiction, mais c’est bien ça le scénario le plus probable : poutine ne peut pas s’arrêter parce que ça signifierait la chute de son règne, mais son successeur ne pourrait pas se permettre de poursuivre exactement pour la même raison.
=========================================================
« de mort naturelle ou moins naturelle »
Des ennemis prêts à assassiner Poutine,pour prendre le pouvoir ? il faudrait qu’ils aient une masse de partisans.
Je n’en sais rien.
Le successeur ne pourra pas continuer la guerre.C’est sûr ? Que pensent les Russes de cette guerre ?
Eau de cuisson des pâtes:
Available languages:
English
Statement Oct 21, 2025 Brussels
Statement by President Zelenskyy, Prime Minister Starmer, Chancellor Merz, President Macron, Prime Minister Meloni, Prime Minister Tusk, President von der Leyen, President Costa, Prime Minister Støre, President Stubb, and Prime Ministers Frederiksen, Sánchez and Kristersson on Peace for Ukraine*
We are all united in our desire for a just and lasting peace, deserved by the people of Ukraine.
We strongly support President Trump’s position that the fighting should stop immediately, and that the current line of contact should be the starting point of negotiations. We remain committed to the principle that international borders must not be changed by force.
Russia’s stalling tactics have shown time and time again that Ukraine is the only party serious about peace. We can all see that Putin continues to choose violence and destruction.
Therefore we are clear that Ukraine must be in the strongest possible position – before, during, and after any ceasefire. We must ramp up the pressure on Russia’s economy and its defence industry, until Putin is ready to make peace. We are developing measures to use the full value of Russia’s immobilised sovereign assets so that Ukraine has the resources it needs.
Leaders will meet later this week in the European Council and in the Coalition of the Willing format to discuss how to take this work forward and to further support Ukraine.
* Updated on 21 October 2025 at 16:28 CEST.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_2454
» Statement by President Zelenskyy, Prime Minister Starmer, Chancellor Merz, President Macron, Prime Minister Meloni, Prime Minister Tusk, President von der Leyen, »
Etc
Curieux l’ordre de présentation, pas alphabétique, pas protocolaire ( les présidents devraient passer avant les PM) – Zelensky ( ici ecrit avec 2 y) est en premier, honneur au principal concerné ?
Oui, c’est curieux,cet ordre.
L’eau de cuisson des pâtes ne doit pas être jetée car Maestro & Lointain lecteur dixerunt, elles servent à d’autes préparations…comme (si je ne m’abuse) celle des pâtes à la carbonara.
Mais si un texte a l’épaisseur et la consistance d’une eau de cuisson,on ne peut en faire grand chose sinon s’en gausser. (NB Certains arguments de Mendax sur les prétendus vaccins contre le covid avaient cette consistance.)
Ils sont partisans d’un cessez-le-feu immédiat…mais il est impossible qu’il ait lieu dans les circonstances actuelles.
Ils veulent que l’Ukraine soient dans la position la plus forte possible…mais cette position la plus forte possible est une position de faiblesse.
Il n’y a aucun autre moyen de renforcer la position de l’Ukraine que d’entrer en guerre contre la Russie. Eux parlent d’un énième paquet de sanctions aors que Poutine s’en balek.
Etc.etc.
Oui, c’est curieux,cet ordre.
L’eau de cuisson des pâtes ne doit pas être jetée car Maestro & Lointain lecteur dixerunt, elles servent à d’autes préparations…comme (si je ne m’abuse) celle des pâtes à la carbonara.
Mais si un texte a l’épaisseur et la consistance d’une eau de cuisson,on ne peut en faire grand chose sinon s’en gausser. (NB Certains arguments de Mendax sur les prétendus vaccins contre le covid avaient cette consistance.)
Ils sont partisans d’un cessez-le-feu immédiat…mais il est impossible qu’il ait lieu dans les circonstances actuelles.
Ils veulent que l’Ukraine soient dans la position la plus forte possible…mais cette position la plus forte possible est une position de faiblesse.
Il n’y a aucun autre moyen de renforcer la position de l’Ukraine que d’entrer en guerre contre la Russie. Eux parlent d’un énième paquet de sanctions aors que Poutine s’en balek.
Etc.etc.
Mendax 22 octobre 2025 à 15h33
En tout cas, j’ai perdu plus de temps que j’en ai gagné à éluder cet élément de la discussion.
Ce n’est pas grave. Et je vous ai déjà dit que l’illogisme ne me dérange pas particulièrement dans les discussions sur le net. J’ajoute que vous êtes loin d’être le plus illogique des commentateurs.
Bon, vous n’avez pas simplement « éludé », vous avez laissé entendre qu’il n’existait pas de système de lancement à partir du sol ,que les Ukrainiens fabriqueraient peut-être un dispositif permettant ce type de lancer…alors que vous connaissiez l’existence du Typhon.
Et comme je vous prends au sérieux…
Dugong 22 octobre 2025 à 13h53
Les volets clos font plutôt penser à un bordel.
Les bordels que vous fréquentez en Afrique avaient sans doute des ouvertures dissimulées derrière des feuilles (de bananier ?)
N’y pensez pas trop souvent;vous vous faites du mal. Ca ne sert à rien de regretter.
fréquentIez
(oui ! Et Zélensk’ n’est plus… qu’ex-Président)
(« coalition of willing » – 😅 – La gueguerre continue :
« En Hongrie et en Roumanie, deux raffineries de pétrole liées à la Russie touchées par un incendie et une explosion »
« Les pompiers hongrois ont rapidement maîtrisé l’incendie de la première et aucun blessé n’a été signalé.
L’explosion de la seconde a grièvement blessé un travailleur… »
(lefigaro)
Lormier 22 octobre 2025 à 14h34
Le successeur ne pourra pas continuer la guerre.C’est sûr ? Que pensent les Russes de cette guerre ?
***********************************************************
Non, rien n’est sûr, évidemment.
Pour ma part, je suis convaincu que la fin de la guerre est d’abord conditionnée par la fin de poutine. Il a désormais besoin d’une guerre permanente pour maintenir sa longévité au pouvoir. Il ne peut pas gagner mais il s’en fiche : en ruSSie, il est bien plus puissant aujourd’hui qu’en 2022. Et l’autre débile lui déroule le tapis rouge quand il l’accueille à Anchorage. Par conséquent, le rat du Kremlin peut s’estimer personnellement gagnant même s’il a mis son pays dans une mouise pas possible.
Je ne sais pas ce que pensent les russes, mais la disparition de leur tyranneau ne pourrait que leur être bénéfique. Certes, il est toujours possible qu’il soit remplacé par quelqu’un de « pire », mais si son successeur est rationnel, il aura tout intérêt à arrêter la guerre. Je reconnais que la condition nécessaire d’un tel scénario est loin d’être garantie, avec le nombre de tarés qui prétendent au trône.
Un moment,je me suis demandé si vous n’étiez pas affilié à la CIA. Si vous l’étiez, vous seriez bien mieux renseigné.
De temps en temps, quand,par exemple, je monte à la capitale, je vois des Russes. Ils n’ont pas l’air de s’en faire.
Un jour c’était dans un train: un groupe d’adorables petits mouflets,très sages, très mignons dans leurs tenues colorées. J’ai demandé à une de leurs accompagnatrices qui ils/elles étaient;réponse:des gymnastes venus participer à une compéttition de gymastique rythmique.
Plus récemment, route de campagne;une camionette croyait pouvoir passer sous un pont,sous une voie ferrée…s’est arrêtée à temps. J’entends parler russe;j’aborde la personne,lui bredouille quelques mots; il me demande où j’ai appris, complète mes phrases quand je cherche mes mots (c’est très russe,ils enseignent en permanence). A la fin, il me serre la main spontanément. Nous n’avons pas parlé de l’Ukraine. Je suis sûr qu’il n’était pas venu pour poser des explosifs.
camionnette
J’ai très longtemps travaillé avec des russes. Plus maintenant.
Je ne sais pas ce que pense le servum pecus. Mais ceux avec qui j’ai travaillé étaient tous nationalistes. Tous.
Comme les Ukrainiens. Les Slaves, de façon générale.
Les Japonais sont au moins aussi nationalistes que les Russes ;je m’entends très bien avec ces deux ethnies. J’aime qu’on aime son pays.
Les russes sont nationalistes. Les Ukrainiens sont patriotes.
Je pense que vous connaissez la citation de De Gaulle à ce sujet.
à 🤪! M. : France, copie conforme ?
« Par conséquent, le rat – de l’Elysée – peut s’estimer personnellement gagnant même s’il a mis son pays dans une mouise pas possible. »
« Je ne sais pas ce que pensent les – Français – , mais la disparition de leur tyranneau ne pourrait que leur être bénéfique. »
« Certes, il est toujours possible qu’il soit remplacé par quelqu’un de « pire »,
mais si son successeur est rationnel… »
« Je reconnais que la condition nécessaire d’un tel scénario est loin d’être garantie, avec le nombre de tarés qui prétendent au trône. »
(exception faite du « tapis rouge » :
« l’autre débile, quand il l’accueille » – le loque-à terre de l’Elysée -,
… il ne fait que se moquer de lui – et il y a de quoi !)
(« avec le nombre de tarés qui prétendent au trône » :
«Un acte d’amour pour la France» : Marine Tondelier annonce sa «candidature à l’élection présidentielle»
lefigaro – 😂)
Excellent:ça colle parfaitement. C’est le rêve du menuisier:la queue d’aronde parfaitement ajustée.
(Lormier : le Dr Malone interviewé par Bercoff, 20 oct:
« Ça a été très controversé quand j’ai dit que la Spike était une toxine. Et une toxine est quelque chose qui est toxique, c’est fondamental ! Je trouve fascinant que l’on nie que c’est une thérapie génique. »)
Si y a encore des abrutis pour dire que la spike n’est pas pathogène, je m’en tamponne. Ces cons ne peuvent pas dire qu’elle n’est pas étrangère.
Ca me fait penser à ce conseiller d’ambassade qui disait qu’un camion de 40 tonnes n’était pas nécessairement plus gros qu’un camion de 20 tonnes. L’Anglais lui a répondu qu’il était plus lourd.
Comment peut-il être sans danger pour l’organisme de lui faire produire en quantité incontrôlable et incontroôlée une protéine étrangère ?
de l’intérêt d’oublier de préciser « à elle seule »
Selon Zelensky, quand les Russes pensaient que les EU allaient livrer des Tomahawks à l’Ukraine,ils étaient plus enclins à chercher une solution diplomatique. Maintenant que s’éloigne
cette possibilité,ils redeviennent plus agressifs.
Zelensky dit clairement que les Tomahawks lui auraient pemis de taper plus profondément en Russie des cibles militaires et civiles (raffineries, centrales électriques etc.).
Zelensky: Trump holding back Tomahawks deflated Russia’s interest in diplomacy
by Filip Timotija – 10/21/25
Ukrainian President Volodymyr Zelensky argued Tuesday that President Trump’s decision to refrain from sending long-range Tomahawk cruise missiles to Ukraine deflated Russia’s interest in engaging in diplomacy that could lead to the potential end of the war in Eastern Europe.
“The front line can spark diplomacy. Instead, Russia continues to do everything to weasel out of diplomacy, and as soon as the issue of long-range capabilities for us — for Ukraine — became less immediate, Russia’s interest in diplomacy faded almost automatically,” Zelensky said during his daily video address. “This signals that this very issue — the issue of our deep strike capabilities — may hold the indispensable key to peace.”
https://thehill.com/policy/international/5565765-zelensky-ukraine-tomahawk-missiles-russia/
Trump n’aime pas Zelensky mais il veut à tout prix le prix Nobel de la paix.
Pour cela, il doit arrêter cette guerre, que ce soit sur les lignes actuelles ou plus loin, il s’en fout. S’il pouvait, il « donnerait » toute l’Ukraine à son pote le rat. Mais il ne peut pas forcer Zelensky à signer. Et politiquement, faut dire que ça passerait mal.
Il doit donc amener le rat à la table des négociations.
Or, le rat, il ne veut pas négocier. Il n’a jamais voulu négocier. Chez nous, ça signifie simplement commencer à discuter, peut-être voir si on peut éventuellement trouver un terrain d’entente sur certains détails, mais comme je l’ai maintes fois expliqué, pour un russe, « négocier », ça veut dire perdre la face.
Et le rat, il ne peut pas se permettre de perdre la face, parce que la guerre, c’est justement ce qui maintient à la tête de son pays pourri ; donc, il fait réitérer par sa larve Lavrov les mêmes exigences maximalistes et irréalistes que depuis trois ans.
Alors Trump essaie de lui faire peur en parlant de livrer aux Ukrainiens des armes qui leur permettraient de taper plus loin dans la profondeur. Mais il n’a aucunement l’intention de le faire, hein, faut pas déconner. Il y a la question du lancement, dont j’ai déjà parlé, celle des Typhons, chers et peu nombreux, ah, et puis Trump précise aussi que les Tomahawks, l’Amérique en a quand même besoin pour elle-même. C’est vous dire à quel point cette proposition était sérieuse. On a d’ailleurs déjà vécu ça avec les Taurus allemands, sorte de version militaire d’En attendant Godot. Et finalement, Trump dit que non, il ne va pas livrer les Tomahawks. Ou peut-être si, un jour, qui sait ? Cette communication, elle ne concerne en rien les Ukrainiens, elle est destinée uniquement à son pote le rat. Cela permet de temporiser, parce que c’est tout ce que le rat peut encore espérer à ce point de la situation catastrophique dans laquelle il s’est lui-même foutu – au théâtre, on appelle ça l’ironie tragique.
Et puis le rat fait réitérer une énième fois ses exigences maximalistes par ses sbires.
Mon opinion – je peux me tromper – c’est qu’on est très, très loin de voir un jour les Tomahawks en Ukraine. Qui, encore une fois, ne changeraient pas le rapport de forces de façon déterminante, à mon humble avis. Il permettraient peut-être de cibler les usines de Shahed et de soulager ainsi la population civile, mais pas d’amener la russie à la table des négociations.
Il y a peut-être davantage d’espoir du côté du Congrès et du Sénat, qui travaillent sur de nouvelles sanctions. En attendant, les Ukrainiens ont bien compris qu’ils devaient avant tout compter sur eux-mêmes.
Ce sont bien les propos de Zelensky
https://www.president.gov.ua/en/news/liniya-frontu-mozhe-buti-pochatkom-diplomatiyi-zvernennya-pr-100889
Un exemple parmi d’autres du nationalisme russe :
https://www.franceinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/la-commissaire-aux-droits-de-l-enfant-russe-se-vante-d-avoir-corrige-les-penchants-pro-ukrainiens-de-son-fils-adoptif-originaire-de-marioupol_7568221.html
Tata Tondelier et Furoncle lfi lancent la machine à perdre
https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/10/22/presidentielle-2027-marine-tondelier-se-presente-candidate_6648904_823448.html
Son goût pour les vestes ( vertes) est de bon augure…
« Un acte d’amour pour la France » : l’autre Marine en veste verte.
Tous en prison (et ils sont si nombreux que la Santé n’y suffirait pas),
sans oublier une fouille minutieuse, au cas où le mongolito tenterait, par tous les moyens, de cacher sa montre.
https://pbs.twimg.com/media/GO6LUiKXIAAI_u8?format=jpg&name=medium
J’aime bien le type derrière lui… et son regard.
répétez après moi : non, l’islamogauchisme n’existe pas…
Le M. : « Trump… veut à tout prix le prix Nobel de la paix »
Trumpy prépare donc le terrain… :
https://www.youtube.com/watch?v=W6GgLtg71mE
Pour changer d’univers (et scandaliser Zorglub qui déteste ce gente de vidéos) l’empereur du Japon procède à la nomination d’une nouvelle Première ministre – la première femme à exercer cette fonction – une conservatrice de choc semble-t- il …
et dans la foulée tous les nouveaux ministres viennent recevoir leur nomination.
Festival de salutations, dans un décor zen. La façon de tenir le document à bout de bras est curieuse.
https://www.youtube.com/watch?v=0r6jE9Fk7L8
Profond respect des traditions…
cf aussi la profonde révérence d’une princesse.
Pendant ce temps, chez les Brits, Andrew est privé de son titre royal, tandis que les corgis de feue sa majesté, gardés par l’affreuse Sarah, sombrent dans la tristesse et la honte.
https://histoiresroyales.fr/wp-content/uploads/2025/10/princesse-heritiere-victoria-diner-empereur-naruhito-imperatrice-masako.jpg
Tradition, chasses, fêtes, profond savoir-vivre.
Oui…
Pourquoi,encore, de notre gueule,vous foutez-vous ?
Le monte-meuble qui a permis le vol de bijoux au Louvre n’a pas été loué,mais volé . Il est de la marque Boeckermaschinen qio a saisi l’occasion pour se faire une belle pub.
Elle a publié une photo de l’engin devant l Louvre,avec la légende:
Wenn’s mal wieder schnell gehen muss (Quand il faut faire vite)
Familienunternehmen Böcker nutzt Louvre-Einbruch als Marketing-Gag
Der Diebstahl der Napoleon-Juwelen ging um die Welt. Ein deutsches Unternehmen zeigt, dass es mit Humor die Aufmerksamkeit zu nutzen weiß.
22.10.2025 – 08:59 Uhr
https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/juwelendiebstahl-boecker-nutzt-louvre-einbruch-als-marketing-gag/100166564.html
On a parlé de monte-meuble.
Voici la gamme de monte-meubles Boecker…Je ne vois pas le modèle utilisé au Louvre…Ce serait plutôt un camion-grue (la partie « levage » étant solidaire du camion).
A noter:certains de ces engins sont dotés d’un lance-grille-pain;cela permet de casser un carreau à distance.
https://boecker.de/de/produkte/moebelaufzuege
C’est un Agilo; les voleurs avaient étudié lespetites annonces pour en trouver un à vendre;ils se sont présentés comme acheteurs potentiels et ont volé l’engin au malheureux entrepreneur.
Caractéristiques de l’Agilo:
Agilo
Product description
Le monte-meubles Agilo convainc par une combinaison sur mesure d’ascenseur et de véhicule. Sa force particulière réside dans une mobilité inégalée, qui permet un montage rapide et un changement rapide de lieu d’utilisation. Grâce à ses performances de premier ordre, il vient à bout des projets de déménagement les plus exigeants. Pour le transport puissant de meubles jusqu’aux étages les plus élevés, l’Agilo atteint des hauteurs vertigineuses jusqu’à 55 m, selon le modèle. Avec des vitesses de chariot allant jusqu’à 42 m/min, l’ascenseur extérieur effectue l’évacuation ou l’introduction de meubles en un temps record. Même les charges lourdes et encombrantes pesant jusqu’à 400 kg trouvent leur place sur son plateau spacieux.
En ce qui concerne le confort, le monte-meubles convainc par sa faible hauteur de chargement grâce à la rallonge inférieure extensible. Pendant le fonctionnement, le déplacement particulièrement silencieux du chariot ménage les marchandises transportées. L’Agilo est entraîné soit par la prise de force auxiliaire du camion, soit par un moteur à essence Honda, soit par un moteur électrique. Un moteur électrique 230 V supplémentaire est disponible pour travailler dans les zones résidentielles avec un minimum d’émissions. En outre, l’Agilo est disponible en tant qu’ascenseur entièrement électrique avec batterie. Il évite les émissions de CO2 aussi bien sur la route que lors du transport des meubles et est très silencieux lors de son utilisation.
https://boecker.de/fr/produits/monte-meubles/details/agilo
La pub (on note que l’engin de levage est actionné par un moteur électrique,ce qui évité d’^tre interpellé pour bruit et pollution en zone résidenteielle-historique).
https://entrevue.fr/wp-content/uploads/2025/10/cebd2c59e51bd27845050aebf712bd53.jpg
Slogan d’aide pour votre thèse sur la pub de Boecker:
Avec cet engin, fini l’azote et les mobs !
Oui…
(deux)
Le ministère de la culture devrait embaucher des sous-mariniers capables de (re)connaître la signature du bruit émis par un engin Boecker immergé dans celui de la circulation ambiante.
chasses, fêtes,
chaTTes, feSSes,
ECHO 23 octobre 2025 à 11h13
Festival de salutations, dans un décor zen.
https://www.youtube.com/watch?v=0r6jE9Fk7L8
On trouvera sans doute Lormier vétilleux-peu lui chaut- mais certaines courbettes sont loin d’être parfaites, pas à l’équerre, dos plat,horizontal, parallèle au plancher.
fini l’azote et les mobs
fini l’zoB et les moTTes
rectificatif
fini l’zoB et lA moTTe
Faux.
et pourtant le permutations sont correctes
t permute avec b et le a d’azote est déplacé de « azote » à la motte
Et le é de les ? Que devient -il ?
Fini les zobs et la motte.
Encore un effet inattendu du prétendu vaccin:atteinte aux reins.
https://link.springer.com/article/10.1007/s13730-025-00989-0
Vraiment, le Professeur Bani Sadr,du CHU de Reims a bien raison:sans une expérimentation à grande échelle sur cobayes humains, comment voulez-vous qu’on sache quels dégâtes l’ARN messager artificiel est capable de provoquer ? On en découvre de nouveaux tous les jours.
thèse sur la pub
Baise sur la puTE
Tomahawks… Conférence de presse à la Maison Blanche. Répondant à une question, Trump explique:
a) armes très techniques;il faut un an pour apprendre à s’en servir
b) il faudrait que ce soit nous qui venions en Ukraine tirer contre la Russie. Et ça non
c) On veut pas non plus enseigner à d’autres comment s’en servir.
Donc proposition enterrée au moins pour un certain temps.
Trump explique pendant que d’autres s’accoutrent ? C’est ça que vous sous-entendez ?
Oui…
Tomahawks… armes très techniques…
Quelle cuisson ?
Dugong 23 octobre 2025 à 12h27
de l’intérêt d’oublier de préciser « à elle seule »
Pathogènicité de la protéine… C’est un peu compliqué mais,en réfléchissant cinq minutes on comprend très bien.
Laissons de côté (pour le moment ) la protéine spike libre,qui se promène librement dans tout l’organisme.
Considérons plutôt la spike apparue à « la surface » de la celulle qui l’a produite.
Pour le système immunitaire,ce truc « cellule+spike » est étranger,donc ennemi, donc doit être détruit.
Quand des cellules cardiaques présentent une spike, vous aurez une myocardite ou une péricardite auto-immune.
Avec des cellules nerveuses, vous aurez par exemple une myélite
C’est ça le miracle du vaccin: il n’y a pas de ciblage;à peu près n’importe quel type de cellule peut se mettre à fabriquer de la spike;ainsi n’importe quelle partie de l’organisme peut être attaquée.
Ce mécanisme de déclenchement de maladie auto-immune a notamment été décrit en termes simples par Panagis Polykretis, à Bruxelles, lors du lancement du mouvement Make Europe Healthy Again
Il avait co-écrit un article scientifique sur le sujet,qu’on peut lire ici.
https://sostelemedicina.ucv.ve/documentos/manuales/Reacciones%20inflamatorias%20autoinmunes%20desencadenadas%20por%20las%20vacunas%20geneticas%20COVID-19%20en%20tejidos%20terminalmente%20diferenciados.pdf
Les apprentis-sorciers injectent dans l’organisme de l’ARN messager artificiel, le message envoyé aux cellueles étant:fabriquez moi cette protéine étrangère dont l’organisme n’a aucun besoin, que jamais il n’aurait produite de lui-même … et vous croyez que tout va forcément bien se passer ?
Bon, les myocardies/péricardites,c’est fait;affaire entendue, officiellement c’est reconnu, estampillé « science » ;oui causé par le vaccin…
Y a plein d’autres effets indésirables …
Le gros morceau, ce sont les cancers pace que là les néo-mengeléiens freinent des quatre fers. Vous comprenez le cancer c’est le truc le plus abominable. Alors pour des médecins officiels reconnaître qu’ils ont provoqué des cancers,c’est trop dur.
Comment le vaccin provoque-t-il des cancers ? Il y a plein d’hypothèses…La recherche est entravée;quiconque se lance se heurte à un mur. Les grands journaux (financés par Gates et Big Pharma) refusent de publier.
La première chose: comment se fait-il que l’ARN messager (truc étranger) ne soit pas détruite par le système immunitaire ?
C’est justement la raison pour laquelle on utilise de l’ARN artificiel,qui échappe à la surveillance immunitaire.
Il en est qui disent (je ne sais pas sur quoi ils se fondent) que cet ARN artificiel met le système immunitaire en pause…
Comme l’un des rôles du système immunitaire est de détruire les cellules non-conformes, voire cancéreuses (que nous fabriquons sans cesse) ,si l’hypothèse est juste , l’apparition ou le réveil de cancers s’explique très bien rien que par ça.
Notons qu’en Israël, dès les premières semaines d’injections,ont été notés de nombreux zonas;le zona est un symptome typique de l’immuno-suppression.
Mais la plupart des données israéliennes ont été perdues.
Mendax 23 octobre 2025 à 4h36
« … le rat, il ne peut pas se permettre de perdre la face, parce que la guerre, c’est justement ce qui maintient à la tête de son pays pourri… »
=========================================================
Je ne connais pas Poutine…je n’ai pas ,a priori, de grande sympathie pour lui et je comprends très bien qu’on puisse le traiter de « rat ».
Je comprends aussi que, sur le champ de bataille, un soldat traite ceux qui lui tirent dessus d' »orcs ».
En revanche, je n’accepte pas qu’on jette « l’eau propre » sur tout un peuple.
Non, je regrette, « pays pourri », ça me reste en travers de la gorge.
Que savons-nous des Russes, du citoyen russe lambda ? Est-il solidaire de Poutine ? Est-il opprimé par Poutine ? Par le système poutiniste ?
La France et la Russie ont des siècles d’amitié et d’échanges fructueux derrière elles;je voudrais que cette guerre se termine et que notre histoire commune reprenne.
IAL est bien placé pour obtenir un poste d’analyste-surveillant au centre spirituel et culturel russe à Paris. Nul doute que ses compétences d’antenniste seront exploitées au mieux des intérêts de l’Ursidéré
Absence de démocratie, contrôle des médias, répression des libertés, corruption endémique, politique étrangère agressive depuis au moins trois siècles, droits humains systématiquement bafoués, inégalités socio-économiques massives, taux de suicides parmi les plus élevés au monde, idem pour les contaminations au VIH, alcoolisme généralisé, criminalité domestique partiellement dépénalisée…
Mais oui, vous avez raison, les russes aiment leurs pays. Difficile de trouver des raisons objectives à cet amour, mais… c’est le propre de l’amour, après tout.
Mendax 23 octobre 2025 à 4h36
« … le rat, il ne peut pas se permettre de perdre la face, parce que la guerre, c’est justement ce qui maintient à la tête de son pays pourri… »
=========================================================
Regardons de l’autre côté,maintenant.
Zelenskyy a-t-il le soutien unanime du peuple ukrainien ? Ou bien ,a-t-il besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir ?
Et d’abord, comment définit-on le « peuple ukrainien » ? Les Russophones vivant sur le territoire ukrainien font-ils partie du « peuple ukrainien » ?
Lors de la fameuse rencontre à la Maison Blanche où Trump a reproché à Zelenskyy son accoutrement et son manque de gratitude, Vance a rappelé que Zelenskyy envoyait des officiers recruteurs dans les rues enrôler de force dans l’armée des citoyens récalcitrants .
Ceux-là ne sont probablement pas des partisans de Zelenskyy.
Evidemment, les Ukrainiens en âge de combattre qui ont les moyens d’attendre la fin de la guerre dans leur résidence monégasque n’ont rien à craindre de Zelenskyy.
Ce Zelenskyy (je sais que c’est bête de dire cela) ,moi, j’vais vous dire, « j’le sens pas ».
C’est un mec du show biz dont les spectacles n’étaient pas tellement ragoutants.
Je ne sais pas combien de villas et immeubles il possède en Floride et sur la Méditerranée mais enfin, il en a bien quelques uns.
Achetés avec quel argent ? Il est à la tête d’un des pays les plus corrompus du continent. Est-il blanc comme neige ?
Un tapis blanc comme s’était écrié un africain voyant de la neige pour la première fois
Sur le domaine ?
Compris. Vous faites une fixette sur Zelensky. Comme Gérard en son temps et beaucoup d’autres.
Je vous donne mon point de vue à moi qui ai l’occasion de parler régulièrement avec des Ukrainiens et des Ukrainiennes.
Ce que j’ai constaté, c’est que PERSONNE parmi ces gens n’admire particulièrement Zelensky. PERSONNE parmi les gens à qui j’ai parlé n’a déclaré avoir voté pour lui. Certains sont même extrêmement critiques à son égard en ce qui concerne la politique intérieure. Et même parfois sur les décisions militaires.
Mais il faut bien comprendre que si ce n’était pas Zelensky, eh bien ce serait quelqu’un d’autre mais que ça ne changerait rien sur le fond : à une très grande majorité, le peuple ukrainien veut que les russes rentrent chez eux. C’est comme ça. Ils ne veulent plus endurer la férule impérialiste de ces connards – et ils ont de bonnes raisons historiques pour cela. Vous voulez reparler des minorités russophones ? Zelensky en faisait partie, il a appris l’Ukrainien sur le tard. Dans un pays, ce ne sont pas les minorités qui décident, je pense que vous serez d’accord avec ça.
Quant à moi, je n’ai pas non plus une admiration excessive à l’égard de Zelensky mais je constate qu’il n’a pas abandonné son pays quand il a été envahi et qu’il a fait son maximum pour contenir cette invasion. C’est objectivement une preuve de courage. Comme il tient tête à un criminel de guerre que beaucoup de gens ici prennent pour un « homme fort » (ce qu’il n’est pas – c’est un homme brutal, ce qui est très différent), cela les irrite beaucoup parce que cela bouleverse considérablement leur système de déchiffrement du monde. Comment ? Quelqu’un résiste à l’homme fort ? Mais c’est impossible ! L’homme fort ne peut pas perdre.
La réaction de défense est toujours la même : le dénigrement et la calomnie. Faites-vous plaisir : entre le taulier qui annonçait il y a deux ans que l’Ukraine allait forcément perdre et que Zelensky allait partir bronzer à Ibiza, Cyrano qui prophétisait en mars ou en avril de cette année qu’il ne finirait peut-être même pas le mois, la rombière qui se croit très fine en pérorant à qui mieux mieux qu’il n’est pas légitime et Gérard qui rappelait régulièrement que le président ukrainien n’est qu’un clown qui joue du piano avec sa bite… vous croyez vraiment que ça a le moindre effet sur sa notoriété ? Ces calomnies n’amoindrissent pas la stature de Zelensky : elles la renforcent ! Dans leur majorité, les gens ne sont pas idiots : quand un petit se fait tabasser par un grand et que le petit résiste, ils prennent le parti du petit, même si tout le monde raconte que le petit a triché au dernier contrôle de maths. Et d’autant plus lorsque le petit devient tout à coup capable de flanquer une vraie raclée au grand.
Mais je conçois que ça puisse induire des phénomènes de dissonance cognitive chez les admirateurs de la force brute. C’est pas évident d’admettre que la vision qu’on avait de la situation était complètement fausse.
« le petit a triché au dernier contrôle de maths »
Ca c’est très mal et devrait valoir une traination des parents devant un tribunal adécouate.
Voyez IAL !
Pour un rat, perdre la face, c’est plutôt une élévation.
Lormier
Lors de la fameuse rencontre à la Maison Blanche où Trump a reproché à Zelenskyy son accoutrement et son manque de gratitude, Vance a rappelé que Zelenskyy envoyait des officiers recruteurs dans les rues enrôler de force dans l’armée des citoyens récalcitrants
Certes, mais la plupart des pays en guerre ont contraint leurs citoyens a combattre- la GB pendant la guerre de 14 avait commencé par compter sur le volontariat et puis en 1916 a etabli la conscription.
Et la France a quasiment invente la conscription
Je ne crois pas que l’obligation de recourir à la contrainte soit particulièrement un signe que ke régime ukrainien est » lâché » par la population, mais une réalité qui s’impose a tout peuple ( ou tout Etat) en guerre .Même les USA y ont eu recours durant la guerre du Viet Nam alors que ce conflit n’était pas une menace sur leur territoire.
Argument recevable et bien reçu.
Y a quand même des images de « kidnapping » musclé en pleine rue. Parfois les personnes présentes parviennent à faire fuir les recruteurs; Il y aurait aussi du kidnapping de mômes sur les terrains de jeux. Les mômes serviraient de monnaie d’échange.
Tout cela peut aussi être entièrement inventé.
Pensns aussi aux religieux fidèles à l’orthodoxie moscovite qui collaborent avec les Russes.
Peuple uni derrière Zelenskyy ? J’ai des doutes et j’me comprends.
Argument recevable et bien reçu.
Y a quand même des images de « kidnapping » musclé en pleine rue. Parfois les personnes présentes parviennent à faire fuir les recruteurs; Il y aurait aussi du kidnapping de mômes sur les terrains de jeux. Les mômes serviraient de monnaie d’échange.
Tout cela peut aussi être entièrement inventé.
Pensons aussi aux religieux fidèles à l’orthodoxie moscovite qui collaborent avec les Russes.
Peuple uni derrière Zelenskyy ? J’ai des doutes et j’me comprends.
Dugong 24 octobre 2025 à 8h20
Le ministère de la culture devrait embaucher des sous-mariniers capables de (re)connaître la signature du bruit émis par un engin Boecker immergé dans celui de la circulation ambiante.
=========================================================
Fallit juste éviter de se servir d’un engin de levage actionné par un moteur à explosion pétaradant-qui aurait pu susciter verbalisation pour pollution sonore et gazeuse en zone hitorico-touristique.
La ruse des voleurs (être super-visbles ) me rappelle un peu les calcul des prisonniers dans
Le Trou de Jacques Becker ( 1960). Les mecs cassent le plancher;ils se foutent du bruit d’enfer parce que ,justement, ils pensentr qu’il est tellement fort que les surveillants ne soupçonneront pas une tentative d’évasion et croiront à des « travaux ».
Même topo pour les boeckeriens;ils sont tellement visbles que tout le monde croit qu’ils
travaillent pour le musée (déménagement d’une pièce par exemple).
Des cinéphiles, sans doute.
Mais personne n’a appelé la police quand on a vu ce qu’ils faisaient,à l’intérieur ?
https://www.cinematheque.fr/article/1001.html
Dugong 24 octobre 2025 à 8h59
« …au centre spirituel et culturel russe à Paris. »
Avez-vous l’adresse ?
GlouGlou y pourvoira
« GlouGlou »…
La tempête « Benjamin » : aurait-il été plus discret de la nommer « Bibi » ?
Osera-t-on « Vlad » pour la prochaine ?
Encore une question, etc….
Pas de tempête prévue en Côte d’Ivoire : il semblerait que Ouattara s’avance vers un 4ème mandat.
Sur cette photo (Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix, 19 oct 25)
difficile de nier qu’il fait vraiment la paire (et très bien la pub) avec sa Blonde –
(😁)
https://i.f1g.fr/media/cms/704x396_cropupscale/2025/10/23/2f7cbb9a489bec47d78de8e1401270cf99060d9d84727d701573647610095d83.jpg
Il n’y a qu’un Bibi, c’est Fricotin
Dugong 24 octobre 2025 à 9h21
Tomahawks …Quelle cuisson ?
Le truc à la mode chez les Américains, c’est la cuisson du tomahawk au lance-flamme.
https://www.youtube.com/watch?v=81FVqRnh914
Ouahou ! 😁 – côtes de boeuf- bière- redneck + Bibi F. et son pote Razibus Zouzou :
de + en + esstrémist’ et racis t’ que ce blog !
Comparé à certains commentaires des articles de Causeur, ya de la marge
André Herrero, dit « La prochaine fois, je mettrai deux de mes doigts dans tes yeux » est mort
https://www.lemonde.fr/sport/article/2025/10/24/l-ancien-rugbyman-andre-herrero-figure-du-rc-toulon-des-annees-1960-est-mort_6649151_3242.html
Dugong 24 octobre 2025 à 9h40
GlouGlou y pourvoira
Justement, non . Et je commence à douter de l’existence de ce centre. Je vous soupçonne même de l’avoir inventé.
Une supercherie de plus.
L’unité européenne… Ecoutez Orban.
https://www.youtube.com/watch?v=Jifcit5ie80
L’avenir nous le dira, dans 8 mois :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/table-ronde-hongrie-viktor-orban-fragilise-8869911
https://centrerusbranly.mid.ru/
WTH 24 octobre 2025 à 12h25
Ouahou ! 😁 – côtes de boeuf- bière- redneck + Bibi F. et son pote Razibus Zouzou :
de + en + esstrémist’ et racis t’ que ce blog !
Redneck…pas si sûr;il boit de la Sapporo et fait de la pub pour;il bouffe du boeuf japonais,ou, du moins, élevé à la japonaise.
Mendax 24 octobre 2025 à 11h56
Compris. Vous faites une fixette sur Zelensky.
Pas du tout.
Merci pour les informations de première main que vous donnez,grâce à vos contacts avec des Ukrainiens.
Mendax 24 octobre 2025 à 11h56
C’est pas évident d’admettre que la vision qu’on avait de la situation était complètement fausse.
Ne concerne que ceux qui avaient une vision de la situation,donc pas Lormier.
« L’avenir »… ?! (Z’, 14h41)
Extraits d’un d’un article de P. Vermeren (le figaro, 14 oct 25),
une « vision de la situation » plutôt pertinente,
selon la « la rombière qui se croit très fine » (le M.)
(Titre : « enfermées dans leurs certitudes, nos élites reproduisent les erreurs qui ont conduit à la chute de l’Ancien Régime ») –
« Depuis la crise finale de l’Ancien Régime sous Louis XVI (1775-1793), soit durant les deux cent cinquante dernières années, la France se caractérise par une série de cycles politiques ou générationnels plus ou moins longs, qui se terminent parfois en tragédie, mais toujours brutalement, du fait de l’incapacité des élites nationales à rectifier le tir avant le naufrage, le coup d’État ou l’effondrement final. »
« ‘L’alternance’ de 1981 a amorcé jusqu’à nos jours une déconstruction pierre par pierre, de l’édifice bâti lors du premier cycle républicain (1869-1981) : l’école de l’excellence, l’armée de conscription, les services publics, la sûreté publique, l’économie de production, l’équilibre budgétaire et même l’acquis révolutionnaire de la souveraineté politique et économique du peuple français. »
« Notre vie politique est donc hachée par des séquences d’une ou deux générations, à l’issue souvent brutale, voire dramatique.
Qu’on en juge
la Terreur de 1793 pour abattre la monarchie,
la double invasion de la France en 1814 et 1815 pour tuer l’Empire,
la révolution de 1830 pour chasser les Bourbons,
les deux Révolutions de 1848 et leur violente répression pour chasser les Orléans,
Sedan en 1870 pour liquider le second Empire, suivi par la deuxième invasion de la France et la Commune,
la guerre de 1914 qui clôt dramatiquement le règne des radicaux,
l’effondrement de 1940 pour engloutir la République au risque de faire disparaître le pays (avec une troisième invasion),
la guerre d’Algérie pour emporter la IVe République et briser l’utopie coloniale. »
« Nous vivons une crise politique inédite par sa durée, désormais proche de trouver son dénouement (…) seule une série de leurres a permis de repousser l’inéluctabilité de la chute (…) »
« La résolution des crises ne se réalise que dans le drame (…) »
« Les voies de résolution de l’actuelle crise demeurent inconnues (…) sévère crise financière, (…) crise systémique de l’euro (…) banqueroute plus ou moins solvable dans une purge financière de moins en moins évitable (…) violences politiques ou sociales (…) attentats, émeutes urbaines, manifestations violentes, montée de l’insécurité et des règlements de comptes. »
« Un violent conflit de répartition est possible entre les clientèles de l’État nourricier quand s’imposeront sous la contrainte la réduction des dépenses de 150 milliards d’euros et la réaffectation d’une centaine au profit du régalien »
« Déjà des boucs émissaires sont désignés (…) d’autres ne sauraient être exclus : retraités boomers, fonctionnaires, paysans (…) »
« Ce sont bien les Français qui ont et qui vont payer. »
« L’archipel français est une société multiconflictuelle. »
« pays dans une triple impasse : productive, financière et culturelle. Et désormais politique (…) »
Ha ha ha ! Le sempiternel catéchisme catastrophiste !
Depuis 1789, on a eu :
“La France meurt” (sous la Terreur)
“La France meurt” (sous Napoléon)
“La France meurt” (sous la IIIe République)
“La France meurt” (sous De Gaulle)
Et là, apparemment, elle remeurt.
Heureusement, elle ressuscite à chaque fois, ce qui finit par manquer un peu de sérieux.
Entre un Vermeren – normalien et agrégé d’Histoire – et un M. heureux comme un « simple d’esprit » 🤪!..
y’a pas photo.
La France n’est pas… seule : c’est tout l’Occident qui va très mal, et qui n’a plus ni ressources économiques ni humaines.
Et rien que pour vous une video-propagande (anglo-saxonne ; mais qui donc se cache derrière ? 😁)
https://www.youtube.com/watch?v=YRuYb3H3mvA
Normalien et agrégé d’histoire ? Il a forcément raison ! Il peut raconter n’importe quoi… mais en grec ancien s’il le faut !
Moi j’ai un plombier qui est aussi médium. Alors quand il me dit que mon lavabo est hanté, je le crois.
Z’en avez de la chance d’avoir un plombier ! C’est une denrée qui se fait rare…
Y’a plus grand nombre de gens capables de faire grand chose, ici.
N’avez pas encore trouvé qui se cache derrière Money & Macro ?
Ou bien ne faites vous confiance qu’en celui qui a dit :
« le régime de Vladimir Poutine est en échec, militairement, politiquement et économiquement. Depuis 1000 jours il n’a réussi qu’à conquérir 1 % du territoire ukrainien. Son économie est à l’agonie, asphyxiée par l’effort de guerre en Ukraine, par les frappes ukrainiennes qui ont éteint un cinquième de la capacité de raffinage russe, et puis par les sanctions auxquelles Poutine d’exposer son propre peuple. »
L’a pas d’chance le Pout’ ! C’est pas comme ici où tout baigne – enfin presque.
Rappel : le gus causant de la Russie ci-dessus, a été ministre délégué chargé du Numérique de 2022 à 2024 – tout s’essplique : les nombres c’est pas son dada !
(« continue – d’exposer son propre peuple »)
(… et j’ai écrit que la « vision de la situation » décrite par Vermeren me semblait « plutôt pertinente ».
A croire que vous vivez seul, sans famille, dans une sorte de bulle, dédaigneux et méprisant…)
Mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez, WTH.
Je me permets simplement de vous rappeler qu’il y a une grande différence entre les faits et l’opinion. Et que les diplômes ne sont jamais une garantie de véracité ou d’honnêteté intellectuelle.
La preuve : Une énumération disparate bricolée comme celle que vous citez n’a strictement aucune valeur méthodologique et en réalité, si votre normalien agrégé d’histoire adoptait une telle façon de faire à un concours, il serait impitoyablement recalé. Il part d’une thèse sans aucun fondement empirique (l’histoire de France procéderait par « cycles politiques », vieille lune à la Toynbee ou à la Spengler) et pour la « démontrer », plutôt que de s’appuyer sur une analyse rigoureuse, il préfère raconter une histoire agrémentée d’une rhétorique fataliste bon marché… tout en omettant scrupuleusement les éléments qui le dérangent. Il mélange des guerres étrangères, des révolutions sociales, des transitions constitutionnelles, sans distinction. Il saute allègrement la longévité exceptionnelle de la Ve République (66 ans aujourd’hui), la plus stable depuis… 1791. Les notions clés – élites, crise, souveraineté – ne sont jamais définies, rendant l’argument flou. La causalité morale – “les élites fautives” – remplace toute analyse structurelle. Puis le texte se protège de toute réfutation : si la crise n’arrive pas, c’est qu’elle est “repoussée”. Le ton prophétique et catastrophiste tient lieu de démonstration (procédé qui rappelle quelque chose puisque largement plébiscité par Gérard). Bref, Ce n’est pas une analyse savante, c’est une rhétorique d’opinion sous vernis académique.
Ne vous faites pas avoir par ce genre d’article ronflant, c’est tout ce que je vous dis – certes de manière un peu sarcastique, mais c’est parce que je vous ai déjà prévenue à cet égard je ne sais combien de fois. Cela n’a rien à voir avec ma petite personne, mes diplômes ou mon absence de diplôme, ma famille ou mon absence de famille.
Je suis actuellement plongé dans « Histoire générale de l’Afrique », conchiée par le nabot de Neuilly mais éditée par l’Unesco, « truc » qui trouve là une échappatoire pour avoir longtemps servi de mange-brouzouf à un paquet de parasites.
J’ai commencé par le dernier des 8 tomes « L’Afrique depuis 1935 », année de l’entrée des troupes de Mussolini en Ethiopie.
https://shop.unesco.org/products/histoire-generale-de-lafrique-texte-abrege-viii-lafrique-depuis-1935
Mendax
24 octobre 2025 à 18h17
Ha ha ha ! Le sempiternel catéchisme catastrophiste !
Depuis 1789, on “La France meurt” (sous la Terreur)
Etc
Je ne me sens pas de force à développer sur ce sujet, ni pour approuver Vermeren ni pour approuver Mendax.
Je me contente de citer une phrase de B. de Jouvenel , » les révolutions liquident les faiblesses et accouchent des forces »
Mais l’accouchement est dur et ce qui résulte des révolutions est généralement très différent de ce qu’escomptaient les révolutionnaires.
Et sur l’élan, « les révolutions liquident les forces et accouchent des faiblesses »
Le point de vue d’Orban sur l’Ukraine, l’Europe et la guerre.
(Pourquoi la « coalition des volontaires » veut entraîner l’Europe dans la guerre et comment les
instances « européennes » entendent détruire nos systèmes de santé,d’enseignement, de protection sociale afin de financer la guerre.)
Orban, c’est très mal, je sais… D’un autre côté, ici en France on commente la bagarre sur le budget sans prendre en compte le projet guerrier de Macron.
Poutine a besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir ( mais s’il ne l’avait pas déclenchée son pouvoir ne serait pas si menacé….) . Et Macron ?
https://www.hungarianconservative.com/articles/current/viktor-orban-hungary-ukraine-peace-summit-eu-christianity-23-october-1956/
« Orban c’est très mal ». Encore une fois, on PEUT juger un énoncé à partir de celui qui le profère, mais c’est plus pertinent de lire l’énoncé lui même, d’essayer de le comprendre et de voir s’il tient la route par rapport aux faits.
Par exemple:
“Hungary is the only migrant-free nation in Europe.”
Faux. Des dizaines de milliers de travailleurs étrangers vivent en Hongrie, et le pays bénéficie de programmes européens d’accueil de réfugiés ukrainiens. Il est simplement fermé à certaines migrations non européennes.
“Brussels oppressors” / “colonial logic of Brussels.”
L’UE n’exerce pas de tutelle coloniale : la Hongrie est membre souverain, bénéficiaire net du budget européen, et a signé librement les traités qu’elle critique.
“We are the only country in Europe where peace can be brokered.”
La Hongrie n’a joué aucun rôle de médiation reconnu dans le conflit ukrainien ; les négociations de paix sont menées par l’ONU, la Turquie, et d’autres acteurs.
“If Donald Trump had been president, this war would never have broken out.”
Pure spéculation. Aucune donnée ne permet d’établir une relation causale entre la présidence américaine et la décision d’invasion russe.
“Brussels has dragged Europe into war.”
C’est la Russie qui a envahi l’Ukraine en février 2022 ; l’UE n’est pas partie au conflit, elle soutient la défense ukrainienne, ce qui est parfaitement légal. Par ailleurs, c’est la russie qui mène une guerre hybride contre l’UE depuis des années, phénomène reconnu et très largement documenté.
“Hungary protects children from ideologies that go against the order of nature and creation.” Référence aux lois anti-LGBT de 2021, condamnées par la Commission européenne pour violation des droits fondamentaux et de la liberté d’expression.
“We will not give our weapons, we will not die for Ukraine.”
Aucun État de l’UE n’envoie de troupes combattre ; l’aide est financière et logistique. Cette phrase transforme un consensus de solidarité en récit de martyre national.
“Ukraine is no longer sovereign; its fate is in others’ hands.”
L’Ukraine conserve son gouvernement élu et son intégrité juridique ; elle reçoit un soutien international mais reste un acteur autonome.
“The EU spent €185 billion on a hopeless conflict.”
Chiffre sans source. Les engagements financiers cumulés sont bien inférieurs et consistent majoritairement en prêts, aides humanitaires et soutien à la reconstruction.
“We want the EU—but not Brussels. »
“Brussels” désigne le fonctionnement démocratique et institutionnel de l’Union. Vouloir l’UE sans Bruxelles revient à vouloir les fonds sans les règles.
Etc.
Mais bien sûr, on peut AUSSI souligner pourquoi la parole de l’émetteur ne vaut en elle-même pas grand-chose. Et ce à partir d’éléments factuels. Pas juste parce qu’on « ne le sent pas » ou qu’on affirmerait sans aucune preuve qu’il est un agent de la CIA.
Pathogénicité de la protéine spike virale et de la protéine spike vaccinale.
Témoignage au Sénat du Docteur Vaughn:
https://www.hsgac.senate.gov/wp-content/uploads/Vaughn-Testimony.pdf
extrait
The Spike Protein: A Pathogenic Culprit
The SARS-CoV-2 spike protein, specifically its S1 subunit, is not a benign protein. It triggers
inflammation, disrupts endothelial barriers, induces fibrin resistant to breakdown, and
promotes amyloid-like aggregates [2, 4, 6, 10, 20]. These effects impair oxygen delivery, damage
blood vessels, and contribute to clotting pathologies that manifest as persistent symptoms of
heart racing, brain fog, shortness of breath, and post-exertional malaise [30-33]. In my clinic, I
use immunofluorescent microscopy to detect amyloid fibrin microclots in patients—some as
young as teenagers unable to stand, others are previously active adults suffering small strokes
without identifiable cause. These are not abstract theories; they are the lived realities of my
patients in Alabama and beyond.
The mRNA vaccines, heralded as the solution, introduced a novel mechanism: lipid
nanoparticles (LNPs) delivering modified mRNA that instructs cells to produce a stabilized Spike
Protein [13, 14]. Unlike traditional vaccines, this approach results in uncontrolled production of
the spike protein for an unknown duration and distributes it widely across organs, including the
heart, brain, and vasculature [15, 16, 37]. The European Medicines Agency’s assessment of
Comirnaty noted biodistribution beyond the injection site, contradicting claims that the vaccine
“stays in the arm” [39]. A recent groundbreaking study using Single Cell Precision Nanocarrier
Identification (SCP-Nano) revealed LNP accumulation in heart tissue of mice, with adverse
proteomic changes in immune and vascular proteins, raising concerns about cardiac
complications [37]. These findings align with clinical reports of myocarditis and pericarditis,
particularly in young males, following mRNA vaccination [29, 34, 35].
Dans cet entretien, le Docteur Vaughn explique un grand nombre de choses.
https://www.youtube.com/watch?v=AaER9tkgdqs
Premièrement,on s’est trompé au début, sur la nature de la maladie:maladie vasculaire et non pulmonaire. Le pire traitement qui a été donné fut de mettre les malades sous respirateur artificiel . Cela a tué beaucoup de gens. En France, un anesthésiste-réanimateur,Louis Fouché a dit très tôt exactement la m^me chose (et bien sûr,il fut tout de suite suspendu et classé complotiste).
Quel est le pathogène principalement responsable de l’atteinte aux vaisseaux ? La spike.
Par conséquent, faire fabriquer par l’organisme,en quantité incontrôlable ce pathogène n’est pas du tout une bonne idée.
Pour avoir des sous-titres,cliquez sur cc.
« on s’est trompé »
Voilà un « on » bien singulier
C’est la protéine spike (Lee ?) qui a décimer l’armée napoléonienne en 1812
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2025/10/24/ces-infections-qui-ont-fauche-la-grande-armee-de-napoleon-en-1812_6649197_1650684.html
Encore un coup des anglais.
décimé
« spike » = pointe –
A chaque époque sa « pointe ».
A l’époque napoléonienne, à la pointe des baïonnettes.
Certains cétacés, comme le Dugong, sont bien incapables d’une quelconque méchanceté – excepté par- ci par-là, d’une pointe d’humour, voire bien plus.
Au contraire des orques, qui se sont récemment acharnés contre un voilier * et l’ont coulé, au large du Portugal.
* famille française à bord (sauvée par la Marine portugaise) : les Français n’ont plus nulle part la cote, même loin de leurs côtes – j’essaie d’imiter maître Dugong, en la matière, mais pas souvent facile.
Mendax 25 octobre 2025 à 8h16
« Orban c’est très mal ». Encore une fois, on PEUT juger un énoncé à partir de celui qui le profère, mais c’est plus pertinent de lire l’énoncé lui même…
=========================================================
Ce qui suit cette introduction est une analyse critique,fine, détaillée du discours d’Orban, « abominable personnage d’esstrême droit qui menace la démocratie néo-mengeléienne… »
Merci beaucoup.
Peut-on,à partir de ce discours d’Orban, supputer quelque chose quant à la direction que pourrait prendre la Hongrie ?
a) Il me semble patent que la dissidence Orban nuit à l’unité de l’Europe (considérée comme institution) . Cette dissidence gêne l’action de Van Der Leyen et de sa clique . A tout le moins, ça n’aide pas.
b) Combien de Hongrois étaient présents autour d’Orban lorsque il a tenu ce discours ? Donnée importante.
Et parmi ceux qui s’opposent à lui, combien sont prêts à aller combattre en Ukraine ?
Parce qu’une des choses qu’a dites Orban est:cette guerre n’est pas la nôtre,nous ne combattrons pas les Russes. La « coalition des volontaires », c’est un ramassis de politicards prêts à envoyer les autres se faire tuer en Ukraine. Les Hongrois n’iront pas.
On peut être contre Orban et pourtant refuser d’aller se faire tuer en Ukraine (pour permettre aux néo-nazis Macron, Starmer, Van der Leyen et tutti quanti de semainenir au pouvoir.)
c) Une idée mise en avant par Orban me semble convaincante:c’est parce qu’ils veulent la continuation de la guerre que les chefs à la Macron et Starmer sont en train de ruiner les peuples frabçais (resp. Britanniques):casse de tout (retraites,santé ,enseignement)..
Passque l' »économie de guerre »,eh ben ça a un coût.
Ou bien:
l’économie de guerre,c’est pas l’économie de paix.
Mendax serait bien capable de démontrer que ce dernier énoncé est faux.
Dans la foulée, il nous démontrera aussi que : »la guerre, c’est la paix. »
Dugong 25 octobre 2025 à 10h16
« on s’est trompé »
Voilà un « on » bien singulier
=========================================================
Traduction hâtive et maldroite par Lormier du « we » (nous) utilisé par le Docteur Vaughn.
Si Dugong veut bien se donner la peine d’écouter le début de l’entretien (en mettant, si besoin, les sous-titres) il saura qui est désigné par ce « we ».
Petite explication:
Vaughn a comuniqué avec des confrères sud -Africains. Ensemble ils ont dit « We were barking up the wrong tree « . Mot à mot: « on aboyait sous le mauvais arbre ».
Oui, le covid 19 est un virus repiratoire; à quoi servent nos poumons ? C’est une pompe à air;ça permet,exempli gratia, de gonfler une poupée en silicone avant d’y glisser sa bite (si elle n’a pas été coupée après attaque par le Treponemus Africanus)…oui mais pas que.
Passque l’intérêt de faire entrer de l’air dans les poumons, c’est de pouvoir prélever de l’oxygène qui passe dans le sang via le réseau vasculaire.
Voilà.
Le covid 19 s’attaque aux vaisseaux sanguins;c’est eux qu’il faut soigner.
Quand des médecins (non-macronistes) voient arriver une nouvelle maladie,ils commencent par l’étudier et, en fonction de leurs observations et de leurs connaissances,ils décident d’un traitement.
Mais, ils peuvent très bien commencer par faire fausse route.
Les médecins macronistes,eux ,ont persévéré dans l’erreur, pompé de l’air sous pression dans les poumons de leurs malades et ainsi en ont tué la plupart.
Il y a eu aussi les médecins hyper-macronistes à la Wargon (époux de la fille de Stoleru-nommée ministre dans un gouvernement Macron) qui ont crié partout:y a aucun traitement,y a aucun traitement, faut les liquider au Rivotril!
En France,heureusement,la plupart des médecins sont restés fidèles au serment d’Hippocrate
et ont soigné raisonnablement leurs malades,sans se préoccuper des injonctions démentes de Macron-Véran.
Je crois qu’on n’a pas trop inquiété ceux qui sont restés discrets. Mais ceux qui ont parlé s’en sont pris plein la gueule. Ainsi en est-il de Louis Fouché,vite désigné come complotiste,interdit d’exercer etc.
Macron a lâché les chiens contre lui ( les Jomier, Mendès-France, Rudy Reichstadt etc.)
Lormier
Les Hongrois n’iront pas.[ combattre en Ukraine ]
On peut être contre Orban et pourtant refuser d’aller se faire tuer en Ukraine (pour permettre aux néo-nazis Macron, Starmer, Van der Leyen et tutti quanti de semainenir au pouvoir.)
Il me semble qu’il y a ici un durcissement des positions possibles qui ne reflète pas la réalité ( mais qui pourrait s’avérer exact dans l’avenir ): il n’est pas besoin de se faire tuer pour soutenir une position internationale. Au contraire, il doit être possible de le faire jusqu’au point où il deviendrait dangereux de s’engager plus, sans aller au delà de ce point.
Ce n’est pas » glorieux » mais réaliste.
Ben justement, c’est exactement ce qu’on fait depuis trois ans : fournir aide financière et matérielle à l’Ukraine, sans envoyer nos soldats au front. Résultat ? Le conflit s’éternise, des milliers de civils meurent encore, et l’agresseur teste toujours nos limites. Fixer un “point limite” théorique n’a rien changé à la réalité du terrain. (Et d’ailleurs, sur quels critères fixerions-nous cette limite ? Qu’est-ce qui est considéré comme « dangereux » ? De toute façon, depuis le début de la guerre, les russes nous menacent à tout bout de champ de représailles pour « co-belligérance », que l’on envoie des casques, des vivres ou des armes, alors dans la mesure où ils nous menacent ouvertement, je ne vois pas très bien où est le problème.)
Oui. Après chaque « drone » ou « ballon » suspectés de venir de Russie… le boss de l’Otan – actuellement secouée par un « scandale » ! – met en général la pédale douce, sauf exception(s) où le lendemain il revient sur sa déclaration de la veille, sermonné par Washington.
Vous avez raison, Lormier, c’est imparable : l’économie de guerre n’est pas l’économie de paix. De même que la pluie, ce n’est pas le beau temps. Mais cette tautologie ne dit rien sur ce qu’il faut faire quand l’orage approche.
La “dissidence” d’Orbán ne sert pas la paix mais ses contrats gaziers avec Moscou. Ce n’est pas la guerre qui ruine les peuples, c’est la paresse des dirigeants à réformer honnêtement. Orban, lui, préfère accuser les autres plutôt que d’assumer sa propre faillite. Il parle de “ruine des peuples”, mais c’est lui qui a ruiné la Hongrie : inflation record, monnaie effondrée, fonds européens gelés et économie en récession – aujourd’hui, son pays n’est guère mieux loti que la France. La souveraineté qu’il défend, c’est juste le droit de tout planter tout seul. Or, la paix, ce n’est pas l’inaction : la paix, comme la liberté, d’ailleurs, nous avons apparemment oublié que ça a un coût. Refuser d’aider l’Ukraine ne protège personne : ça affaiblit l’Europe et renforce l’agresseur. Et ne pas se préparer à la guerre, c’est la meilleure façon de la perdre — l’histoire le montre assez. “Économie de guerre” ne veut pas dire qu’on la veut, mais qu’on assume d’y faire face. Il n’y a pas de complot pro-guerre, juste un tyran pro-Poutine qui vend la peur en guise de politique.
Ah, cette fois-ci Mendax n’a pas forcé son talent! Il ne nous a pas démontré que « la guerre,c’est la paix ». Poutant ,il en est capable;je lui ai mainte fois tiré mon chapeau pour sa pussance argumentative.
Merci pour le compliment, Lormier. Orwell dénonçait la propagande soviétique (Big Brother = Petit Père des peuples). N’est-ce pas une forme d’ironie trop sophistiquée que de le citer ainsi dans ce contexte, alors que j’essaie de montrer la malhonnêteté du discours d’un dirigeant prorusse ?
Pour quelle raison,les stratèges européens ainsi que les politiques orientant les décisions militaires commencent-ils à nous parler démographie ?
450 millions d’Européens vs 150 millios de Russes ? Ne serait-ce pas qu’ils envisagent une mobilisation contre la Russie ?
Voyez ce compte rendu de débats au Sénat (avril 25). Il y a eu aussi,sur le sujet, des déclarations de généraux d’opérette.
M. François Bonneau . – (Applaudissements sur les travées du groupe UC) L’Union européenne a tout d’une grande puissance. Elle est peuplée de 450 millions d’habitants, dotée d’un PIB de 18 000 milliards d’euros, elle domine les classements de développement humain, ses écoles attirent le monde entier. L’Union européenne a tout d’une grande puissance, mais c’est un colosse aux pieds d’argile dans le domaine de la défense.
Depuis 1945, les États européens ont privilégié la protection des États-Unis plutôt que d’investir dans leur propre défense.
« Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts », disait le général de Gaulle. Les yeux de Washington sont rivés sur le Pacifique et la Chine. L’isolationnisme américain a ressurgi. Outre-Atlantique, on s’interroge : pourquoi mourir pour l’Europe ? Nos dollars doivent-ils financer la défense des Européens ?
Le constat pour l’Europe est sévère. Nous avons accumulé un trop grand retard dans nos politiques militaires et ne sommes pas en mesure de faire face aux menaces.
La France a choisi l’autonomie stratégique, se dotant de l’arme nucléaire et d’une armée complète, mais elle ne peut concourir à la course à l’armement que la Chine, la Russie et les États-Unis se livrent.
Nos tentatives de structurer une politique de défense commune au sein de l’Union européenne sont longtemps restées infructueuses, nos partenaires privilégiant la protection américaine. Pourtant, le constat du renforcement et de l’autonomisation de nos forces armées fait désormais consensus. Si les Européens veulent la paix, ils doivent préparer la guerre.
Nous aurions dû anticiper ce réveil brutal de la guerre dès le 24 février 2022 et la violation russe du territoire ukrainien. Qui peut croire que la Russie s’arrêtera à l’Ukraine ? Que le dictateur du Kremlin n’attaquera pas l’Europe si elle est faible ?
La Russie s’arme contre nous et les États-Unis préparent dans notre dos les conditions d’une paix inacceptable pour l’Ukraine dont nous ferons inévitablement les frais.
Si nous voulons nous protéger, les 27 membres de l’Union européenne doivent mener une politique de réarmement, de Lisbonne à Tallinn, de Stockholm à Athènes. Saluons les investissements massifs de l’Allemagne. Cependant, ce réarmement européen ne sera pas immédiat, tant le retard est grand.
La majorité des armées européennes sont structurées comme des soutiens à l’armée américaine et non des forces de projection indépendantes. Leur dotation matérielle dépend de la BITD américaine.
Enfin, notre coordination stratégique doit être renforcée.
Le Livre blanc apporte une réponse à ces défis pour 2030. L’instrument SAFE fournira 150 milliards d’euros sur quatre ans. L’Union européenne activera aussi la clause dérogatoire au PSC pour quatre ans, pour dégager au total 800 milliards d’euros.
Ce Livre blanc cible des priorités pour notre résilience stratégique, tels que les stocks de munitions, les drones, l’innovation technologique ou encore la protection des infrastructures. Veillons à ce que ces armes soient bien fabriquées sur notre sol, tout en respectant la souveraineté des États.
La Commission européenne veut renforcer ses liens avec le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada, la Turquie, les États voisins de l’Union, les pays de l’Indopacifique, tout en rappelant que l’Otan reste la pierre angulaire de notre coordination.
Nos relations avec les États-Unis doivent prendre en compte que les intérêts américains ne convergent pas toujours avec les nôtres. En témoigne la question du Groenland. Les forces militaires européennes doivent être en mesure de dissuader les ambitions expansionnistes du 47e président des États-Unis.
Dans un monde qui se réchauffe, et pas seulement climatiquement, les Européens doivent redoubler d’efforts pour se doter d’une force militaire capable de dissuader, d’opérer et de défendre nos valeurs.
Avec la chute de l’Union soviétique, nous avons cru naïvement à la fin de l’histoire, sous la protection du gendarme américain, où nous pourrions devenir des rentiers recevant les dividendes de la paix. Les jours de paix se couchent à l’ouest ; la nuit tombe à l’est, avec son lot de guerres et d’incertitudes. L’Europe est le témoin de ce sinistre crépuscule.
Ensemble, nous sommes plus forts. C’est pourquoi le Livre blanc est un pas en avant historique pour dissuader nos adversaires et nous réarmer moralement. (Applaudissements sur les travées du groupe UC ; M. François Patriat applaudit également.)
https://www.senat.fr/cra/s20250408/s20250408_1.html
Sur les Etats Unis,j’irais plus loi que le sénateur Bonneau.
Les Etats Unis sont très contents de pouvoir saigner l’Europe; Trump accepte de livrer des armes (certaines armes) à l’Ukraine, à condition que ce soit l’Europe qui les paie.
Macron exécute les ordres de Trump.
Par exemple, les « sanctions » contre la Russie nous obligent à acheter du gaz américain.
Pour comprendre Macron, il faut savoir qu’il est à la solde de Trump.
« Il n’y a pas de complot pro-guerre, juste un tyran pro-Poutine qui vend la peur en guise de politique. » (le M.)
« la peur en guise de politique », c’est une vieille histoire…
Retour (récent) avec le petit tyran Cramon, et le covid – « nous sommes en guerre »,
et depuis c’est une litanie sans fin.
Macron,ignorant superbement ce qui se passe aux Etats Unis, s’en est pris aux réseaux sociaus,où,dit-il, des complotites peuvent affirmer qu' »un vaccin n’est pas un vaccin. »
Mendax 22 octobre 2025 à 16h47
En ce qui concerne la théorie du « bait and bleed », c’est un bon exemple de rationalisation a posteriori. Sur le plan logique, c’est assez fragile …
=========================================================
Admettons.
Que cette stratégie ait été adoptée ou non par Obama-Biden,qu’elle soit fragile ou pas, ce n’est pas,actuellement celle de Trump.
Trump a déclaré:tout a commencé avec cette histoire de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN.
Agir pour faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN, c’est bien du « baiting » n’est-ce pas ?
La position de Trump semble être celle-ci:je laisse les Européens faire durer cette guerre…un certain temps;ils m’achètent des armes, qu’ils livrent gratuitement à l’Ukraine; cette dépense me profite et les met eux dans la panade, c’est tout bon.
Bien sûr, je n’autorise pas les ventes d’armes pouvant changer la donne de manière décisive.
En temps opportun, je fermerai complètement le robinet, de sorte que les Ukrainiens seront forcés de capituler et alors je m’entendrai avec Poutine pour prendre en Ukraine ce qui m’intéresse.
Tout se passe bien:le petit trou du cul Macron et son pote Starmer font ce que je leur dis de faire.
Ca roule.
Mendax
25 octobre 2025 à 12h45
Ben justement, c’est exactement ce qu’on fait depuis trois ans : fournir aide financière et matérielle à l’Ukraine, sans envoyer nos soldats au front. Résultat ? Le conflit s’éternise, des milliers de civils meurent encore, et l’agresseur teste toujours nos limites. »
Etc
Oui, mais dans la mesure où nous ( Européens) ne sommes pas directement impliqués, il est raisonnable de s’en tenir à un » soutien sans participation « .
Ce sont les Ukrainiens qui meurent, et c’est désolant, mais c’est une guerre qui concerne l’Ukraine.
Personne de bon sens ne souhaite créer les conditions d’une 3eme guerre mondiale pour l’Ukraine.
Et le raisonnement : » qui après l’Ukraine ? » reste ( dans l’etat actuel des choses , évidemment) un argument rhétorique.
Ce n’est pas du tout rhétorique, c’est l’histoire récente et les déclarations publiques de Moscou. Les annexions partielles et les menaces sur les États voisins sont documentées. Les menaces de Moscou contre la Moldavie, la Lituanie et la Pologne sont publiques et répétées par des officiels russes. Les annexions de territoires ukrainiens en 2014 et 2022 montrent que l’agression ne s’arrête pas à un seul pays. Par coercition et mobilisation forcée, la russie a déjà commencé à envoyer les Ukrainiens des territoires occupés contre leurs compatriotes. Qu’on la laisse gagner et elle fera pareil en envoyant des Ukrainiens contre les Polonais, et ainsi de suite. Or l’Ukraine est maintenant la meilleure armée de toute l’Europe. Vous ne croyez pas que nous avons tout intérêt à les avoir de notre côté ?
Mendax 25 octobre 2025 à 8h16
« … on PEUT juger un énoncé à partir de celui qui le profère, mais c’est plus pertinent de lire l’énoncé lui même, d’essayer de le comprendre et de voir s’il tient la route par rapport aux faits. »
=========================================================
C’est la méthode suivie généralement par Lormier,même s’il erre parfois. Que celui qui n’a jamais erré jette la première pierre à Lormier.
Exemple:Virginie Joron est d’esstrême droite-ce qui est très mal.
Pourtant, toute ses déclarations relatives au covid sont justes. Au Parlement européen elle a été l’un des rares députés à défendre le droit fondamental de l’être humain à disposer de son corps.
ECHO 25 octobre 2025 à 13h11
Mendax
25 octobre 2025 à 12h45
Ben justement, c’est exactement ce qu’on fait depuis trois ans : fournir aide financière et matérielle à l’Ukraine, sans envoyer nos soldats au front. Résultat ? Le conflit s’éternise, des milliers de civils meurent encore, et l’agresseur teste toujours nos limites. »
=========================================================
ECHO, voyez-vous de l’implicite dans ce propos ?
Moi, oui.
Le conflit s’éternise parce que nous n’envoyons pas de soldats au front.
Pour mettre fin au conflit,il faut envoyer des soldats au front.
Métaphysique budgétaire.
« M. Benjamin Haddad, ministre délégué. – Exclusion possible des dépenses de défense du calcul du déficit, plan SAFE, prêt de 150 milliards d’euros contracté par la Commission européenne, refléchage de certains fonds : le réarmement de notre continent franchit un cap important… »
https://www.senat.fr/cra/s20250408/s20250408_1.html
Voilà:
Si je dépense 10 milliards pour la santé, ça creuse le déficit (qui ne doit pas dépasser 3%).
Mais si je dépense 10 milliards pour construire une usine d’armement,c’est exclu du calcul du déficit,DONC c’est pas du déficit.
Mendax 25 octobre 2025 à 12h34
Ce n’est pas la guerre qui ruine les peuples…
=========================================================
Tiens !
Pourtant, beaucoup de nos stratèges soulignent ce qu’elle côute à la Russie:les pénuries de toutes sortes, l’appauvrissement général…qui finiront par avoir raison de l’obstination de Poutine.
Un jour, j’ai écrit ça sur mon blog :
« Rappelons que :
L’Union européenne est la deuxième puissance économique mondiale (et même la première parfois suivant le taux de change euro/dollar) avec près de 30% du PIB mondial; elle est aussi la première puissance agricole, industrielle et de service au monde.
Mais encore :
la première puissance sportive de la planète,
la première puissance nucléaire civile,
la deuxième puissance spatiale du monde,
la deuxième puissance technique du monde,
la troisième puissance démographique du monde,
la troisième puissance nucléaire militaire.
La région la moins inégalitaire du monde .
Elle serait, en outre, dotée des meilleurs services secrets au monde .
L’Allemagne, à elle seule, avec 13 fois moins d’habitants que la Chine, était encore il y a quelque mois la première puissance exportatrice du monde (elle a été dépassée par la Chine depuis peu). »
Mais c’était il y a bientôt quinze ans, avant le pingouin et son fils Cramon.
Ici:
https://abcmathsblog.blogspot.com/2011/08/lenigme-europeenne.html
(2011 !)
« la destruction méthodique de notre économie de producteurs – fruit de deux cents ans de labeur collectif – a été le prix à payer pour édifier la monnaie commune, l’euro – au seul profit de l’Europe germanique (…)
« l’euro allait porter la croissance de notre économie ;
la désindustrialisation permettrait de ne garder en France que les fonctions de commandement à haute valeur ajoutée ;
le libre-échange sans contre partie profiterait à notre économie ; l’immigration serait une chance inconditionnelle pour notre pays ; l’endettement public est la croissance de demain, de sorte que la dette serait indolore…
(Pourtant tout cela a conduit le pays dans une triple impasse productive, financière et culturelle. Et désormais politique.)
(P. Vermeren)
WTH 25 octobre 2025 à 12h33
« spike » = pointe –
A chaque époque sa « pointe ».
A l’époque napoléonienne, à la pointe des baïonnettes.
=========================================================
En angais,la pointe de la baïonnette ne s’appelle pas « spike » mais « point ».
Point: The tip of the blade or scabbard.
voir:
Glossary of Bayonet Terms
Back: Lower faces of a triangular socket bayonet blade.
Back Edge: The ridge along the back of a triangular socket blade.
Back Flute: The hollow-ground portion of a triangular socket bayonet blade back.
Basal: At the base of. For example, a basal locking ring is at the very rear of the socket.
Belt Loop: The portion of a belt frog that encircles the equipment belt.
Blade: The business end of a bayonet.
Blood Groove: Myth. No such thing. See, Fuller.
Body: The main section of a scabbard that encloses the blade.
Bolo: Curved blade designed for cutting vegetation.
Bore: Inside socket diameter.
Bowie: See Clip-Point.
Bridge: Raised portion of a collar that allows a stud or front sight to pass through when mounting and dismounting.
Chape (see Endmount)
Clean-Out: A lateral hole through the grip scales and tang, that enables removal of debris from inside a hollow bayonet hilt.
Clip-Point: Blade profile with a curved false edge at the point. Also referred to as a Bowie, after American frontiersman James ‘Jim’ Bowie.
Collar: Raised reinforcement at the socket rear that prevents the socket from deforming when the bayonet is subjected to side-loads.
Crosspiece: The structure that makes up the front of the hilt, perpendicular to the blade. The crosspiece includes the muzzle ring, if present. The lower portion of the crosspiece is sometimes called the quillon.
Cross-Section: A description of the blade, as sectioned through the middle and viewed end-on.
Cruciform: Cross-like.
Double-Edged: A blade with two true edges, usually with a diamond cross-section.
Edge: 1) The sharpened portion of the knife or sword bayonet blade ground as if to create a cutting surface; 2) The ridge along the sides of a triangular socket blade face.
Elbow: The portion of a socket bayonet that connects the socket and blade.
Endmount: The brass or steel mount at the end of a leather-bodied scabbard.
Epee (French): Sword.
Face: Upper surface of a triangular socket bayonet blade.
Face Flute: Hollow-ground portion of a socket bayonet blade face.
False Edge: A partial edge ground opposite the true edge.
Ferrule: A metal ring between a plug bayonet’s grip and crosspiece.
Finial: A ball or other decorative detail. Usually found at the end of the scabbard or crosspiece.
Flashguard: Metal shield to protect the grip from muzzle blast.
Flute: The hollow-ground portion of a socket bayonet blade.
Frog: A sheath for securing the scabbard to an equipment belt.
Frog Stud: The button or flange attached to a scabbard body, used to secure the scabbard to a frog.
Front Piece: The portion of a frog that includes the frog stud hole.
Fuller: The longitudinal groove in a knife or sword blade. Mistakenly called a “blood groove.” The fuller reduces weight and adds strength, by making the blade behave like an I-beam.
Grip: The portion of the hilt between the crosspiece and pommel.
Hilt: The portion of the bayonet made up by the pommel, grip, and crosspiece.
Hilt Strap: A strap sometimes found on the frog’s belt loop for securing the hilt.
Inverted: Blade profile where the true edge faces upward.
Knife Bayonet: A short bayonet that mounts to a musket/rifle by means of a hilt, typically with a blade not more than 10–12 inches in length.
Locket (see Topmount)
Locking Ring: A securing device commonly found on socket bayonets.
Medial: At the mid-point of. For example, a medial locking ring is at the middle of the socket.
Mortise: The mounting slot typically found in the socket or pommel.
Mount: Alternate term sometimes used to refer to a locket (eg. topmount) or chape (eg. endmount).
Mouth or Mouthpiece: See Throat or Throatpiece.
Muzzle Ring: A support ring at the upper end of the crosspiece that surrounds the muzzle.
Pipeback: See Quillback.
Plug Bayonet: The earliest bayonet design, that mounted by inserting the grip into a musket bore.
Point: The tip of the blade or scabbard.
Pommel: The rear most portion of the hilt. The pommel usually incorporates the mortise and press stud (or spring catch).
Press Stud: Spring-loaded stud commonly used to attach sword and knife bayonets.
Profile: A description of the blade, as viewed from the side.
Quillback: Blade profile incorporating a round spine, resembling a feather’s quill.
Quillon: An alternate term for the lower crosspiece. Most often used when the lower crosspiece is hooked.
Ricasso: Flat at the base of the blade, between the edge and the crosspiece.
Rod: Parallel-sided blade profile, typically of round or triangular cross-section.
Sawback: Blade profile that incorporates a series of saw teeth along the spine.
Scabbard: A type of sheath used protect the blade and facilitate carrying when unmounted. “Sheath,” is not an appropriate term when referring to a bayonet or sword scabbard.
Scales: Contoured plates attached to the tang to form a gripping surface, typically made of wood, plastic, or metal.
Shoulder: 1) Portion of a socket bayonet where the blade narrows to join the elbow. 2) Raised area on a socket, against which the locking ring bears.
Socket: Portion of a socket bayonet that surrounds the musket/rifle barrel.
Socket Bayonet: A bayonet that mounts to a musket or rifle by means of a socket.
Spike: Tapered blade profile, typically of round or cruciform cross-section.
Spine: The upper surface of a knife or sword blade, opposite the true edge.
Spring Catch: Generic term used to describe a spring-loaded mounting catch that operates by means other than a press stud.
Swell: The widest point along a tapered plug bayonet grip.
Swell Point: A blade profile where the blade widens between the ricasso and point (e.g., German M1898/05).
Sword Bayonet: A long bayonet that mounts to a musket/rifle by means of a hilt, typically with a blade in excess of 10–12 inches in length.
T-Back: Blade profile with a T-shaped cross-section.
Tang: The end of the blade surrounded by the grip, to which the pommel and crosspiece attach.
Taper: The narrow portion of a plug bayonet grip, between the swell and the pommel.
Thorn: A metal stud used to secure a leather tab, such as on a hilt strap.
Throat or Throatpiece: Scabbard mouth, into which the blade is inserted.
Topmount: The brass or steel mount at the top of a leather scabbard. The topmount usually includes the throat and frog stud.
True Edge: The fully-ground edge of a knife or sword bayonet.
Unfullered: Blade without fullers.
Yataghan: Graceful double-curve blade profile used on sword bayonets. The double-curve allows long blades to hang well from an equipment belt, while keeping the point in alignment with the hilt for thrusting efficiency.
https://worldbayonets.com/Misc__Pages/glossary/glossary.html
NB il est possibe de munir un grille-pain d’une baïonnette; ainsi le lance-grille-pain de Dugong pourra devenir une arme plus efficace.
Dugong y travaille.
@Lormier, sur la question de l’adhésion hypothétique de l’Ukraine à l’OTAN.
Répétons-le pour que ce soit clair : les États-Unis n’ont JAMAIS “proposé” à l’Ukraine d’entrer dans l’OTAN. Depuis 1994, l’Ukraine coopère, aspire, postule… mais aucun engagement concret n’a été offert. Confondre aspiration et proposition, c’est réécrire l’histoire pour justifier un récit politique. L’impulsion initiale pour que l’Ukraine aspire à rejoindre l’OTAN vient principalement de l’Ukraine elle-même, dès les années 1990.
1994 : l’Ukraine rejoint le Partenariat pour la paix de l’OTAN – coopération mais pas adhésion.
2002 : Koutchma exprime l’aspiration à adhérer, sans demande officielle.
2008 : sommet de Bucarest : l’OTAN déclare que l’Ukraine deviendra membre un jour, sans calendrier ni engagement concret.
2010–2014 : suspension des démarches par Ianoukovytch (prorusse).
2014 : reprise des aspirations après l’annexion de la Crimée, mais pas de proposition américaine d’adhésion immédiate.
2022 : Ukraine dépose une demande officielle, mais l’OTAN et les États-Unis ne garantissent toujours pas une adhésion immédiate.
Mendax 25 octobre 2025 à 15h15
Répétons-le pour que ce soit clair : les États-Unis n’ont JAMAIS “proposé” à l’Ukraine d’entrer dans l’OTAN.
Donc l’exigence poutinienne de non-entrée dans l’OTAN devrait être facile à satisfaire dans une négociation tripartite.
Non, Lormier. Si cette « exigence” était si facile à satisfaire, elle aurait déjà été réglée. Mais ce que Poutine demande, ce n’est pas une clarification, c’est un droit de veto sur la souveraineté des États voisins.
L’Ukraine a le droit de choisir ses alliances, même si elle n’a jamais reçu de proposition formelle d’adhésion.
Céder sur ce point reviendrait à institutionnaliser le chantage armé : Moscou menace et l’Occident promet. C’est ça votre conception de la diplomatie ?
Or, on sait comment finit ce genre de “compromis” : par la prochaine invasion.
WTH 25 octobre 2025 à 14h21
(2011 !)
« la destruction méthodique de notre économie de producteurs …
En métaphysique budgétaire,les dépenses de réarmement n’aggravent pas le déficit puisque elles ne sont pas comptabilisées dans le budget.
Mendax 25 octobre 2025 à 14h57
« …l’Ukraine est maintenant la meilleure armée de toute l’Europe. »
Avez-vous des données sur le nombre de désertions ( au fil du temps,si possible) ?
Vous cherchez des chiffres sur les désertions ukrainiennes, Lormier ? Les seules données publiques (Kyiv Independent, ISW, rapports OTAN) montrent des cas isolés, inévitables dans une guerre de cette intensité, mais aucune vague de désertion comparable à ce qu’on a vu côté russe. Allez voir vous-même, c’est facile à trouver.
Les Ukrainiens tiennent depuis trois ans contre une armée bien plus lourde, sans effondrement moral ni structurel.
Bref, si c’est ça, “le manque de motivation”, Moscou rêverait d’en avoir autant.
Mendax 25 octobre 2025 à 14h57
« …l’Ukraine est maintenant la meilleure armée de toute l’Europe. »
Peut-être faudrait-il reformuler:
« …l’armée ukrano-européo-américaine est maintenant la meilleure armée de toute l’Europe.
»
En effet,la couverture satellitaire ,l’identification des cibles, l’approvisonnenment en armes et munitions etc. tout cela est assuré par les Etats Unis et certains pays d’Europe. Le rôle des Etas Unis étant prépondérant.
La stratégie, le mouvement des troupes,la logisqtique, tout cela (ou presque ) est assuré depuis les postes de commandement américains aux Etats Unis et les basses américaines du continent européen.
Non. L’armée ukrainienne est aujourd’hui la meilleure d’Europe, pour une raison simple : c’est la seule qui combat une guerre de haute intensité depuis trois ans.
Elle a développé une expérience tactique, une capacité d’adaptation, et une résilience logistique que plus aucune armée européenne ne possède à ce niveau. Les Britanniques et les Français ont des forces de projection efficaces mais limitées ; les Allemands peinent encore à reconstituer leurs stocks ; les autres armées de l’UE n’ont ni les effectifs ni la doctrine pour soutenir un front de 1 000 kilomètres.
Quant à votre “armée ukrano-européo-américaine”, c’est une caricature. Oui, le renseignement satellitaire, l’armement et la formation viennent en partie des alliés, comme dans toute coalition moderne. Mais les Ukrainiens commandent, décident, et surtout combattent. Les pertes, les réorganisations, les innovations sur le terrain (drones, déminage, guerre électronique), tout cela vient d’eux.
Réduire cela à une armée télécommandée par Washington, c’est nier la réalité militaire et la souveraineté politique de l’Ukraine, autrement dit, reprendre la propagande russe, mot pour mot.
Je n’ai pas dit « télécommandée ».
Non, vous avez dit que le rôle des Etats-Unis était prépondérant. Il l’est de moins en moins car Trump veut se désengager de ce qu’il considère comme une « mauvaise affaire ».
L’Ukraine produit maintenant 50% de ses propres armes.
La fabrique de l’image:
https://pbs.twimg.com/media/G4CNK4SWMAA9wQ_?format=jpg&name=900×900
La fabrique de l’image:
https://pbs.twimg.com/media/G4CNK4SWMAA9wQ_?format=jpg&name=900×900
La fabrique de l’image:le peuple britannique fait un accueil triomphal à Zelenskyy.
Où cette photo a-t-elle été prise ?
Dans la cour du » Foreign and Commonwealth Office » cour fermée au public. S’il y a du public,c’est qu’il y a été amené…On lui a fourni les drapeaux.
La « coalition des volontaires » ne réunit qu’un petit nombre de volontaires.
C’est pas les brigades internationales de la guerre d’Espagne;c’est juste trou du cul Macron et trou du cul Starmer avec un budget pub.
Blood Groove: Myth. No such thing. See, Fuller.
Il y a bien une rainure pour l’écoulement du sang mais elle ne s’appelle pas comme ça.
A propos les planches à découper la viande ont rarement des rainures assez profondes pour recueillir toyut le sand du rôti qu’on découpe .Vous en aurez toujous sur votre nappe,sauf si…
NB ne pas confondre groove et grove.
Within the budding grove ne veut pas dire: »Dans la rainure en fleur » mais A l’ombe des jeunes filles en fleur.
(« groovy » : très utilisé dans les seventies.
Pas comme l’accueil du Zélensk’ dans » la cour du Foreign and Commonwealth Office » !
plus que jamais pitoyable la « coalition of the willing ».
Mais dans « trois, quatre ans », tous prêts à un « choc » contre la Russie ;
ça fait court pour formater tous les djeuns et les envoyer au combat – 😁)
(« la vraie guerre de la France c’est contre sa propre disparition » – Rougeyron)
Paul, dans la fiction Paul et Vanessa l’avait pressenti.
Rappel:
« Dieu est mort, mon pays est bâché, bâillonné, moribond, peu me chaut, car moi je rêve encore et grâce à toi, Sylvie, ma verge parabolique se redresse encore fièrement. »
https://fictionpauletvanessa.blogspot.com/?m=1
Encore un qui veut sauver la France avec sa pauvre bite et sans couteau…
Comme le Christ, Paul use de paraboles.
Je rappelle à D. que Paul est un prof de physique né dans une région déshéritée.
– Non, je ne veux pas que l’Ukraine soit dans l’OTAN !
– Pourquoi ?
– Parce que, si l’envie m’en venait, je ne pourrais plus l’envahir.
– Alors il faut envahir avant.
Mendax 25 octobre 2025 à 18h26
Non, vous avez dit que le rôle des Etats-Unis était prépondérant.
=========================================================
C’est bien de reconnaîttre que vous m’aviez attribué un propos que je n’ai pas tenu.
Merci.
« Non, vous avez dit que le rôle des Etats-Unis était prépondérant. Il l’est de moins en moins. »
S’il l’est de moins en moins, c’est qu’il l’ a été ou même qu’il l’est peut-être encore,n’est-ce pas ? Vous ne dites pas quand cette « prépondérance » a commencé à diminuer.
« Trump veut se désengager »
Absolument et même il a commencé.
A mon avis, il attend la capitulation de l’Ukraine pour s’entendre avec Poutine sur ce dont il peut s’emparer dans ce pays.
« L’Ukraine produit maintenant 50% de ses propres armes. »
L’Europe peut-elle fournir l’autre moitié ?
Mendax 25 octobre 2025 à 18h23
Moscou menace et l’Occident promet. C’est ça votre conception de la diplomatie ?
Non ,pas du tout;je me suis borné à expliciter votre propos;
Mendax 25 octobre 2025 à 18h20
Les Ukrainiens tiennent depuis trois ans contre une armée bien plus lourde, sans effondrement moral ni structurel.
Donc, comme dit -je crois- Pierre Lelloche, on va en ariver aux fondamnataux.
L’Ukraine perd beaucoup d’hommes ;plus la guerre dure, plus elle en perd.
A-t-elle des réserves démographiques suffisantes pour continuer ? Et jusqu’à quand ?
La Russie perd aussi beaucoup d’hommes, à un rythme peut-être plus rapide, mais sa population est bien plus grande.
Ces questions commencent à se poser ;d’ailleurs les stratèges français ont évoqué les 450 millons d’Européens, population bien plus nombreuse que celle de la Russie.
Macron n’a rien dit sur le nombre de pertes d’hommes français qu’il juge acceptable.
Je vous ai déjà dit il y a quelques mois que ce raisonnement était profondément simpliste pour ne pas dire idiot. Est-ce que l’URSS a gagné la guerre d’Afghanistan ? Les USA la guerre du Vietnam ? L’Empire britannique la guerre des Boers ? Athènes la guerre du Péloponnèse ?
L’histoire montre que la supériorité militaire brute ne garantit jamais la victoire quand l’adversaire est motivé, soutenu par des alliés extérieurs et capable de résister stratégiquement. L’Ukraine combine ces trois facteurs aujourd’hui.
La russie a perdu cette guerre dès 2022. C’était d’une stupidité crasse de continuer quand la Blitzkrieg a échoué. Démographiquement, économiquement, diplomatiquement, elle a déjà perdu beaucoup plus que ce qu’elle peut espérer gagner. Et elle ne gagnera pas, c’est aujourd’hui extrêmement improbable. Elle a perdu militairement son prestige, économiquement son avenir, politiquement une bonne partie de ses alliés et moralement son honneur.
Il ne lui reste que la peur et la répression pour tenir debout.
Alors ne vous inquiétez pas, ce n’est pas demain que Macron vous enverra au front. D’ailleurs, vous n’êtes plus mobilisable, je suppose ?
Mendax 25 octobre 2025 à 18h23
C’est ça votre conception de la diplomatie ?
Ma conception de la diplomatie est élémentaire,voire simpliste.
Le « moment diplomatique » essentiel c’est celui où la guerre n’a pas commencé et où on parle
à celui qui menace, pour tenter d’éviter la guerre .
Pour ce qui est de l’Ukraine, la phase diplomatique a été des plus brèves .
A aucun moment ,la position de la partie russe n’a été prise en compte. L’adversaire n’a pas été écouté. Tout auttre président que Macron aurait mieux fait que lui. Je ne dis pas qu’il aurait réussi;je dis qu’il n’aurait pas eu d’emblée pour objectif de faire échouer tout pourparler.
Il suivait les ordres de Washington.
Quelques court rappels :
– jusqu’à la dite « opération spéciale » russe, l’Ukr considérée comme un des pays les plus corrompus de la planète ; beaucoup s’y sont faits des kouilles en or – dont la famille Biden
– 2014… Accords de Minsk, signés pour ne pas être respectés – parfaitement explicité par le Nollande et la MèreKel
– Zélensk’ prêt à négocier (mars 2022, Turquie ) ; B. Johnson file illico à Kiev – ordre d’entrer en guerre
Les faits :
– L’Ukraine était un pays corrompu – au demeurant pas autant que la russie – mais ça ne donne en rien le droit à la russie de l’envahir. En fait, ça n’a strictement rien à voir. Imaginez une femme qui se fasse violer après avoir accepté un pot-de-vin : ça rend le crime moins odieux à vos yeux ?
– L’allusion à la famille Biden est une accusation gratuite fondée sur rien du tout.
– Les accords de Minsk ont d’abord été violés massivement par la Russie et les séparatistes, et ensuite seulement par l’Ukraine. Dire que c’était « signé pour ne pas être respecté » est faux : c’était un accord international que la Russie a choisi de ne pas respecter. Le « raisonnement » des prorusses est fondé sur un faux syllogisme : « Minsk a permis à l’Ukraine de se réarmer → donc Minsk était un complot contre la Russie → la guerre est la faute de l’Ukraine et de l’Occident. » Mais c’est un raisonnement spécieux : le fait que quelque chose profite à une partie ne rend pas automatiquement l’accord immoral, illégal ou “coupable. Affirmer que Minsk a permis à l’Ukraine de se réarmer et que c’est une faute, c’est comme dire que quelqu’un qui se protège d’une attaque profite de la situation et devient coupable. La seule faute ici, c’est l’agression initiale.
– Zelensky n’a jamais proposé de capituler. Il était prêt à négocier en 2022, mais a changé d’avis après le massacre de Butcha. Les visites occidentales n’étaient pas des ordres pour entrer en guerre : elles étaient de la solidarité et du soutien politique et militaire. L’Ukraine a décidé souverainement de défendre son territoire, personne ne l’a “ordonné” de l’extérieur.
Mais trois ans après, on continue à raconter les mêmes bobards, pourtant maintes fois démontés.
La « position de la partie russe » n’avait pas à être prise en compte. Elle était inacceptable. Je ne sais pas si vous le savez, mais en décembre 2021, Poutine a présenté à l’OTAN et aux États-Unis un ultimatum demandant notamment : aucun élargissement futur de l’OTAN à l’Ukraine ou la Géorgie, le retrait des forces et des exercices militaires de l’OTAN près de la Russie, et un droit de veto russe sur toutes les décisions stratégiques de l’Alliance.
Ce qui était non seulement inacceptable mais absurde à la fois diplomatiquement et juridiquement, c’est que ces exigences violaient les principes fondamentaux de souveraineté des États et de fonctionnement de l’OTAN : aucun pays ne peut légalement imposer à une alliance de refuser à un autre État le droit de rejoindre, et l’OTAN fonctionne par consensus, pas sous diktat extérieur. En pratique, c’était un ultimatum impossible à accepter et surtout un prétexte pour justifier une action militaire.
Et ces salopards continuent à pérorer depuis trois ans sur les « causes profondes » de la guerre. Mais ces causes profondes, ce sont leurs revendications imbéciles que personne ne les acceptera jamais, et surtout pas les Ukrainiens. Vous écoutez les revendications des criminels, vous ?
En somme, vous dites que toute diplomatie était impossible.
Logiquement, la seule réponse possible était l’entrée en guerre des « Alliés » contre la Russie.
Cela me rappelle ce qu’a dit Guaino:dans ce cas-là,il faut déclarer la guerre à la Russie.
Non, ce n’est pas ce que je dis. La diplomatie sert toujours à gagner du temps, protéger des civils, limiter les dégâts.
Et je ne pense pas qu’on doive déclarer la guerre à la russie. D’ailleurs la guerre ne se déclare plus. En revanche, la russie mène contre nous une guerre hybride depuis plus de quinze ans. Nous nous réveillons, mais beaucoup trop lentement.
Imaginez-vous sérieusement que les Européens (les gens, hein, pas les instances bruxelloises) sont prêts à entrer en guerre contre la Russie afin que les USA vendent leur gaz plus cher que ce que nous achetions le gaz russe ?
Non, je n’imagine pas ça tout simplement parce que ce n’est pas vrai. Heureusement, la question ne se pose pas, et certainement pas en ces termes.
Vous amalgamez faux dilemme, fausse causalité et procès d’intention.
Non, on ne soutient pas l’Ukraine pour “vendre du gaz”, on soutient un peuple qui se défend contre une invasion, pas pour équilibrer un marché énergétique. Croire le contraire, c’est préférer une théorie du complot au spectacle des villes bombardées et des familles brisées : c’est du confort intellectuel déguisé en lucidité.
Et de toute manière, c’est parfaitement idiot : Si demain, la France envoyait des troupes, ce qui est pour l’instant purement spéculatif, ce serait l’armée de métier. Vos hypothèses d’engagement militaire direct contre la russie sont des fariboles.
« on » (?!) « soutient un peuple qui se défend contre une invasion »,
« spectacle des villes bombardées et des familles brisées »… :
ça s’passe aussi comme ça… ailleurs… et ça continue…
Vous plaisantez. Aucune guerre, jamais, n’a été engagée pour des motifs moraux. Mais pour des raisons politiques (Clausewitz) et économiques.
Ah ? Alors vous admettez que le rat du Kremlin n’a pas envahi l’Ukraine pour protéger les minorités russophones ou pour tuer d’hypothétiques nazis ukrainiens ?
C’est vous qui parlez de raisons morales, pas moi. (Et au passage, bravo pour l’homme de paille, ça en dit long sur votre probité intellectuelle.)
Soutenir l’Ukraine, ce n’est pas de l’idéalisme, c’est du réalisme stratégique. Parce que laisser la russie gagner, ça signifie que les pays baltes, la Pologne, puis le reste de l’Europe seront les prochains à être menacés. Et ne venez pas me dire que c’est de l’ordre du fantasme, les russes sont parfaitement explicites à cet égard depuis des années.
Ce que vous appelez morale n’est qu’un effet secondaire de la lucidité. Les dirigeants décident d’entrer en guerre pour des motifs politiques et économiques, mais cela n’empêche pas que ces motifs puissent se teinter de nuances criminelles ou au contraire de nuances morales.
Alors votre déclaration sur le gaz… Cette guerre coûte cher à tout le monde mais il n’y a qu’un seul responsable, et si on le laisse gagner, le prix du gaz sera vraiment le cadet de nos soucis.
Nous avons tout intérêt à aider l’Ukraine pour des raisons parfaitement objectives. Mieux vaut que les Russes soient bloqués à Kherson que combattus à Varsovie.
« ça fait court pour formater tous les djeuns et les envoyer au combat », ai-je écrit plus haut.
Y’a bien les « NEETS» – neither in employment education or training –
15 à 29 ans,
de plus en plus nombreux,
France (13 % en 2024, 1,4 millions *)
GB (« 900,000 young people estimated to be neet » **)
mais ça ne va pas être facile… ! 😁
(* conf « Cercle des Economistes », 06/25)
(** feweek.uk – Further Education, skills & apprenticeships news)
Un visionnaire (Sylvain Kahn):e la guerre contre la Russie va naîtr un nouvel Etat;
« La séquence que nous vivons, j’en suis persuadé, va déboucher sur la création d’un Etat européen sans que les acteurs gouvernementaux en aient forcément conscience : comme l’a noté Charles Tilly, le regretté sociologue et politiste américain, la guerre a fait l’Etat et l’Etat a fait la guerre. Ce sera certes un Etat baroque au sens architectural du terme, tout en irrégularité et en absence de ligne droite : ce ne sera pas un Etat au sens classique du terme, il y aura de l’intergouvernemental et du fédéral mélangés ; du national, du réseau et du supranational intriqués. »
https://www.liberation.fr/international/europe/defense-une-partie-des-europeens-dont-les-francais-nont-pas-conscience-de-la-menace-russe-20251022_C6YNPKZZWNG6PPSDQFWRWFVJ5Q/
Je ne connaissais pas ce Chrles Tilly ,auteur de la formule » les Etats font la guerre, les guerres font les Etats ».
J’ai trouvé cet article de 18 pages.
WARMAKING. AND STATEMAKING –
AS ORGANIZED CRIME
. .
Charles Tilly , .
University of Michigan –
February-, 1982
https://backend.production.deepblue-documents.lib.umich.edu/server/api/core/bitstreams/8cace32e-9e0f-4080-a696-4b29190d6912/content
L’Otan – organisation de l’Atlantique nord – fondée en… 1949, parapluie ricain, devrait s’étioler,
les choses se passant maintenant du côté du… Pacifique.
Le discours va-t-en-guerre de l’Europe de l’Ouest pourrait donc petit à petit s’affaiblir – même s’il y a volonté de reconstruire une (des) armée(s).
D’ailleurs Trumpy commence son grand tour (« importante tournée » !) … en Asie, après escale dans le Golfe (Qatar).
(Et cette « tension » au Venezuela prépare-t-elle un regain d’intérêt pour le continent sud-américain ?!)
Le M. :
– « L’allusion à la famille Biden est une accusation gratuite fondée sur rien du tout. »
Ah bon ?!
Même wiki y va de son couplet !
(« Hunter Biden »
et « Burisma Holdings » (« l’un des plus grands producteurs privés de gaz naturel d’Ukraine »,
etc)
– « guerre hybride » : que dire de la guerre (économique) que nous mène les Ricains avec leur grande spécialité : l’extraterritorialité (!),
et tout ce qu’ils nous ont volé – dernier grand coup « l’affaire Alstom » !
Mélanger Hunter Biden et Burisma pour accuser Joe Biden, c’est prendre un fait isolé pour inventer un complot. Trouvez-moi une source FIABLE qui PROUVERAIT que la famille Biden ait été impliquée dans des faits de corruption en Ukraine et on en reparle. Sinon, c’est du même niveau que d’accuser quelqu’un d’un meurtre simplement parce qu’il a des couteaux dans sa cuisine.
Et comparer l’Alstom ou les règles de concurrence à l’invasion militaire russe en Ukraine, c’est confondre la paperasse avec les chars.
Bref, c’est de la propagande, pas de l’argumentation.
Mendax 25 octobre 2025 à 23h22
Alors ne vous inquiétez pas, ce n’est pas demain que Macron vous enverra au front. D’ailleurs, vous n’êtes plus mobilisable, je suppose ?
Non ,je ne suis pas mobilisable.
Mais j’aime mon prochain et ne suis pas préoccupé que par ma petite personne;et puis, à mon âge ,on a des arrières-petits-neveux, toute une ribambelle de jeunes gens de divers âges qu’on n’a pas envie de voir se faire massacrer à cause de Macron.
IAL offre son expertise et Zelentski la dédaigne
Mendax 25 octobre 2025 à 22h33
La « position de la partie russe » n’avait pas à être prise en compte.
Autre façon de dire que toute diplomatie était impossible.
Eh bien tout dépend de ce que vous appelez diplomatie. Les exigences de poutine en décembre 2021 n’entrent pas dans la définition commune de ce mot : c’était un ultimatum.
Si vous étendez la définition au crime et à la coercion, à vous de voir si ce type de diplomatie était acceptable pour les pays concernés.
Mais avant que quelqu’un revienne ici me parler du « droit du plus fort » (tellement prévisible), je vais me permettre de citer moi aussi Clausewitz :
« Qu’est ce que le concept de défense ? Parer un coup. Quel est alors son signe caractéristique ? L’attente de ce coup. C’est ce signe qui donne à toute chose un caractère définitif, et seul ce signe peut en guerre distinguer la défense de l’attaque. Mais dans la mesure où une défense absolue contredit entièrement le concept de la guerre, car la guerre serait alors menée que d’un seul côté, il en découle qu’en guerre la défense ne peut être que relative. »
« La forme défensive de la guerre n’est donc pas un simple bouclier, mais un bouclier formé de coups habilement donnés. »
« Il est plus facile de conserver que d’acquérir ; d’où il suit immédiatement que les moyens étant supposés égaux des deux côtés, la défense est plus facile que l’attaque. »
« La forme défensive de guerre est en soi plus forte que l’offensive. »
Si le rat du Kremlin avait lu Clausewitz, il se serait rendu compte que ce ne serait pas si facile que ça de conquérir l’Ukraine. Ce n’est pas tout d’être le plus fort, il faut aussi parvenir à le rester. Et là…
Mendax 21 octobre 2025 à 12h37
La guerre vide la Russie de ses forces vives : 1,5 million de travailleurs manquent, dont 400 000 dans l’industrie d’armement (PISM).
Mendax 25 octobre 2025 à 12h34
Ce n’est pas la guerre qui ruine les peuples,
=========================================================
Peut-on concilier ces deux propositions ?
Oui.
Ce n’est pas la guerre qui ruine les peuples, SAUF LE PEUPLE RUSSE
Reste à expliquer pourquoi la guerre ruine les Russes mais pas les Ukrainiens.
Et puisque les Russes (dixit Mendax) ont déjà perdu, pourquoi s’inquiéter des opérations qu’ils pourraient lancer contre nous.
Ecrasons-les.
Ce visionnaire de Sylvain Kahn célèbre à l’avance l’avènement du nouvel Etat, né de la guerre.
Comme il s’appuie sur Charles Tilly et que Charles Tilly dit que les Etats nés des guerres sont des organisations criminelles, on peut dire que Sylvain Kahn se réjouit de l’apparition prochaine d’une nouvelle organisation criminelle.
Mendax 25 octobre 2025 à 22h33
« le retrait des forces et des exercices militaires de l’OTAN près de la Russie »
Ca ne me paraît pas être une demande exorbitante;
D’ailleurs, Kennedy n’avait pas voulu de missiles russes à Cuba.
Tiens, ça faisait longtemps ! Je suis heureux de voir que vous n’avez pas oublié votre catéchisme. Mais je vous l’ai déjà dit, ça ne remplace pas une véritable argumentation. Arrêtez de croire et vous serez libre.
La crise de Cuba concernait le déploiement d’armes nucléaires offensives à 150 km du territoire américain. L’OTAN, elle, n’a jamais placé de missiles nucléaires en Ukraine, ni menacé la Russie. Les troupes déployées à l’Est sont défensives, limitées et transparentes (avec inspections possibles). Rien à voir avec Cuba.
Personne n’a “forcé” la Russie à avoir des voisins indépendants. Les pays baltes et la Pologne ont choisi librement d’adhérer à l’OTAN — précisément parce qu’ils craignaient une agression russe. Donc, dire que leur défense menace Moscou, c’est inverser cause et conséquence.
L’OTAN n’a jamais envahi personne. La russie, si : Tchétchénie, Géorgie, Crimée, Donbass, Ukraine entière. Il est absurde de comparer une alliance défensive démocratique avec un régime impérialiste autoritaire.
Enfin, si la russie n’avait rien à craindre, elle n’aurait pas besoin d’envahir ses voisins pour se “protéger”. Et si le but était réellement de freiner l’OTAN, ils ne sont quand même pas très doués : l’alliance a maintenant été élargie à la Finlande et à la Suède. Là aussi, belle illustration de l’ironie tragique. Alors ne venez pas me parler de diplomatie : le rat a exigé quelque chose d’inacceptable pour avoir le prétexte de déclencher une guerre qu’il est maintenant infoutu de gagner ; les conséquences pour son pays sont catastrophiques et il continue d’avoir les mêmes exigences maximalistes ? Comment qualifiez-vous pareil spécimen ? Et comment peut-on encore prendre son parti ? Ce type n’est pas seulement un monstre, c’est un imbécile hors catégorie.
C’est amusant de voir à quel point « l’argumentaire » des prorusses est pauvre et peu varié. Leur dieu est mourant et la litanie idéologique ne le sauvera pas.
Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to
go back the want?.I am attempting to find issues to improve my web site!I suppose its adequate to
make use of a few of your concepts!!
My page about
..on a des arrières-petits-neveux..
Décidement cet imbécile aura été sa vie durant un improductif sur tous les plans.
Et le retour de l’insipide Mendax..c’est qu’ailleurs personne ne le retient.
Ce blog ressemble de plus en plus au « huis clos » de Sartre, avec un bronze de Barbedienne sur la cheminée et cet emprisonnement journalier dans un enfer à feu doux.
Ou bien, à un « Groundhog Day », une répétition absurde, mais sans happy end, et qui dessert et notre hôte et ceux -et celles- qui s’invitent chez lui.
Dommage
Un avantage toutefois : qu’on lise à l’envers, à l’endroit où qu’on survole aléatoirement on ne perd jamais le « fil ».
Le patron de verisure propose un abonnement anti intrusion au Louvre et espère y caser tout son matos obsolète.
Toujours pas de réponse à sa proposition de surveillance du front russo-ukrainien.
Deux observations, dont l’une de détail historique.
Mendax dit que dans les guerres entre puissances inégales, c’est le moins puissant en apparence, qui finit par gagner :
» Est-ce que l’URSS a gagné la guerre d’Afghanistan ? Les USA la guerre du Vietnam ? L’Empire britannique la guerre des Boers ? ».
Sans vouloir prendre parti ( l’histoire offre certainement des d’exemples du contraire ), ce sont bien les Britanniques qui ont gagné la guerre des Boers ( avec pas mal de difficultés il est vrai ). Ajoutons que très peu après, les Britanniques ont remis les territoires conquis sous l’administration des Boers , préférant les associer a l’empire plutôt que de les avoir en permanence comme ennemis intérieurs.
2eme remarque, centrée sur le débat principal.
Mendax dit :
» Si demain, la France envoyait des troupes, ce qui est pour l’instant purement spéculatif, ce serait l’armée de métier. Vos hypothèses d’engagement militaire direct contre la russie sont des fariboles. »
Hum. Envoyer l’armée de métier ne serait donc pas un engagement direct ? Et comment la Russie apprecierait- elle cet engagement qui se voudrait ( si je comprends bien) partiel et non total ( plus que direct ou indirect ) ?
Avec sagesse, se contentant de lutter contre des troupes françaises sur le terrain ukrainien, ou de façon véhémente, par exemple en envoyant ses drones bombarder nos villes : techniquement je suopise que ce n’est pas impossible, même si l’espace entre la Russie et la France ( entièrement aux mains des alliés membres de l’OTAN) laisse sans doute peu de chances aux drones ou missiles russes ( à expertiser) ?
« Mendax dit que dans les guerres entre puissances inégales, c’est le moins puissant en apparence, qui finit par gagner. »
Non, je dis que ce n’est pas TOUJOURS le plus puissant qui finit par gagner. Vous saisissez la nuance ? Je répondais à l’argument de Lormier.
Vous avez parfaitement raison pour la guerre des Boers. Mon exemple était mal choisi.
Et ce que vous dites au sujet des drones est vrai également. Je vous ferai même remarquer que ceux-ci n’ont pas forcément à traverser l’espace entre la russie et la France : Ils peuvent partir de n’importe où. C’est le danger le plus important aujourd’hui – et il ne vient pas uniquement des russes.
« Mendax dit que dans les guerres entre puissances inégales, c’est le moins puissant en apparence, qui finit par gagner. »
Le théorème de Mendax a-t-il des corolaires ?
techniquement, je suppose etc
« Verisure » ou fake news ?
« deux des malfaiteurs impliqués dans ce vol au retentissement planétaire ont été interpellés samedi soir. L’un à Roissy alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour l’Algérie. »
« Dans le même temps, un deuxième a également été arrêté par la police judiciaire de Paris en Seine-Saint-Denis. »
(lefigaro)
« Verisure » ou fake news ?
« deux des malfaiteurs impliqués dans ce vol au retentissement planétaire ont été interpellés samedi soir. L’un à Roissy alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour l’Algérie. »
« Dans le même temps, un deuxième a également été arrêté par la police judiciaire de Paris en Seine-Saint-Denis. »
(lefigaro)
(😁)
(désolée pour la répétition – erreur tactic)
« Ce blog…qui dessert et notre hôte et ceux -et celles- qui s’invitent chez lui
Dommage » (lfdh)
Je suis consternée ; j’aimerais être capable de parler par exemple littérature, à l’égal d’un Dugong qui va s’enfiler 8 tomes d’Histoire ;
et bien, pour le moment je me cantonne* à quelques polars :
– « Hong-Kong* noir » de Ho-Kei Chan ; on ne rit* pas toujours jaune* dans cette enclave brit’ avant la rétrocession de 1997,
– L’épidémie d’Åsa Ericsdotter ; encore mieux que « l’affaire covid » – sauf que le responsable finit en prison – « on » (!) se rappelle peut-être qu’en Nouvelle Zélande, « on » parlait d’isolement dans des camps de ceux qui refusaient le vaccin ; d’autre part, personne ne s’est étonné de la démission précipitée de Jacinda Ardern (1er ministre),
– actuellement dans « Le Passager » de JC Grangé ; sortant de l’ordinaire…
– je terminerai par le (grand) A. Perez-Reverte avec « Le tableau du maître flamand » (il était temps de le lire !)
(* encore une fois, loin du maître Dugong)
Hervé m’aime d’un amour paradoxal. Il m’a dissuadé d’écrire des romans, et voudrait maintenant que je ferme le blog. Quel but poursuit-il ?
« Dugong qui va s’enfiler 8 tomes d’Histoire »
Je saute les passages qui ont trop plongé dans des bains idéologiques corrosifs…
https://www.oca.eu/fr/actualite/5517-anniversaire-des-10-ans-le-theoreme-de-stephen-hawking-sur-la-surface-des-trous-noirs-est-confirme-par-les-ondes-gravtationnelles#:~:text=Lorsque%20des%20trous%20noirs%20fusionnent,final%20qui%20r%C3%A9duit%20sa%20surface.
P…n 10 ans !
Mendax 26 octobre 2025 à 9h19
« Mendax dit que dans les guerres entre puissances inégales, c’est le moins puissant en apparence, qui finit par gagner. »
Non, je dis que ce n’est pas TOUJOURS le plus puissant qui finit par gagner.
=========================================================
En effet.
Je m’étonne d’ailleurs qu’ECHO se laisse aller à ce genre de gauchissement. Ce n’est pas son genre.
Subirait-il,inconsciemment, votre influence ?
Mendax 26 octobre 2025 à 6h30
Tiens, ça faisait longtemps ! Je suis heureux de voir que vous n’avez pas oublié votre catéchisme.
===========================================================
Quel « catéchisme » ?
J’ai isolé, parmi les demandes de Poutine, celle qui ne me paraît pas exorbitante (les autres,comme l’exigence d’un désarmement complet de l’Ukraine l’étant,évidemment.)
Vous feignez de ne pas le voir -forme subtile de gauchissement.
« La crise de Cuba concernait le déploiement d’armes nucléaires offensives à 150 km du territoire américain. L’OTAN, elle, n’a jamais placé de missiles nucléaires en Ukraine… »
Argument macaronique (ta-mère-la-pute)
i) Un missile à longue portée peut être équipé d’une tête nucléaire ou pas nucléaire. (exemple:le Tomahawk).
ii) En 60 ans, les armes ont beaucoup progressé,de sorte que la distinction nucléaire/non-nucléaire est oiseuse. Il existe des armes non nucléaires tout aussi destructrices que les bombes atomiques. La différence:elles ne rendent pas un territoire inhabitable pour des siècles.
iii) Je serais russe, je n’aurais pas envie que les Américains installent des armes de destruction massive à ma frontière.
iv) « L’OTAN, elle, n’a jamais placé de missiles nucléaires en Ukraine… »
Manquerait plus que ça !
Le projet américain du temps des « faucons », c’était bien d’installer des bases en Ukraine, les dizaines de bases dont ils dispsent en Europe ne leur suffisant pas.
Alors ne venez pas me parler de diplomatie : le rat a exigé quelque chose d’inacceptable pour avoir le prétexte de déclencher une guerre qu’il est maintenant infoutu de gagner
Ce n’est pas moi qui viens vous parler de diplomatie. Je vous ai rappelé la position de Mearsheimer: même un accord de cessez-le-feu est impossible actuellement.
Je croyais que vous étiez d’accord avec lui sur ce point.
Moi, en tout cas,il m’a convaincu.
C’est la position de Von Der Leyen et de la coalition « of the willing » qui est confuse.
Ils en sont encore à évoquer un cessez-le-feu et une paix « robuste »…obtenue grâce aux sanctions
Pourquoi les stratèges français évoquent-ils les 450 millions d’Européens, s’ils n’enviagent pas la possibilté d’une mobilisation ?
« Mais a-t-on le temps face au danger existentiel de la Russie, mais aussi désormais des Etats-Unis de Donald Trump qui tentent de déstabiliser nos démocraties ?
[Sylvain Kahn] C’est vrai. Mais quand le Covid est apparu, l’Union n’avait pas le temps et pas de compétences dans ce domaine et pourtant les décisions ont été prises très rapidement. C’est pareil avec la défense. Le tempo s’accélère. Regardez la façon dont les Européens ont réussi à augmenter leur production d’obus de 155 mm : avec quelques mois de retard sur le calendrier initial, l’Union en produit désormais plus que les Américains. Ce résultat impressionnant nous rappelle que l’Europe est un très vieux continent doté d’un patrimoine industriel et d’un savoir-faire économique inégalables dès lors qu’il est mobilisé. La séquence que nous vivons, j’en suis persuadé, va déboucher sur la création d’un Etat européen sans que les acteurs gouvernementaux en aient forcément conscience … »
Ca, c’est très intéressant:les néo-mengeléiens vaccinolâtres sont aussi des bellicistes,partisans d’une gurre qui permettra l’avènement d’un nouvel Etat criminel.
Le raisonnement:voyez comme nous avons été capables de faire subir à des millions de citoyens européesn,d’êtres humains européens, une expérimentation au mépris du Code de Nurmberg.
Si nous avons réussi à traiter la personne humaine en cobaye, nous pouvons réussir à déclencher une guerre, d’où naîtra un nouvel Etat.
Ce Sylvain Kahn est,dit-on très introduit à Bruxelles.
Von Der Leyen a tenu des propos un peu édulcorés, moins sidérants que ceux de ce « vidionnaire » mais elle aussi a cité l’exemple de l’expérimentation néo-mengeléienne pour dire que l’Europe était capable de faire plier la Russie, grâce au réarmement.
https://www.liberation.fr/international/europe/defense-une-partie-des-europeens-dont-les-francais-nont-pas-conscience-de-la-menace-russe-20251022_C6YNPKZZWNG6PPSDQFWRWFVJ5Q/
La mauvaise monnaie chasse la bonne. Lormier s’est parfois laissé aller à reprendre la traduction erronée mais très répandue de « coalition of the willing ».
Ce nest PAS la coalition des « volontaires ». Volontaire se dit « volunteer ».
Cette « coalition » n’a pas de troupes. Pour l’essentiel, elle se réduit à deux trous du cu qui sont actuellement aux affaires.
khuL
Jean-Paul Brighelli 26 octobre 2025 à 11h41
Il m’a dissuadé d’écrire des romans…
Plus exactement, « tenté de me dissuader »…ce qui est un signe de présomption pathologique ?
Croire qu’on peut dissuader le Maestro !!!
Je me souviens, Maestro. Au début vous avez fait la coquette chichiteuse: » je n’enverrai pas mon manuscit aux éditeurs. Ils savent qu’il existe. Qu’ils viennent me supplier de le leur confier, et j’aviserai. »
Dugong 26 octobre 2025 à 9h33
« Mendax dit que dans les guerres entre puissances inégales, c’est le moins puissant en apparence, qui finit par gagner. »
Le théorème de Mendax a-t-il des corolaires ?
=========================================================
Il n’y a pas de théorème de Mendax;Mendax n’a pas dit ça.
Mais Dugong aime semer la merde.
Cépafo mais, avec votre air con à la vue basse votre spécialité reste quand même d’envoyer le contenu de la fausse sceptique dans le ventilateur.
Dugong 26 octobre 2025 à 11h46
« Dugong qui va s’enfiler 8 tomes d’Histoire »
Je saute les passages qui ont trop plongé dans des bains idéologiques corrosifs…
En revance, vous vous êtes rué sur le chapitre (abondamment illustré ) intitulé:
« Aide internationale et dévelopement de la prostitution. »
Ou plutôt sur les PAS qui ne signifient pas Plans d’Ajustement Structurel mais Plans d’Ajustement Sexuel…
Et le mec ensigne à Sciences Po !
« La séquence que nous vivons, j’en suis persuadé, va déboucher sur la création d’un Etat européen sans que les acteurs gouvernementaux en aient forcément conscience : comme l’a noté Charles Tilly, le regretté sociologue et politiste américain, la guerre a fait l’Etat et l’Etat a fait la guerre. Ce sera certes un Etat baroque au sens architectural du terme, tout en irrégularité et en absence de ligne droite : ce ne sera pas un Etat au sens classique du terme, il y aura de l’intergouvernemental et du fédéral mélangés ; du national, du réseau et du supranational intriqués. »
https://www.liberation.fr/international/europe/defense-une-partie-des-europeens-dont-les-francais-nont-pas-conscience-de-la-menace-russe-20251022_C6YNPKZZWNG6PPSDQFWRWFVJ5Q/
S.Kahn sur l’état européen en gestation:
» Ce sera certes un Etat baroque au sens architectural du terme, tout en irrégularité et en absence de ligne droite : ce ne sera pas un Etat au sens classique du terme, il y aura de l’intergouvernemental et du fédéral mélangés ; du national, du réseau et du supranational intriqués »
D’une certaine façon, c’est déjà le fonctionnement de l’UE.
Qu’ y aura t il de plus? Un volet militaire , une plus grande intervention du niveau fédéral dans les finances des Etats » nationaux » ( ou Etats fédérés) ou ce qui en restera ?
Prophétie finalement sans originalité puisque c’est à peu près ce qui existe déjà.
a) description assez floue ( « du national, du réseau et du suprantional intriqués »)
b) « sans que les acteurs gouvernementaux en aient forcément conscience » un peu embêtant ,non ? Et les citoyens ? Ils vont se réveiller un beau matin ,citoyens d’un Etat intriqué,sans avoir été prévenus de rien ?
c) »S.Kahn sur l’état européen en gestation »
Je ne crois pas qu’il le considère comme étant en gestation.Selon lui,il naîtra tout à coup de la guerre, comme Athena, sortant toute armée de Zeus (tête ou cuisse, je ne sais pas).
Et il aura la structure d’une organisation criminelle (référence au « grand » penseur Charles Tilly.)
Est-ce l’Etat dont rêve Josip Crapulovic ? Mendax?
L’Europe actuelle n’est pas un Etat et ce n’est pas tout à fait une organisation criminelle,même si elle est responsable d’un crime néo-mengeléien contre les citoyens d’Europe.
Dugong 26 octobre 2025 à 15h35
Ou plutôt sur les PAS qui ne signifient pas Plans d’Ajustement Structurel mais Plans d’Ajustement Sexuel…
Vous revivez sans danger les plus belles heures de votre vie…
« Plans d’Ajustement Sexuel… »
« Vous revivez sans danger .. »
Danger de péché ?
Oui…
« Ce sera certes un Etat baroque au sens architectural du terme, tout en irrégularité et en absence de ligne droite »
Un Etat aberrant ?
Oui…
Par exemple, à la lecture du paragraphe exaltant une sorte de romantisme de la « non-science » * africaine, j’ai repensé à la l’aventure spatiale de Mobutu au début des années 70 :
https://usbeketrica.com/fr/article/la-folle-histoire-d-un-programme-spatial-dans-le-zaire-des-seventies
On a les Von Braun qu’on peut.
* n’avoir inventé ni la poudre ni la boussole
(!! – 😁)
Dugong 26 octobre 2025 à 15h40
» votre spécialité reste quand même d’envoyer le contenu de la fausse sceptique dans le ventilateur. »
Un talent dont je n’avais pas conscince.
complotisme sans conscience…
« Un talent dont je n’avais pas conscince. »
Conscience du pas ?
Oui…
Lormier
L’Europe actuelle n’est pas un Etat et ce n’est pas tout à fait une organisation criminelle,même
Alors, qu’est – ce que l’UE ?
« Aussi, on préfère souvent voir en l’UE une entité sui generis[80], formant une catégorie à elle seule et n’entrant dans aucune autre. Les Allemands, les Autrichiens et les Belges germanophones donnent à ce type de structure le nom de staatenverbund, terme allemand sans équivalent dans d’autres langues mais qui revient à penser en termes de gouvernance multi-niveau[81] : comme dans une fédération, il y a une entité supérieure aux États ; mais bien que les compétences de celle-ci dans certains domaines relèvent d’un transfert de souveraineté, les États membres restent unitaires (à moins d’être déjà fédéraux comme l’Allemagne, l’Autriche ou la Belgique)[82]. Pour Robert Schütze, l’Union européenne rompt avec la tradition juridique européenne en basant son fonctionnement sur l’idée d’une « souveraineté divisée » qui est une combinaison des niveaux nationaux et international. En ce sens, l’Union européenne ne serait pas un État fédéral, ni une confédération, mais une « fédération d’États »[83]. »
Hum…
Wikipedia, art Union européenne
Danger de péché ?
CHanger de péDé ?
Oui
Le pétrel des tempêtes.
« Burevstnik » en russe. C’est le nom choisi par les Russes pour leur nouveau missile à propulsion nucléaire (qui vient d’être teté,avec succès disent-ils);
https://www.youtube.com/watch?v=JN3kIf2cC1U
Burevestnik
« . qui vient d’être teté,… »
teté a tâtons ?
Oui….
Le nombre de trucs qui se sont appelés « burevestnik » ! Du recyclage.
https://en.wikipedia.org/wiki/Burevestnik
Chant du burevestnik,par Maxime Gorki ,1901 (ne pas perndre « buervesnik » au sens scintifique
de « péterl des tempêtes »mais plutôt au sens de:oiseau annonciateur de la tempête
Up above the sea’s grey flatland, wind is gathering the clouds. In between the sea and clouds proudly soaring the Petrel, reminiscent of black lightning.
Glancing a wave with his wingtip, like an arrow dashing cloudward, he cries out and the clouds hear his joy in the bird’s cry of courage.
In this cry — thirst for the tempest! Wrathful power, flame of passion, certainty of being victorious the clouds hear in that bird’s cry.
Seagulls groan before the tempest, — groan, and race above the sea, and on its bottom they are ready to hide their fear of the storm.
And the loons are also groaning, — they, the loons, they cannot access the delight of life in battle: the noise of the clashes scares them.
The dumb penguin shyly hiding his fat body in the crevice . . . It is only the proud Petrel who soars ever bold and freely over the sea grey with sea foam!
Ever darker, clouds descending ever lower over the sea, and the waves are singing, racing to the sky to meet the thunder.
Thunder sounds. In foamy anger the waves groan, with wind in conflict. Now the wind firmly embraces flocks of waves and sends them crashing on the cliffs in wild fury, smashing into dust and seaspray all these mountains of emerald.
And the Petrel soars with warcries, reminiscent of black lightning, like an arrow piercing the clouds, with his wing rips foam from the waves.
So he dashes, like a demon, —proud, black demon of the tempest, — and he’s laughing and he’s weeping . . . it is at the clouds he’s laughing, it is with his joy he’s weeping!
In the fury of the thunder, the wise demon hears its weakness, and he’s certain that the clouds will not hide the sun — won’t hide it!
The wind howls . . . the thunder rolls . . .
Like a blue flame, flocks of clouds blaze up above the sea’s abyss. The sea catches bolts of lightning drowning them beneath its waters. Just like serpents made of fire, they weave in the water, fading, the reflections of this lightning.
—Tempest! Soon will strike the tempest!
That is the courageous Petrel proudly soaring in the lightning over the sea’s roar of fury; cries of victory the prophet:
—Let the tempest come strike harder!
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Song_of_the_Stormy_Petrel
Pour que nous chiions dans nos frocs, Poutine vient de diffuser un petit film;il s’enquiert auprès de son état -major du vol test du Burevestnik qui vient de parcourir 14 000 km;in détectabl, irratrapable, on peut le faire changer de direction à volonté. Encore plus dangereux que l’Oreshnik qui était déjà gratiné.
http://kremlin.ru/events/president/news/78301
(Pfff ! D’ici « trois, quatre ans », not’ pays sera prêt pour un « choc » contre la Russie, a affirmé l’État-major – major ?! – Epicetou.)
Curieux comme certains se délectent avec gourmandise des menaces annoncées, vérifiées ou non, faites par les « hommes forts » qu’ils admirent.
De qui parlez-vous ? Si c’est de Lormier,il vous dira que vous ne faites pas preuve ce jour d’une grande finesse d’interprétation. C’est décevant. Il m’avait semblé que vous saviez lire
En fait vous plaquez vos a priori,;si on vous demandait de justifier le mot « gourmandise » ,vous seriez bien en peine de le faire.
Quant au « Pour que nous chiions dans nos frocs », apparemment cela a échappé à votre regard.
La gourmandise consiste à (re)mâcher avec un évident plaisir des nourritures ou des mots dans un but de satisfaction des sens mais nullement des besoins vitaux… avec probablement une tendance compulsive. Il y a plusieurs manières de propager les menaces : pour avertir, faites attention, preparez-vous… ou bien pour s’auto-dénigrer et même, parfois, attendre la punition avec impatience, sachant qu’on aura soi-même pas très longtemps à la subir.
« évident plaisir » L’évidence,c’est bien pratique;elle n’a pas à être démontrée .
Je n’ai pas l’habitude de parler ausssi sèchement,mais, franchement, votre explication de texte est nulle.
Et si vous nous disiez deux mots des visions de Monsieur Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po ?
La mise en orbite du Spoutnik (1957) avait déclenché une certaine panique chez les Américains, et une réaction plutôt saine.
Quoi ,les Russes n’étaient pas que des moujiks arriérés,alcooliques et quasi-illettrés comme les Américains s’étaient complus à le croire ?
Vite, vite, renforcement de l’enseignement des sciences…
Maintenant, c’est un peu la même chose.
On se berçait d’illusions, on croyait que les Russes récupéraient des micro-processeurs sur des machines à laver pour faire voler des avions datant de la seconde guerre mondiale…
On s’aperçoit qu’ils sont capables de détruire des armes ultra-modernes livrées par les EU;on s’aperçoit qu’ils seraient fort capables de nous infliger de lourdes pertes si,inspirés par les deux trous du cul de la « coalition des bien disposés », nous nous lancions dans une guerre contre eux.
Evidemment que Poutine bluffe…mais il ne faut pas le prendre à la légère.
Il faut mesurer les risques, non ?
Je trouve ahurissant que dans un quotidien généraliste, un journaliste à peu près raisonnable, donne la parole à un mec dont la place est à Sainte-Anne.
Et ce mec, il enseigne à Sciences Po.
« Vite, vite, renforcement de l’enseignement des sciences… »
Ah les éditions MIR !
Sans oublier une sélection précoce et sans pitié.
WTH 26 octobre 2025 à 19h39
(Pfff ! D’ici « trois, quatre ans », not’ pays sera prêt pour un « choc » contre la Russie, a affirmé l’État-major – major ?! – Epicetou.)
=========================================================
Rappel de quelques paragraphes précédents
i) Les instances européennes (grossso modo la commission et,en fin de compte, Von der Leyen munie d’un téléphone) ont réussi à imposer aux citoyens d’Europe une expérience mengeléienne. Van der Leyen s’en vante.
ii) Ces mêmes instances,accompagnées de deux trous du cul, envisagent tranquillement, sans rien demander à personne, de nous faire entrer en guerre contre la Russie.
iii) La préparation est bien avancée:nous sommes déjà passés à l’économie de guerre.
« hommes forts » (Hcc1) –
En mode France, des gars (et même des filles) qui ont réussi à couler le pays, comme jamais : Agriculture (vivement le sale bœuf du Mercosur), Industries, EN, Santé, Justice, Police, Armée…
La France, pas le seul pays à être touché (par le virus),
au point que d’aucuns ont été jusqu’à nommer ce mouvement (!) le « suicide de l’Europe » ;
ça y ressemble, puisque, rien n’a été fait, depuis des décennies, pour tenter d’arrêter le déclin.
Parmi les gars particulièrement doué en ce domaine, le Cramon fait l’unanimité, et même à l’étranger ;
partout moqué et en conséquence le pays dont il est le représentant :
ainsi sur toute la planète, le « vol du Louvre » a fait la Une ; normal (même dans la Presse chinoise).
Jusqu’à la (toute petite) « affaire de la montre » du benêt lfiste, commentée par le Javier Milei.
burevestnik l’aboutissement (?) d’un projet lancé en 2018. Ce n’est qu’un épisode de la course aux armements.
https://www.nytimes.com/2025/10/26/world/europe/russia-burevestnik-missile.html
14000 km en 15 h c’est du trainspotting !
Pour une fois, le furoncle orange a une réplique sensée :
https://mstdn.social/@noelreports/115445035810610140
tété a tâtons
tétONs a tâtER
« Burevestnik » ou la bouilloire nucléaire. On se rappellera les débuts de Renault en formule 1 avec la technologie turbo. Le moteur explosait régulièrement en fin de course valant à cet engin le sobriquet de « yellow teapot » (motoristes anglais, rien que des conservateurs jaloux)
Burevestnik a déjà son surnom: »Tchernobyl volant ». D’ailleurs,lors d’essais il y eut une explosion qui tua quelques opérateurs et provoqua une petite pointe de radioactivité en mer de Barentz (détectée par les Américains,qui surveillent tout ça de près)
A savoir:dans les années 50 les Américains eurent le projet de missiles propulsés par énergie nucléaire.Projet qu’ils abandonnèrent.
Vestiges;si vous visitez la Pennsylvanie…
https://uncoveringpa.com/jet-bunkers-quehanna-wild-area
Mendax 27 octobre 2025 à 9h33
le furoncle orange
===========================================================
Furoncle orange à la Maison Blanche, rat au Kremlin…On pourrait en faire une bande dessinée.
Dugong 27 octobre 2025 à 8h07
« Vite, vite, renforcement de l’enseignement des sciences… »
Ah les éditions MIR !
Mais je parlais du renforcement de l’enseignement des sciences aux Etats Unis!
L’enseignement des sciences en URSS était excellent (pour ceux qui y avaient accès)
Il est vrai qu’après Spoutnik un gros effort a été fait pour que les lycéens américains soient un peu moins ignares…
Et comme il fallait former des professeurs de sciences, les Américains se sont tournés vers la France,invitant, par exemple, des bourbakistes à venir enseigner un certain temps dans des facs américaines.
Puis les meilleurs étudiants, assez intelligents pour comprendre les cours imbittables des bourbakistes français ont traduit ça en langage bittable.
C’est ce qui a donné,par exemple, le merveilleux manuel de Marsden et Weinstein.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-5024-1
(Je ne sais plus lequel des deux a été l’étudiant de Choquet)
IAL va nous pondre un opuscule sur l’addition des entiers qui fera date de Moscou à Vladivostok
Et mon khul, c’est du poulet ?
Peut-être serait-il utile de préciser ce qui serait loisible d’enseigner en sciences à une classe de terminale scientifique de très bon niveau
Dugong 27 octobre 2025 à 8h04
« Burevestnik » ou la bouilloire nucléaire.
NB bouilloire:kettle
théière:teapot
Une théière peut être perçue comme un engin polyvalent.
Après spoutnik, les amers locos ont mis plein de brouzouf dans l’enseignement des sciences. C’est ainsi qu’un type comme Feynman a pu enseigner la physique en première année à Caltech.
L’accident qui a provoqué la mort de 6 experts du nucléaire. Etait-ce Burevestnik ?
https://www.bbc.com/news/world-europe-49319160
Et mon khul, c’est du poulet ?
Mendax 27 octobre 2025 à 9h33
Pour une fois, le furoncle orange a une réplique sensée :
https://mstdn.social/@noelreports/115445035810610140
Oui, mais il n’a sans doute pas tout compris. D’ailleurs, le Burevestnik ne laisse pas de marbre les spécialistes américains;il y a bien « rupture » de l’équilibre de la terreur.
Il ne comprend pas grand-chose de manière générale et son « raisonnement » va très vite se heurter à ses contradictions internes : Faire du business avec la russie tout en la contraignant par l’OTAN qui reste une formidable machine de cash et un moyen de contrôler l’Europe, ça ne marche pas trop avec le plan de la russie de dominer l’Europe, sans même parler de ses petites excursions en Arctique.
Cela étant, à supposer que le machin de l’autre tache fonctionne vraiment, il n’y a strictement aucune raison de croire que le Burevestnik marque une rupture dans l’équilibre de la terreur : Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni conservent des forces nucléaires de seconde frappe et les systèmes de dissuasion (missiles balistiques sous-marins, silos) restent intacts.
C’est juste un pauvre type qui crie très fort qu’il a la plus grosse.
On peut penser que les Russes sont des cons…et que par conséquent leur Bourevestnik est une connerie.
C’est peut-être une façon de voir un peu imprudente.
A quoi ce truc pourrait servir ?
https://en.topwar.ru/211046-sudba-burevestnika.html
Dugong 27 octobre 2025 à 10h21
Une théière peut être perçue comme un engin polyvalent.
Une bite aussi.
https://share.google/OUl1qJVlGVFcKj3Nh
La Chine et la Russie se sont rapprochées.
(La Russie s’étant fait grandement moquer et cracher dessus – l’Europe de « l’Atlantique à l’Oural » que nenni –
inévitable que la Russie ait alors choisi de s’orienter de l’autre côté : Chine, Inde… : vastes territoires…
tout en veillant à conserver ce qui fait partie de la sphère slave.)
Hahaha ! Comme s’ils avaient « choisi » ! Et pour l’instant, ils ne conservent pas grand-chose ! Quand vous vous faites lourder, vous dites aussi que c’est par consentement mutuel ?
Ils ont « choisi », que vous l’acceptiez ou pas !
Et… tant pis pour l’Europe qui s’est privée de bien des matières premières !
L’Ukr, bof ! 75 % du territoire russe est du côté asiatique (Est) – Sibérie…
(Le « choix » c’est faire du business avec un certain nombre de pays, dont l’Inde…)
https://share.google/ppzi9oaf9rbnASgNR
Taïwan fait partie de la sphère asiatique,
tout comme l’Ukr de la sphère slave.
Que « l’on » s’occupe plutôt de ce qui nous concerne !
https://share.google/WOvuFxs0xr2Pm8PwA
(que les Canadiens s’occupent plutôt de leurs fesses – ils sont pour, qui s’est baladé dans le pays, on ne peut plus ricains…)
(pour qui)
https://share.google/8ndrhODooI1sygT8d
(les Occidentaux, n’avaient qu’à se remuer les fesses plus tôt !
« L’histoire de l’industrie des semi-conducteurs à Taiwan remonte aux années 1970. À l’époque, le gouvernement taïwanais a lancé une série de mesures visant à promouvoir l’industrialisation du pays. L’industrie des semi-conducteurs a été identifiée comme un secteur stratégique et d’avenir. » – google évidemment, mais ça semble plausible !)
https://share.google/5pfm5NKwiGCrjUQdD
« 3ème mandat » –
Il en est des qui s’accrochent bien au-delà.
Ainsi Lui, sans sa célèbre écharpe – donc vue sur un cou passablement décharné –
La vieille gorgone de l’Ima depuis 12 ans vous salue bien !
https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/10/IL20251026075546-jack-lang-scaled-929×522.jpg
Jack s’est toujours accroché . Exclu (pour insuffisance de résultats)du lycée Henri Poincaré (Nancy) après y avoir redoublé sa 6ème, il poursuit sa scolarité au collège de Lunéville(ville où je suis né ) avant de revenir à Poinca en classe de 4ème.
Le monde est petit . Je connais bien J.L
Il a créé le festival mondial du théâtre à Nancy, je crois que c’est ce qu’il a le plus réussi dans sa vie .
Avoir été ministre de l’éducation nationale l’a beaucoup perturbé quand bien même il aurait déclaré : « Je ne vise jamais les professeurs. »
Oui…
(pas facile pour Lormier car le texte est long)
(question : oseriez-vous la teinture très réussie de JL ? 😁)
Désolé, je n’ai pas de cheveux blancs.
Il fait partie des meubles mais c’est en pouf qu’il préfère cirer les dard
dards…
« gorgone de l’Ima », c’est une créature péruvienne ?
https://share.google/0Jp2opphXDBcX0E6a
https://youtube.com/shorts/8AVTxwwnh7c?si=L0shpT4E4DAuBWcF
(un peu comme le Cramon qui s’offrirait bien un 3ème mandat ?!…)
Mendax 22 octobre 2025 à 17h49
J’ai très longtemps travaillé avec des russes. Plus maintenant.
Cela ne vous a-t-il pas rendu suspect aux yeux des Ukrainiens ?
(😁)
Mendax 27 octobre 2025 à 11h44
Faire du business avec la russie tout en la contraignant par l’OTAN qui reste une formidable machine de cash … ça ne marche pas trop …
L’OTAN, une formidable machine de cash? Pour qui ? Comment ça marche ?
Pour les Américains. Mais c’est un raccourci, la réalité est plus complexe. Le cadre OTAN pousse beaucoup d’États à acheter américain (avions, missiles, systèmes de communication) ce qui profite à l’industrie d’armement et renforce l’influence technologique et financière des États-Unis. Le vrai gain est donc politico-stratégique : l’OTAN maintient Washington au centre du dispositif de sécurité occidental, garantit la suprématie du dollar et des technologies US, et assure aux Américains un rôle de puissance incontournable, plus qu’une source de profit direct parce qu’il faut bien dire que ça leur coûte cher également : déploiements, bases, entretien de la dissuasion nucléaire partagée… Économiquement, c’est rentable, mais ce n’est pas sur ce plan que se situe le gain essentiel. Et personne n’est obligé d’acheter américain.
La France, par exemple, n’achète quasiment rien aux USA pour son armée.
Mendax 27 octobre 2025 à 9h33
Pour une fois, le furoncle orange a une réplique sensée :
Il dit, entre autres choses qu’au lieu de fabrquer des missiles Poutine ferait bien de terminer cette guerre qui n’aurait dû durer qu’une semaine.
Que veut-il dire par là ?
Que Poutine n’avait qu’à vitrifier Kiev (méthode Dugong) et que la paix aurait été obtenue dans la semaine ?
vitrifier Kiev, quel poncif !
Ce n’est pas facile à interpréter vu le langage tordu du furoncle mais je pense que ça veut dire un truc comme : « t’as bien eu raison d’envahir l’Ukraine sauf que tu t’y es pris comme un manche, moi j’aurais fait mieux » – voilà pour la première partie. La seconde est volontairement ambiguë, comme toujours : On ne sait pas si la perspective est juste la fin de la guerre ou la fin de l’Ukraine. Le furoncle orange s’en tape tant qu’il peut en retirer de quoi se pavaner devant les media une fois la question réglée.
Les pédérastes du monde entier en deuil de Tadzio
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2025/10/27/l-acteur-suedois-bjorn-andresen-connu-pour-son-role-dans-mort-a-venise-est-mort-a-l-age-de-70-ans_6649824_3382.html
(photo récente : cheveux longs et sans teinture – 😁)
https://media.themoviedb.org/t/p/w600_and_h900_bestv2/x3uO4FVbpLLjyyEf7xErhYo5FU.jpg
(Cheveux longs et sans teinture – suite –
Après l’emballage de quelques dattes pour le ramadan, le pitoyable King s’est cette fois illustré, « soutien inattendu de la communauté LGBTQIA+ »,
en « rendant hommage aux vétérans discriminés au sein de l’armée ».)
https://www.parismatch.com/lmnr/f/webp/r/1045,696,000000,forcex,center-middle/img/var/pm/public/media/image/2025/10/27/15/2025-10-27t125429z_1385480512_rc2ckhas1934_rtrmadp_3_britain-royals-king.jpg?VersionId=ji5jD79KntaK922rHSOtDFvTKUFtxybZ
WTH 27 octobre 2025 à 14h06
Ils ont « choisi », que vous l’acceptiez ou pas !
Et… tant pis pour l’Europe qui s’est privée de bien des matières premières !
L’Ukr, bof ! 75 % du territoire russe est du côté asiatique (Est) – Sibérie…
——————————————————
Tout ça n’a rien à voir avec ce que je “veux” ou “accepte”, ce sont simplement les faits.
La Russie n’a pas “choisi” de se tourner vers l’Inde et la Chine, elle y a été contrainte par la fermeture de tous ses circuits commerciaux, financiers et technologiques occidentaux.
Avant 2022, l’Union européenne représentait près de 40 % du commerce extérieur russe. Ce n’était pas une simple “clientèle”, mais une dépendance structurelle : hydrocarbures, métaux, engrais contre technologies, machines-outils, logiciels, pièces d’avion, tout le cœur de l’économie moderne. Après l’invasion de l’Ukraine, tout cela a disparu en quelques semaines : exclusion de SWIFT, gel des avoirs, départ de plus de 1 000 entreprises étrangères, effondrement des investissements directs.
La Russie n’a donc pas pivoté, elle a glissé par défaut dans les bras de Pékin et de New Delhi, faute d’alternative. Et encore, à des conditions humiliantes :
– son pétrole “Urals” est désormais vendu 30 à 40 % moins cher que le Brent mondial ;
– les Chinois et les Indiens paient souvent en yuans ou en roupies, monnaies difficilement convertibles, que Moscou peine à utiliser ailleurs ;
– la Russie s’est fait enfermer dans des accords bilatéraux déséquilibrés où elle n’a plus aucun levier.
Sur le plan industriel, elle a perdu l’accès à la quasi-totalité des technologies occidentales : 90 % des importations de composants électroniques, aéronautiques ou mécaniques ont disparu, et la Chine ne les remplace qu’à la marge, et à prix fort. La “réorientation” asiatique ressemble donc davantage à une économie de troc sous perfusion, qu’à une stratégie souveraine.
Quant à cette “sphère slave” que Moscou prétend conserver, c’est une fiction commode. L’Ukraine lui résiste, la Biélorussie est un protectorat exsangue, et les Balkans regardent de plus en plus vers Bruxelles ou Pékin. Bref : le “monde slave” se rétrécit à la mesure du territoire contrôlé par les chars russes.
Alors non, WTH, la Russie n’a pas “choisi” : elle a été poussée dans un coin et tente d’y sauver la face en expliquant que le mur lui plaisait justement beaucoup. VOUS, vous pouvez bien « CHOISIR » de croire à ces bêtises, mais ça ne change rien à la réalité des faits.
https://share.google/4etI2rLd2mOu90TFT
https://share.google/QotS3kVZ3yxGfyvtw
https://share.google/H9qkDpzQS2PPadUdU
La pensée de Mendax,mise en images (avec une adorable petite fille):
https://x.com/i/status/1982561979215860215
Le W rejoint « l’heureux comme un simple d’esprit 🤪 »,
croyant mordicus à ce que peut imprimer (!) des torchons
en mode le Monde, Courrier Int’l et… Géo – tiens, Géo, ça me rappelle quelqu’un (😁).
Je ne connais qu’une minuscule partie de la Russie.
Et la capitale – ben oui… 😁 –
donne une impression autrement plus positive que celle que peut donner…
la capitale… de la France,
sale,
pourrave,
en chantiers…
« Swift » a été très bien remplacé ; quant au départ des étrangers – ex Renault pour un rouble -…
En vérité, peut me chaut, et aucune envie d’en dire plus.
Et, au passage, le choix (!) qu’a fait lfdh de s’expatrier me paraît une bonne idée : le « suicide de l’Europe » fait qu’il faudra malheureusement compter sur plus d’une génération pour relever la tête.
Les FAITS sont là, et ils sont têtus !
Ski est marrant c’est que je ne vois personne se précipiter pour aller vivre dans ce havre de paix, de sécurité et de prospérité.
Mais bon, les gens sont cons …
Les miches à -20°C, ça va un moment…
(Un peu pareil… En Scandinavie…
sauf que électricité et gaz : moins cher chez les Popovs)
Comme je l’ai précisé : « En vérité, peut me chaut »… !!
(sans compter que je ne parlais que… de la capitale.)
Ici, les « gens sont cons »… sans aucun doute !
Et la plupart se contenteront de survivre avec une forme « d’allocation universelle » ; on y viendra… (avec 13% de « neets », on y court !)
Seuls les meilleurs (!) qui auront pu faire des études, se seront évidemment expatriés, là où ils pourront vendre leur force de travail à un meilleur coût qu’ici !
Les « faits »… Vous voulez dire les façades ? 😄
Moscou est propre, oui, c’est l’un des régimes les plus centralisés d’Europe, qui concentre tout sur sa capitale pendant que les régions crèvent. Le PIB par habitant de Moscou est trois fois supérieur à la moyenne russe, et plus de 40 % des routes rurales ne sont toujours pas asphaltées.
Quant à Swift, le “remplacement” se fait par un système national fermé, limité à une trentaine de pays, dont la Chine qui n’envoie pas un centime sans contrepartie. Les transferts sont lents, surveillés, et non convertibles en devises fortes : ça, c’est un « succès » à la nord-coréenne.
Renault a été « vendu pour un rouble », certes — mais avec obligation de rachat à prix fort si la Russie veut récupérer la technologie et relancer la production. En attendant, la production automobile a chuté de plus de 60 % depuis 2021, les avions civils sont cannibalisés pour les pièces, et les exportations hors énergie ont plongé.
Donc oui, Moscou brille, mais le pays s’enfonce. Et quant au “suicide de l’Europe”, il faut oser : l’économie russe est désormais plus dépendante de la Chine qu’elle ne l’a jamais été de l’Ouest. On appelle ça un vasselage, pas un choix souverain.
Je le répète : « En vérité, peut me chaut ! »
je ne vis pas mes dernières années là-bas…
Mais ici le spectacle de la dégradation généralisée est quand même difficile à encaisser !
(au passage que dire de notre « vasselage » à Bruxelles et à Washington…)
(déplacez-vous un peu dans les « territoires »… vous pourrez constater que la misère a tendance à s’installer !…)
C’est probablement vrai mais ça ne change rien à la situation de la russie, bien moins enviable que celle de la France.
La Russie est aujourd’hui vassalisée à la Chine dans le sens où elle dépend presque exclusivement de Pékin pour ses revenus et son approvisionnement industriel, et doit accepter des conditions très strictes pour maintenir ces relations, conditions dont j’ai déjà parlé plus haut : les échanges économiques sont strictement bilatéraux, en monnaies limitées, à des prix souvent inférieurs au marché, et la Chine ne fournit que certaines technologies, forçant Moscou à dépendre entièrement de Pékin pour ses revenus et son approvisionnement industriel.
L’Europe, elle, reste un partenaire libre : Washington ou Bruxelles ne peuvent forcer un État souverain à vendre son territoire ou ses ressources. D’ailleurs on peut quitter l’Europe si on veut : La Grande Bretagne l’a fait. La “dépendance” occidentale est donc bien moindre et surtout réversible.
Les Brits ont eu droit à certains passes droits, au sein de l’UE.
Renseignez-vous.
De plus ils ont conservé leur… monnaie, ce qui me semble important.
« Quitter » l’UE, facile à dire, très difficile à réaliser, surtout avec l’euro et par un pays… quasi ruiné.
Washington, avec son « extraterritorialité a réalisé quelques bons coups,
et a « forcé » un « Etat souverain » – qui ne l’est plus depuis un bon moment – a « vendre », par ex, Alstom.
Je ne vais pas revenir dix fois là-dessus… (ras le bol !…)
En effet, c’est inutile de revenir là-dessus, parce que ce sera toujours aussi faux.
L’histoire d’Alstom vendue sous la contrainte américaine est un mythe : c’était un rachat commercial approuvé par tous les actionnaires et encadré par les autorités, pas une confiscation. Washington a examiné la transaction, et a imposé certaines conditions (ex. maintien de l’emploi et des sites stratégiques), ça se fait tout le temps.
Ce n’est pas exactement ce qu’a raconté Pierucci,
mais peu importe… Je m’arrête là.
Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Le monde russe (je ne sais plus comment m’exprimer) revient lui de… très très loin ;
et le chemin sera long à « asphalter » !
Qu’il se fasse avaler par l’ogre chinois, très possible en effet.
Possible aussi que nos pays, après l’ogre ricain, se fassent lentement (mais sûrement ?) eux aussi grignoter par l’ogre chinois, si tant qu’il reste des choses, par-ci par-là, à grappiller.
Et peut-être même qu’ils se montreraient un peu plus fermes vis-à-vis de la lèpre islamisée qui nous grignote aussi…
Mais ne rêvons pas !
2030:fin de l’Empire Russe:
https://cdn.prod.website-files.com/643133d0a50b9cfafe462cbb/671ada24ba17e2457aec53d2_Map_EN_hdx.jpg
(« En vérité, peut me chaut ! »)…
https://blog.causeur.fr/bonnetdane/sado-masochisme-quils-disent-5527#comment-580011
Lormier donne sa langue au chat. Il s’en trouvera bien un pour pallier so insuffisance.
Décevant.
Je ne fesse jamais les proviseurs…
Bravo !
(oui, joli !)
Bon à savoir:une réserve de 400 000 jeunes Ukrainiens en Républque tchèque. Si jamais y avait besoin de remplacer des pertes…
https://unn.ua/en/news/almost-400000-czech-republic-sets-eu-record-for-ukrainian-refugees-per-capita
Finalement quel était le but de Poutine quand il a envahi l’Ukraine ? L’a-t-il envahie parce qu’étant en difficulté en Russie,iet qu’il a cru pouvoir ainsi échapper à cette difficulté ?
Et ce serait un très mauvais calcul car il serait encore plus en difficulté maintenant ?
Mais sans possibilité de retour en arrière ? Ne pouvant que continuer dans la même voie, jusqu’à sa perte et la perte de la Russie ?
Ou alors,il était pépère et par orgueil et bêtise,il s’est mis lui-même dans le pétrin ?
J’ai relu les commentaires de Mendax et j’essaie de concilier tout ça.
Quoi qu’il en soit, de toute façon, la Russie va perdre; rien ne va,l’armée est esangue, les Chinois ont vassalisé la Russie, le pays est au bord de la ruine et d’ici peu on pourra le ramasser par terre comme un fruit bien mûr tombé de l’arbre .
Il n’est pas du tout certain que la Russie (j’aimerais rayer ce mot et le remplacer par Poutine) perde.
Mais il est certain que sa situation après guerre sera moins bonne qu’elle fut avant, et ce quel que soit le résultat.
En tout état de cause :
– Une génération sacrifiée avec la chute démographique associée
– la construction d’une économie fondée sur la production d’armes, ce qui est d’une productivité en terme de confort pour le peuple toute relative
– la fin d’une presse et d’une fabrique de pensée libres
– le rejet par tous les pays développés
– une grande dépendance vis à vis de la Chine qui, dans le fond, est un ennemi commun à tous
– l’émigration d’une partie des élites
– la fin de la plupart des partenariats de recherche internationaux
– l’élargissement de l’OTAN
– le renforcement de la puissance militaire de l’Europe et la volonté affirmée de celle-ci d’une forte coopération dans le domaine (… même si dans les faits !)
– complétez la liste il est tard.
Bénéfices éventuels en cas de victoire :
– avoir vaincu les nazis.
– avoir mis à bas le wokisme et le lobby LGBT qui menacent l’occident chrétien
– avoir résisté à l’agression de l’OTAN qui se préparait, certains disent qu’elle avait commencée : j’ai eu accès à des documents secrets prouvant que la Lituanie aurait pu être proche d’atteindre Moscou et qu’en tout cas c’était son obsession.
Bénéfice certain :
– Poutine s’est maintenu au pouvoir et, sauf chute malencontreuse d’une fenêtre en étage, pour longtemps.
– heu … ?
Vous aussi vous êtes insomniaque, Zorglub ? Ou vous vous levez tôt ?
En fait, il faut définir ce que signifie « gagner » et « perdre ».
Si « gagner », ça veut dire prendre toute l’Ukraine : Non, il ne peut très probablement pas. Si ça veut dire prendre le Donbass : possible mais long et difficile. Et le ratio gains/coût est nettement en sa défaveur.
Si « perdre » signifie perdre la Crimée et les territoires occupés : Non, à moyen terme, cela semble très improbable que la russie perde ces gains. Perdre le pouvoir ? Non plus. Perdre sa souveraineté ? Personne ne songe à attaquer la russie, en dépit de la paranoïa du crétin en chef.
Mais comme l’a montré Zorglub dans son message plus haut, son opération spéciale a déjà entraîné de très grandes pertes pour d’hypothétiques petits gains. Objectivement, il est déjà perdant, même s’il n’a pas encore perdu.
Une fenêtre à guillotine au Kremlin ?
C’est beaucoup plus nuancé que ça.
Le postulat de départ est juste : Oui, le rat du Kremlin a pris une très mauvaise décision en envahissant l’Ukraine. La Russie a engagé environ 180 000 à 200 000 soldats pour attaquer un pays de plus de 40 millions d’habitants, sur un front de plus de 2 000 km. Stratégiquement, c’était stupide. (Et ne venez pas me sortir la justification idiote des prorusses qui prétendent que l’objectif n’a jamais été de prendre toute l’Ukraine : Si la Russie n’avait jamais voulu prendre Kyiv, elle n’aurait pas envoyé ses parachutistes à Hostomel, ni aligné 60 km de blindés vers la capitale. Le « plan Donbass » est une invention a posteriori de mars 2022 pour sauver la face après une Blitzkrieg ratée.)
Il a a été encore plus inconséquent lorsqu’il a décidé de s’entêter en espérant grappiller malgré tout quelques gains dans le Donbass. Il a transformé une défaite tactique en guerre d’usure suicidaire, déclenché la remilitarisation complète de l’Occident et perdu son levier et perdu son “levier énergétique” sur l’Europe. Ça aussi, c’est objectivement très con.
Quant à ses motivations, c’est là que c’est beaucoup plus complexe. C’est une combinaison d’objectifs : empêcher l’alignement UE/OTAN de l’Ukraine, restaurer l’influence impériale russe, solder des problèmes de légitimité interne et sécuriser des zones tampon. Oui, à l’intérieur de son propre pays, il était en difficulté depuis 2014 : l’économie stagnait et il avait dû bidouiller la constitution pour rester au pouvoir. Il a donc voulu rallumer le mythe impérial pour masquer tout ça. C’est ce qu’il a fait régulièrement en menant des guerres (conventionnelles ou « hybrides ») et d’habitude, ça marchait. Comme tous les autocrates fatigués, il a pris une fuite en avant militaire pour sauver un régime à bout de souffle.
Quant aux perspectives futures… Ce qui est quasi certain, c’est qu’il ne peut pas prendre l’Ukraine dans les conditions actuelles, et même pour le Donbass, ça semble difficile. On peut dire aussi tout à fait objectivement que la russie a perdu bien plus qu’elle peut espérer gagner. Mais on ne peut pas forcément en dire autant pour poutine : lui, il a « verticalisé » son pouvoir à l’intérieur du pays et son pote le furoncle orange lui déroule le tapis rouge… Pour un autocrate compensatoire tel que lui qui combine le narcissisme blessé, la paranoïa du pouvoir et le complexe de virilité frustrée, c’est du petit lait…
Mais à plus long terme, allez savoir ce qui se passera : Une russie défaite n’est dans l’intérêt de personne, même pas de la Chine ; une russie affaiblie conviendrait à la plupart des acteurs, sauf de l’Inde, qui serait alors en déséquilibre face à la Chine ; une russie victorieuse ferait surtout plaisir à l’Iran et à la Corée du Nord et j’ose espérer que personne ne serait assez fou pour privilégier ce scénario. Alors vous voyez, il n’est absolument pas question de « ramasser la russie comme un fruit mûr tombé de l’arbre » – le délire obsidional de poutine est sans objet : S’il veut trouver le véritable ennemi de la russie, il n’a qu’à se regarder dans le miroir. Il voulait restaurer la grandeur de l’Empire ; il n’en aura été que le fossoyeur.
You have made some good points there. I looked
on the net for more info about the issue and found most
people will go along with your views on this website.
My website – useful link
Mendax a mis un peu d’eau dans son vin.
La Russie, à la fin, pourrait garder le Donbass.
Vous êtes fatigant. Je n’ai jamais dit que la russie ne pourrait pas garder certains territoires. L’Ukraine est pour l’instant en position défensive et n’a pas la possibilité militaire de les reconquérir. Elle aurait pu si on la lui avait donnée à temps.
Mais je maintiens ce que j’ai dit plus haut : poutine est déjà perdant, même s’il n’a pas déjà perdu.
Il a … déclenché la remilitarisation complète de l’Occident
=========================================================
ainsi que le basculement de l’économie européenne vers l’économie de guerre,laquelle (comme l’a finalement reconnu Mendax) n’est pas une économie de paix.
Quel est le plan de l’Union européenne ? Comment entend-elle riposter à la Russie qui la menace.? Quand on passe en économie de guerre,c’est sans doute qu’on ne croit pas que la paix (relative) est durable. (Sinon, on resterait en économie de paix.)
Y a-t-il d’autres stratèges que les généraux d’opérette qu’on nous montre ?
Y a-t-il des plans stratégiques ? Macron, chef des Armées,a-t-il réuni son état-major dans la salle des cartes ? On commence par où ? Kaliningrad ?
Ce passage en « économie de guerre » entraîne le sabordage de tout ce qui en temps de paix peut permettre aux citoyens,sinon de s’épanouir, du moins d’avoir une vie normale: services publics, santé, enseignement…
Curieusement, en France dans les âpres débats sur le budget,n’est pas évoqué le fait que nous sommes maintenant en économie de guerre.
Macron, en huit ans, a passablement appauvri les Français;mais ce n’est rien en comparaison de ce qui vient.
Nous ne basculons pas vers une économie de guerre, arrêtez de raconter n’importe quoi.
Techniquement, une économie de guerre désigne une organisation dans laquelle l’État oriente toute la production, la main-d’œuvre et les finances vers l’effort militaire, avec contrôle des prix, rationnement et planification centralisée, ce qui n’est absolument pas le cas en Europe aujourd’hui. L’Europe augmente ses dépenses militaires et cherche à accélérer sa production d’armes, mais elle reste une économie de marché, sans mobilisation totale ni restriction civile.
L’offre spoliatique en France est telle que le désastre peut advenir rapidement avec la caissière ou l’autre moule marinière des écolos. Les deux ont des clientèles apeurées et crétinisées à satisfaire.
Dans un récent entretien, Angela Merkel (qui n’est pas morte) reprend la thèse des « pro-russes »: Poutine ,quand on le connaît comme moi, on sait qu’il faut pas le pousser à bout.
Si on n’était pas venu le faire chier en Ukraine avec les manoeuvres de l’OTAN, il n’aurait pas envahi…
Merkel, Merkel n’est qu’une retraitée et personne ne l’écoute,je sais bien…
Et rien qe pour rigoler, j’avance une hypothèse scandaleuse,à faire frémir:et si Poutine,en envahissant, avait donné un coup de frein à l’hégémonisme américain ? Et si l’Iran, la Chine, l’Inde ,la Corée du Nord, tous les pays qui livrent des armes à Poutine n’étaient pas en train de se frotter les mains ?
Parce que l’Oncle Sam est défié.
Vous avez raison, c’est rigolo.
« Merkel, Merkel n’est qu’une retraitée et personne ne l’écoute »
Surtout quand elle cause en russe…
Mendax 28 octobre 2025 à 4h50
Il voulait restaurer la grandeur de l’Empire ; il n’en aura été que le fossoyeur.
Quel « Empire » ?
La Moscovie ou je ne sais quoi dont parlent les gens du Форум свободных народов пост-России (Forum des Nations Libres de la post-Russie) organisation fondée par un restaurateur ukrainien ,Oleg Magaletsky,et dont le quartier général est à Varsovie ?
Ce groupe folklorique veut voir l' » Empire remplacé par » l’Eurasie du Nord », un conglomérat de pays indépendants.
https://www.freenationsrf.org/en
Hégémoisme américain et destruction des nations.
Y a des fait historiques. C’est bien les Américains qui ont fait éclater la Yougoslavie ,n’est-ce pas ?
Donc il n’est pas totalement absurde d’envisager l’hypothèse qu’ils aient voulu faire la même chose avec la Fédération de Russie.
« Y a des fait historiques. C’est bien les Américains qui ont fait éclater la Yougoslavie ,n’est-ce pas ? »
Ben non.
Comme votre postulat est faux, l’hypothèse qui en découle l’est aussi aussi.
La Yougoslavie a commencé à se désintégrer au début des années 1990 à cause de tensions ethniques, nationalistes et économiques internes, exacerbées par la mort de Tito et la faiblesse des institutions fédérales. L’Occident, y compris les États-Unis et l’UE, est intervenu principalement après le début des conflits, par des sanctions, des négociations diplomatiques et enfin des frappes aériennes (comme contre la Serbie en 1999), mais il n’a pas « provoqué” l’éclatement.
Mendax 28 octobre 2025 à 5h01
Personne ne songe à attaquer la russie
Il me semble que c’est déjà fait.
Incursion dans la région de Koursk,occupée plusieurs mois. Bombardements en territoire russe ,drones sur Moscou.
On peut toujours dire que ce ne sont pas des attaques mais des contre-attaques…
En effet l’armée atlntico-ukrainienne n’a aucune chance de gagner si elle se cantnne dans le territoire de l’Ukraine;
Mais une contre-attaque, c’est une attaque.
Le furoncle orange tient des propos incohérents qui peuvent se résumer à:c’est moi qui ai la plus grosse…mais avec son équipe, il fait des choses.
Rappel essentiel:il a nommé Kennedy ministre de la santé et là on assiste à un changement radical qui pourrait bien faire capoter la tentative de transformer l’Union européenne en état totalitaire néo-mengeléien.
Macron fait comme si il ne se passait rien.
Qui vivra verra.
Je ne parlais pas du furoncle orange mais du rat du Kremlin.
Cela étant, c’est vrai que leurs éructations se ressemblent.
Mendax 28 octobre 2025 à 8h10
Techniquement, une économie de guerre désigne une organisation dans laquelle l’État oriente toute la production, la main-d’œuvre et les finances vers l’effort militaire, avec contrôle des prix, rationnement et planification…
Quand un train roule VERS Paris,il n’est pas à Paris .
Quand une économie bascule VERS une économie de guerre, ce n’est pas une économie de guerre.
Rappel:c’est Thierry Breton qui,dans les premiers a dit:il faut passer à une économie de guerre.
Combien de milliards sont consacrés par la France au « réarmement » ? Un certain nombre, n’est-ce pas ?
Et au niveau européen ?
Ces milliards sont pris sur les budgets conascrés aux activités de paix.
La réforme des retraites, la réduction de la prise en charge des soins, la fermeture d’hôpitaux,la réduction du nombre de fonctionnaires, tout cela a pour but de dégager des crédits pour l’effort de guerre.
Au Canada où l’aide à mourir est applicable à un très grand nombre de cas (déprimés,diabétiques, SDF…), le gouvernement a déjà fait des calculs sur le nombre de citoyens qui devront être euthanasiés année après année.
En France, on commence à réfléchir au remplacement de soins aux malades chroniques par des soins palliatifs (Rappel:le décret Rivotril a été un galop d’essai.)
Avec un G9 bien conduit, on peut creuser une fosse commune de 100 m de long, 25 m de large et 8m de profondeur en moins de temps que pour zigouiller ses futurs occupants
https://www.youtube.com/watch?v=nJIhu7tONFA
Et par-dessus,on met du béton, on asphalte et on fait un parking ?
Ce sont des options pratiquement libres…
A mettre dans le devis.
Mendax 28 octobre 2025 à 8h21
La Yougoslavie a commencé à se désintégrer au début des années 1990 à cause de tensions ethniques, nationalistes et économiques internes, exacerbées par la mort de Tito et la faiblesse des institutions fédérales.
=========================================================
C’est vous qui le dites…ou plutôt vous reprenez la doxa otanienne.
(Soit dit en passant,si la Yougoslavie était en train de se désintégrer, quel était le but de l’opération militaire? des bombardements? L’empêcher de se désintégrer ? la secourir ?)
Vous confondez cause du conflit et motif de l’intervention.
Non, ce n’est pas une « doxa otanienne », c’est un constat historique largement documenté : les guerres en Yougoslavie ont commencé AVANT toute intervention occidentale, avec des affrontements internes entre républiques, notamment en Croatie et en Bosnie dès 1991-1992. L’intervention militaire de l’OTAN, elle, est venue bien plus tard, en 1999, pour faire cesser les violences au Kosovo, pas pour « empêcher la désintégration », celle-ci était déjà accomplie.
Le bombardement a cessé la répression massive contre les civils albanais. Il a malheureusement tué des civils serbes et kosovars, et détruit des infrastructures civiles, ce qui a créé une hostilité durable envers l’Occident. Certains disent qu’une pression diplomatique plus longue aurait pu suffire, mais les massacres continuaient.
Vous maîtrisez à fond votre catéchisme.
(Dans la nouvelle verson qui semble être la vôtre les « frappes chirurgicales n’affectant que le matériel militaire » ont été gommées.)
Hein ?
Aaaaaah, compris.
Je crois.
C’est l’effet Mandela.
Mendax 28 octobre 2025 à 4h50
Il voulait restaurer la grandeur de l’Empire ; il n’en aura été que le fossoyeur.
Il a donc voulu rallumer le mythe impérial..
Il est vachement rusé ce Mendax; il vous balance en douce le mot » Empire », comme s’il y avait un Empire et vous faites pas gaffe.
J’ai mis un certain temps à repérer la faille.
Soit,il y a un Empire russe, soit il y a un mythe de l’Empire russe.
Et qui a inventé ce mythe ? Les Atlantistes . Parfois ils nous disent:Poutine veut reconstruire l’URSS. Comme c’est complètement idiot puisque la Russie d’aujourd’hui n’a rien de communiste et qu’on le leur fait remarquer,ils changent leur fusil d’épaule et nous sortent l’Empire russe-ce qui est tout aussi stupide puisque la Russie d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celle des tsars.
Ce n’est pas “les Atlantistes” qui parlent d’Empire russe : Ce sont les russes eux-mêmes.
Poutine et son entourage utilisent constamment la rhétorique impériale : “russkiy mir” (le “monde russe”), “civilisation russe”, “terre historique russe”, “rassemblement des russes et des terres russes”…
En 2012 déjà, Poutine écrivait dans un article programmatique : “L’effondrement de l’Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle.” Et il ajoutait que la mission historique de la russie était de restaurer son unité historique et spirituelle. En 2021, il publie un texte entier “Sur l’unité historique des russes et des Ukrainiens” où il nie l’existence de la nation ukrainienne.
Ce n’est pas un “mythe inventé par l’OTAN” : c’est la doctrine officielle de Moscou.
Quand on parle d’Empire russe aujourd’hui, on ne parle pas du communisme ni du marxisme-léninisme, mais d’un impérialisme ethno-nationaliste, hérité des tsars.
Poutine n’est pas nostalgique de l’idéologie soviétique : il est nostalgique du territoire soviétique, de la puissance, de la crainte qu’inspirait Moscou.
C’est exactement ce qu’on appelle un projet impérial : récupérer des terres, soumettre des peuples, imposer sa sphère d’influence.
Le rat exploite le mythe des deux empires, le soviétique et le tsariste. Il garde de l’URSS la puissance militaire et la nostalgie du prestige, et du tsarisme le culte du chef et la mission spirituelle. C’est un bricolage idéologique : ni rouge ni blanc, juste impérialiste.
Son “rêve russe”, c’est une fiction destinée à justifier la domination sur les voisins.
« J’ai mis un certain temps à repérer la faille. »
On sait bien que Lormier n’a pas l’habitude des failles infimes .
La nuit a ete chargée. Lormier est drogué ou endormi.
Il se laisse abuser par les mythes. La dope, ça empire chez lui !
Oui…
Trois.
Rassurez-vous, le Maestro pallie vos insuffisances.
https://blog.causeur.fr/bonnetdane/sado-masochisme-quils-disent-5527#comment-580122
Mais un autre empire est possible…
ce qui a créé une hostilité durable envers l’Occident.
Quelle ingratitude! On intervient pour arr^ter les massacres,on les bombarde pour restaurer la paix et voilà comment ils nous remercient !
Mendax 28 octobre 2025 à 8h25
Vous avez raison, c’est rigolo.
Poutine a fait un calcul qui s’est avéré juste.
Il a pris le risque d’envahir,estimant que les Américains n’interviendraient pas.
Toutes les manoeuvres militaires sur le sol ukrainien, opérationTrident etc. interopérabilité des armes et tout le tralala ,c’était du cinéma.
Et, en effet, Poutine a défié les EU et les EU l’ont laissé faire.
C’est cet acte de défi qui lui a valu le soutien de l’Inde, de la Chine, de l’Iran ,pays qui en ont plein le cul de l’hégémonisme américain.
Ces « alliances » sont le symétrique des alliances atlantistes.
Si le but était d’obtenir un soutien conditionnel de ces pays au point d’affaiblir considérablement la russie, il a gagné son pari haut la main. Mais on peut alors juger qu’il est quand même un peu con.
Ces alliances sont tellement le symétrique des alliances atlantistes qu’on a vu avec quel empressement la russie s’est mobilisée pour défendre l’Iran quand l’orange pourrie a décidé de le bombarder.
Oscours !
Reprise des causements et devinettes : de quel pays s’agit-il ?
(Z.) :
– « la fin d’une presse et d’une fabrique de pensée libres »
– « le rejet par tous les pays développés »
– … « s’est maintenu au pouvoir »
(M.):
« il n’en aura été que le fossoyeur. »
– « récupérer des terres, soumettre des peuples, imposer sa sphère d’influence »
– « bricolage idéologique »
(D.)
« le désastre peut advenir rapidement avec la caissière ou l’autre moule marinière des écolos. Les deux ont des clientèles apeurées et crétinisées à satisfaire »
(le « désastre » est bien installé… et ne fera que se poursuivre ; « on » pardonne à D. connaissant son obsession pour le matos, en général – mais hors Etat major – dernier en date « Carterpillar »)
(L.) – grand gagnant du con-cours
« Poutine a défié les EU et les EU l’ont laissé faire.
C’est cet acte de défi qui lui a valu le soutien de l’Inde, de la Chine, de l’Iran, pays qui en ont plein le cul de l’hégémonisme américain. »
« Ces « alliances » sont le symétrique des alliances atlantistes »
A noter que M. a reconnu que
« Ces alliances sont tellement le symétrique des alliances atlantistes qu’on a vu avec quel empressement la russie s’est mobilisée pour défendre l’Iran quand l’orange pourrie a décidé de le bombarder »
Sauf que la les bombardements ont vite pris fin…
Une vieille histoire que toussa ; c’est plus moi, c’est l’autre, ou les autres – et avec la course aux terres dites rares et autres « énergies », on n’a pas fini de rigoler ; ou pas.
Éclatement de la Yougoslavie.
C’est déjà loin et on oublie l’enchaînement des faits.
Par exemple l’indépendance de la Slovaquie proclamée en juin 1991
https://youtu.be/dLJPdh_q0g4?si=iGNr-ThafmvUNgCN
Erreur de ma part, impardonnable.
Je voulais écrire Slovénie.
Éclatement de la Yougoslavie suite..
Et la proclamation de l’indépendance de la Slovénie fut suivie d’une guerre de 10 jours.
» La guerre d’indépendance de la Slovénie (slovène: Slovenska osamosvojitvena vojna), aussi appelée guerre des Dix Jours (slovène: Desetdnevna vojna), est un conflit militaire qui opposa la république fédérative socialiste de Yougoslavie à la république de Slovénie en 1991 à la suite de la proclamation de l’indépendance de cette dernière[2]. »
(…)
De fait, sept mois avant le début du conflit, les Slovènes s’étaient préparés à l’affrontement et ils avaient établi des plans en vue d’une campagne militaire pour défendre leur territoire contre les attaques de la JNA[3]. Etc
Wikipedia
Ce pays a eu de la chance car apres 10 jours, ce qui subsistait de la Yougoslavie a accepté l’indépendance , ce qui n’a pas ete le cas en Croatie et Bosnie ( celle ci divisée entre plusieurs ethnies qui se combattirent).
A ce stade aucune intervention des Occidentaux sinon tentative pour organiser un cesser le feu.
abcmaths 28 octobre 2025 à 10h44
Rassurez-vous, le Maestro pallie vos insuffisances.
J’avais vu.Cela m’a d’ailleurs bouleversé,qu’il se donne la peine de le faire.(C’est,je crois ,la première fois. Généralement pour le palliationnement, un simple commentateur suffit.)
Si mes contrepets ne vous distraient plus, dites-le moi.
Pas du tout;j’ai conscience de mes insuffisances. Quand vous annoncez que c’est d’un niveau trop élevé pour moi,il arrive que je n’essaie pas.
Je vous sens démotivé, je vais donc probablement aller contrepéter ailleurs.
Je pourrais aussi parler de la guerre :
Le monde est très petit, il se trouve que je connais ( bien) trois personnes qui ont eu un rôle ( non négligeable ) à jouer dans cette guerre : Deux anciens élèves (rôle mineur) et surtout un de mes meilleurs copains lorsque j’étais étudiant devenu grand industriel de l’aéronautique puis de l’armement.
Mais je préfère contrepéter.
Mendax 28 octobre 2025 à 9h47
Ces alliances sont tellement le symétrique des alliances atlantistes qu’on a vu avec quel empressement la russie s’est mobilisée pour défendre l’Iran quand l’orange pourrie a décidé de le bombarder.
=========================================================
Oui, tout à fait symétrique.
Quant on est « allié » aux Etats Unis, on doit se plier à ses conditions:lui acheter son gaz à un prix exorbitant, payer des droits de douane élevés quand on exporte et aussi contribuer à l’OTAN à hauteur de 5% de son budget.
Quant au parapluie américain, comme dit Todd,il est illusoire de penser que les Américains le déploieraient pour l’Europe.
amuser par les bites (classique).
la pipe ça endort.
Et la 3ème ?
Mendax 21 octobre 2025 à 12h37
La Russie vit sur la dépense militaire, pas sur une économie saine.
L’Ukraine, malgré tout, a renforcé son armée, relancé son économie
La guerre,les dépenses militaires peuvent ,selon le sage Mendax avoir des effts fort différents selon les pays
La dépense militaire ruine l’économie russe et rend prospère l’économie ukrainienne.
Mendax 28 octobre 2025 à 9h39
Ce n’est pas “les Atlantistes” qui parlent d’Empire russe : Ce sont les russes eux-mêmes.
Poutine et son entourage utilisent constamment la rhétorique impériale : “russkiy mir” (le “monde russe”), “civilisation russe”, “terre historique russe”, “rassemblement des russes et des terres russes”…
Curieusement le mot « Empire » ne figure dans aucune de vos citations.
Je n’arrive pas à trouver de source directe relative à cette déclaration da Kallas ,en 2024
Footage from the 2024 Lennart Meri Conference held in May in Tallinn, Estonia seems to reveal a new goalpost for the E.U. in regards to the Ukraine-Russia conflict. The former Estonian Prime Minister and incoming E.U. foreign policy chief Kaja Kallas spoke before the conference asserting that
“Russia’s defeat is not a bad thing, because […] there are many different nations a part of Russia,” concluding that “if you have small nations it’s not a bad thing if the big power is much smaller.”
https://theowp.org/incoming-eu-foreign-minister-approves-of-breaking-russia-into-smaller-states/
Sauf falsification (improbale) il y aurait au moins un officiel européen qui souhaite
i) la défaite de la Russie
ii) l’éclatement de la Russie en une mosaîque de petits états
https://theowp.org/incoming-eu-foreign-minister-approves-of-breaking-russia-into-smaller-states/
Je n’arrive pas à trouver de source directe relative à cette déclaration da Kallas ,en 2024
Footage from the 2024 Lennart Meri Conference held in May in Tallinn, Estonia seems to reveal a new goalpost for the E.U. in regards to the Ukraine-Russia conflict. The former Estonian Prime Minister and incoming E.U. foreign policy chief Kaja Kallas spoke before the conference asserting that
“Russia’s defeat is not a bad thing, because […] there are many different nations a part of Russia,” concluding that “if you have small nations it’s not a bad thing if the big power is much smaller.”
Sauf falsification (improbable) il y aurait au moins un officiel européen qui souhaite
i) la défaite de la Russie
ii) l’éclatement de la Russie en une mosaïque de petits états
https://theowp.org/incoming-eu-foreign-minister-approves-of-breaking-russia-into-smaller-states/
Les propos de Kaja Kallas sur la défaite souhaitable de la Russie et sa désintégration en petits Etats ,vers 1h 01 (conférence Merri Lenart Tallin 18 mais 2024)
mc.icds.ee/agenda/keeping-up-support-to-ukraine-defining-as-long-as-it-takes/
https://youtu.be/PcFUnybWftM
https://lmc.icds.ee/agenda/keeping-up-support-to-ukraine-defining-as-long-as-it-takes/
Les commentaires sont fermés.