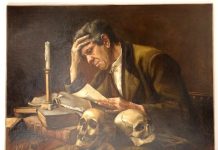Me voici réconcilié avec la sociologie.
J’abordais avec une certaine crainte le livre de Nathalie Bulle, l’Ecole et son double (Hermann, 2009). Diable ! Trois cents pages de plus sur l’Ecole, l’Ecole qui se meurt, l’Ecole qui est morte… N’avais-je pas tout lu ?
Et, pire, reflet de mon insupportable fatuité : n’avais-je pas tout écrit ?
J’aurais dû faire attention au sous-titre, « l’évolution pédagogique en France » : ce que décrit cette sociologue chercheur au CNRS, c’est la main-mise de Darwin — qui à vrai dire n’en peut mais — sur les théories pédagogiques, et particulièrement sur le pédagogisme.
De Nathalie Bulle, je ne connaissais pour ainsi dire rien : un article tout récent dans Libération à propos de la « mastérisation » (1), et un récit de première main de sa rencontre encore plus récente avec quelques piliers du SNALC, rue de Trévise. Mais l’Ecole et son double ? Pourquoi ce titre démarqué d’Artaud — et qui, disons-le tout de suite, rend très imparfaitement compte d’un livre d’une grande richesse ?
Et enfin, allais-je dire du bien d’un travail de sociologie — moi qui ai, dans mon lycée, tout ce qu’il faut de sociologues pour m’en dégoûter ?
Partant de l’état des lieux — la prétention des « pédagogues progressistes » à inciter l’élève à construire son savoir par sa propre activité —, Nathalie Bulle pose immédiatement les termes du débat : est-il bien évident, comme le clament si haut tant de penseurs éminents, de Philippe Meirieu à Pierre Frackowiack, que l’Ecole doive évoluer avec son temps ? L’Ecole n’est-elle pas, comme le supposait déjà en 1984 Jean-Claude Milner, « une formation essentiellement archaïque » ? Et l’opposition entre pédagogols et « instructionnistes », faux et vrais pédagogues, ne tient-elle pas à un sous-entendu jamais explicité sur le modèle qui permet de penser le système éducatif ?
Et cela, non seulement en France, mais dans la totalité du monde occidental, Russie rouge comprise…
« L’école, explique l’auteur, n’a pas été, au cours de son expansion, l’objet de simples mesures adaptatrices qui auraient eu pour vocation d’apporter une solution aux problèmes du moment. Les transformations pédagogiques suivent une voie définie en profondeur. » Et c’est de cette inspiration souterraine, rarement explicitée — sinon par les disciples directs de Piaget — que nous parle ce livre dense et passionnant.
Nathalie Bulle, après avoir posé le problème, le résout tout aussitôt : « L’école en France est en réalité aujourd’hui dominée par des représentations de l’homme et de son développement fondées sur des bases fausses. Les conceptions aussi bien en psychologie, en épistémologie qu’en sociologie, qui ont partie liée et qui ont guidé ses transformations pédagogiques, sont à la source d’une profonde dégradation de son enseignement. »
Pour faire court — je m’en voudrais de trop en dire et de déflorer complètement, au lieu de me contenter d’en ébrécher le suspense, un livre qui se livre lentement — c’est la faute à Darwin (et peut-être davantage encore à Lamarck, dont les théories ont un aspect mécanique qui convient bien aux esprits étroits qui ont adopté ses thèses et les ont adaptées à l’école), et à Marx.
Et, avant eux, « la faute à Rousseau » : une lecture rapide de l’Emile a flingué tous les Gavroches passés, présents et à venir.
Le schéma qu’adoptent, à partir de la fin du XIXème siècle (les pédagos n’ont pas même le droit de revendiquer l’originalité de conceptions qu’ils sont allé glaner ailleurs et autrefois), une bonne part de ceux qui pensent l’Ecole est un schéma biologique mal compris. Nathalie Bulle montre avec une clarté lumineuse que le reproche d’élitisme fait à l’enseignement traditionnel non seulement ne tient pas, mais doit être retourné. « La compétition interindividuelle, explique-t-elle, augmente en contrepartie du travestissement pédagogique de l’école. » Nous le savions intuitivement : jamais, depuis que les pédagogues fous se sont emparés du ministère (au cours des années 1960, la Droite ayant eu à cœur, avant la Gauche, de prouver son incapacité à penser sainement l’Education), la « reproduction » bourdieusienne ne s’est étalée avec autant d’évidence. Avec Prost, Legrand, Meirieu, est vraiment venu le temps des héritiers. Et le discours de leurs séides (« Si le système marche mal, c’est qu’on n’a pas encore appliqué à fond nos recommandations ») rappelle la logique folle de la Terreur — coupons des têtes, il en sortira bien quelque chose — et de tous les systèmes orwelliens : ce n’est pas tout à fait sans raison que Laurent Lafforgue appelait ces gens des « Khmers rouges ».
Qui ne comprend pourtant que la pédagogie pensée sur un modèle biologique (en gros, calquée sur ce que nous croyons savoir de l’évolution du cerveau humain) donne, comme le disait Voltaire de Rousseau, envie de marcher à quatre pattes ? Qui ne voit que le « biologique » se pense, justement, contre l’humain — et d’abord contre l’humanisme ?
Et comme il faut bien un « bon » dans l’histoire, un contre-modèle sociologique à tant d’horreurs satisfaites, Nathalie Bulle s’appuie sur Lev Vygotsky, auteur, en 1934, de Pensée et langage (opportunément réédité en 1997), qui montre, contre Piaget, que nous sommes des animaux culturels avant d’être des bêtes, et que l’occultation de ce fait essentiel a des conséquences pédagogiques dramatiques.
Et aurait, si le système était adopté par les primates d’en bas, le même effet catastrophiques que sur les primates d’en haut que nous sommes. Heureusement, les petits singes apprennent au contact de leurs aînés, au lieu de redécouvrir à chaque génération le principe du casse-noix. La contestation de la transmission verticale des savoirs nous ramène, lentement et sûrement, vers l’âge des cavernes : déjà, les barbares sont à nos portes.
Suivent de remarquables chapitres sur les responsabilités successives et lentement croisées de Rousseau (la condamnation du « par cœur, parmi tant d’autres fadaises du philosophe suisse qui affirmait que « le plus heureux est celui qui souffre le moins de peines » — Antibi, me voilà !), des positivistes (la déviation de la théorie des trois âges de l’humanité par les fidèles d’Auguste Comte), de Herbert Spencer (contemporain de Darwin, il avait proposé, avant même la parution de l’Origine des espèces, un schéma social calqué sur les théories naturalistes) et de Marx : la démonstration implacable de la concomitance du renversement dialectique opéré par l’auteur du Manifeste et du scientisme sociologique hérité de Darwin est réjouissante. Au passage, Nathalie Bulle, qui est allée chercher dans les archives les rapports officiels qui ont fondé les politiques létales successives du Ministère, montre que lesdits rapports ont été falsifiés, leurs conclusions détournées, par des idéologues dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne s’embarrassent pas d’une grande rigueur.
Le plus drôle (et c’est sans doute la seule faiblesse de ce livre passionnant d’un bout à l’autre), c’est que les objectifs clairement anti-capitalistes de ces gens-là ont nourri le libéralisme et ses dérives les plus outrancières. Le XIXème siècle, en choisissant très soigneusement dans l’héritage des Lumières (Rousseau ou La Mettrie contre Condorcet), et en se faisant le promoteur de systèmes « naturels », a engendré aussi bien Bastiat que Darwin — ou John Dewey.
Nathalie Bulle égratigne au passage quelques-uns de ses confrères. Dubet, par exemple, chantre de la « culture commune », aura, après ce livre — et probablement avant, dans la mesure où plusieurs chapitres sont des reprises d’articles parus antérieurement dans des revues savantes — bien des raisons d’en vouloir à sa consœur. Elle prouve, documents à l’appui, qu’ils n’ont cessé d’être guidés, dans la rédaction des innombrables rapports qu’ont leur a demandés, par des a priori fort peu scientifiques, de l’invention de « l’adolescent » au constat affligé de l’échec du collège, jamais assez « unique » à leur goût. Elle aurait pu aller jusqu’à l’actualité la plus récente : le « lycée unique » que le bon Richard Descoings voudrait mettre en place, le « lycée à la carte » que la réforme, pour l’instant suspendue, proposait, sont deux exemples récents de cette idéologisation de l’Ecole. Nathalie Bulle, qui cite longuement les théoriciens américains qui ont inspiré si fort nos anti-capitalistes libertaires et pro-libéraux, raconte comment ils ont détruit l’Ecole américaine, et comment les USA d’ailleurs ont tenté de réagir, non sans succès parfois, à cette déferlante de pseudo-scientisme éducatif. Nous avons là aussi cinquante ans de retard.
Le clou de la démonstration est dans un chapitre dense (l’ensemble du livre l’est — on n’est pas là pour rigoler) où l’auteur prouve, par a + b, que les théories scolaires issues du cadre biologique ont inspiré les systèmes éducatifs de tous les régimes totalitaires, qu’il s’agisse de l’URSS des années 1920 ou de l’Italie fasciste. Qu’ils ont aussi été appliqués à l’aveugle dans l’Allemagne de Weimar, ce qui a fourni à Hitler des troupes merveilleusement dociles, à force d’avoir appris à ne pas penser. Parce que la pensée est du savoir restitué, et non l’aboutissement d’un processus neurologique, ou d’une « activité » stérile.
Des réserves ? Pas même. Un style parfois un peu touffu, mais que les spécialistes de sociologie trouveront trop clair — Nathalie Bulle a le tort d’écrire en bon français. Et un titre qui reste pour moi énigmatique — ou, en tout cas, très parcellaire : racontant dans le détail deux cents ans d’errances pédagogiques, décrivant sans complaisance la plus grande mystification idéologique des temps modernes, elle pose enfin les bases de ce qui serait une vraie sociologie de l’Education, dégagée des errances idéologiques de ses devanciers. L’Ecole et son double est le grand livre dont nous avions besoin pour refonder l’Ecole — ce sont, d’ailleurs, ses derniers mots.
Jean-Paul Brighelli
(1) On en trouvera une version longue sur http://skhole.fr/node/142
(2) Sur ce point précis, le lecteur pressé trouvera sur la Toile, sous la plume de Nathalie Bulle, une mise en perspective de l’emprise de la pensée éducative progressiste sur le système scolaire américain du début du XXe s., ainsi que la traduction d’un chapitre du livre écrit sur cette question par Arthur Bestor, historien américain. Voir http://skhole.fr/node/143