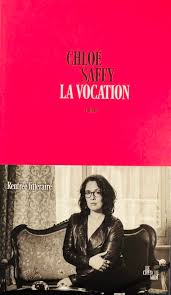
Jusqu’où peut aller la soumission — celle que l’on impose comme celle à laquelle on consent ? C’est le point nodal de toutes les histoires sado-masochistes (et je pense comme Deleuze que c’est un adjectif tout à fait impropre, il n’existe rien qui soit en même temps sadique et masochiste, et le sadique n’est certainement pas la complémentaire du masochiste — sauf exception…). Les contrats que signent Maîtres(ses) et Soumis(es), et qui sont le plus souvent rédigés par le « bottom » et non par le « top », épluchent soigneusement tout ce qui est licite (combien de coups de canne, fisting par ci et pas par là, etc.) et ce qui ne l’est pas. D’où l’usage fréquent d’un « safe word » qui interrompt toute pratique que l’Autre juge, en cet instant, insoutenable. L’ignorer équivaut à une rupture de contrat.
Et puis, comme à l’école, il y a le hors-contrat : la relation fondée sur l’acceptation absolue, dont la limite frise le rivage des morts. Sans s’y précipiter, sinon ça cesse d’être drôle. Sans parler des contraintes — effacer les empreintes, faire disparaître le corps, et autres menus soucis.
La Vocation, le dernier roman de Chloé Saffy, qui a largement donné dans le genre érotique mâtiné de BDSM, explore ce type de situation extrême. « Salomé », qui a hameçonné la narratrice via Facebook, entre peu à peu dans son imaginaire, et lui confie, par bribes puis par pans entiers, sa « vocation » : se soumettre jusqu’à accepter les transformations physiques les moins évidentes. Il ne suffit plus ici de s’assujettir l’esprit, mais de domestiquer le corps, non seulement sexuellement parlant (c’est la moindre des choses), non seulement masochistement parlant (c’est la routine), mais dans la structure même de son corps, modifié par les Maîtres qu’elle s’est donnés.
Cela commence par l’habillement, cela va de soi. Jupe crayon, bas couture, maquillage excessif, lingerie choisie ou interdite.
Les punitions sont nombreuses — même si la narratrice ne s’étend pas sur la question, rien ne ressemble plus à un coup de fouet qu’un coup de canne ou de cravache. Après tout, comme le souligne Chloé, « la flagellation est moins une punition qu’une récompense, un moment de connexion intime, où l’instrument est un prolongement du lien entre les partenaires. » On juge par là que nous n’avons eu, elle et moi, que des relations littéraires.
La gamme de « Sanctions » (la majuscule est là pour rappeler l’aspect quasi théologique de ce monde interlope) est fort étendue, depuis celles « où la douleur est vive mais limitée » (comme dit Valéry, « un mal vif vaut mieux qu’un supplice dormant ») jusqu’au redoutable « berceau », sorte de cheval-d’arçons médiéval, dont on ne se remet qu’avec 48 heures de repos complet.
L’étape suivante, ce sont les modifications physiques, visant une réification complète. Augmentation mammaire « selon la technique des expanders », qui « consiste à introduire une valve dans le sein et à la remplir de sérum physiologique à l’aide d’une canule placée derrière la poitrine, sous les aisselles » — avec reconstruction définitive des tétons. L’effet recherché, c’est l’artificialité. Puis modification des lèvres « selon la technique des Russian lips », par injections d’acide hyaluronique, pour accentuer l’arc de Cupidon et empêcher la bouche de se fermer. Et Chloé Saffy de comparer cette sculpture sur chair au manga de Kyôko Okazaki (une femme elle aussi), Helter-Skelter, dont l’héroïne, Lili, mannequin-vedette, a été entièrement redessinée — c’est le cas de le dire — par un Pygmalion femelle bien plus impitoyable que celui de la fable.
Enfin vient la clôture dans une maison éloignée. Salomé y est coupée du monde, coupée de sa géographie familière, transplantée dans un univers concentrationnaire visant à la modifier en profondeur. Un cocon où s’opèrera la transition finale.
Ne racontons pas la suite. Elle vous ébouriffera.
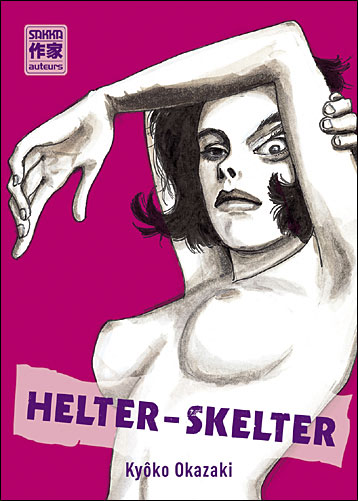
Deux critiques cependant.
L’écriture joue raisonnablement sur l’empathie, et le technicien rationaliste que je suis déplore parfois que Chloé Saffy ne se cantonne pas à la froide observation clinique — mais cela vient sans doute du fait qu’elle est elle-même plus dans le masochisme que dans le sadisme. Ensuite — et c’est à mes yeux plus gênant —, rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ? C’est comme pour les anorexiques : quelle haine de soi préside à ces métamorphoses ?
Ce qui, du coup, nous amène à penser que toute cette histoire est peut-être une fiction, et qu’en fait de reconstruction, c’est le Texte qui, sous nos yeux, est la chair modifiée par les mots. C’est là que la référence à Kyôko Okazaki prend tout son sens. Mais pourquoi pas ? Une fiction est l’élaboration maniaque d’un objet de papier, par griffures successives sur la page, ajouts ici, suppressions là — élaboration d’un être de papier plus réel que les poupées des magazines et de nos boulevards.
Jean-Paul Brighelli
Chloé Saffy, La Vocation, Le Cherche-Midi, août 2025, 266 p., 20 €.
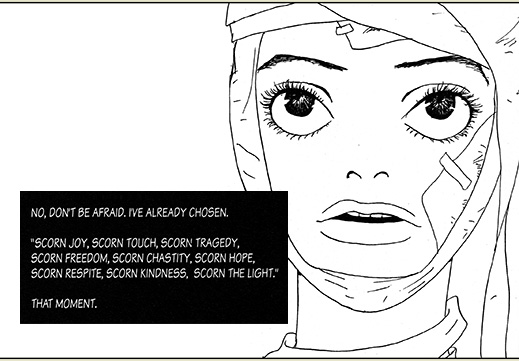

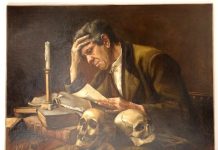


« Une fiction est l’élaboration maniaque d’un objet de papier, par griffures successives sur la page, ajouts ici, suppressions là — élaboration d’un être de papier plus réel que les poupées des magazines et de nos boulevards. »
Voilà. Réponse donnée.
Avec un vocabulaire quelque peu… désuet :
« papier » (deux fois), « page », « magazines ».
Les « griffures * successives », le « masochisme », le « sadisme », ont pris
formes nouvelles… de plus en plus éloignées du… « papier »,
à l’exception (?) de cette « fiction… le Texte qui, sous nos yeux, est la chair modifiée par les mots » :
cf les tatouages – lisez-moi ! – et les « reconstructions » diverses mais guère variées.
L’homme ne deviendrait-il rien de bien plus qu’un objet, le jouet, la « poupée »… de son propre petit écran ?
Une fiction de plus en plus mal « élaborée », éloignée à tout prix du « réel » ?
sa « soumission » n’aura-t-elle jamais de fin ?
* Les « griffures », ce sont aussi les marques (et labels)
prêchées (!) par ces incessants « exercice(s) de communication »,
remarquables marqueurs dans l’« efficacité, (la) séduction, (la) capacité à subjuguer » (cf « Eros et Thanatos », JPB, 11h41)
ou bien qui se cantonnent à des coups de griffes…
bien incapables de la moindre « efficacité, séduction, capacité à subjuguer » ; mais là n’est pas l’important.
(il arrive aussi et encore, que pour signer, on laisse sa griffe… et même sur écran.)
« rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ?
i) Et oui, on a du mal à expliquer de tels comportements…Dans un roman, l’auteur eût pu construire davantage son personnage,ne pas laisser entière l’énigme.
ii) S’agit-il d’un comportement pathologique ? (En tout cas ce n’est pas excellent physiologiquement parlant.)
« quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter »
L’idée que le comportement soumis se rattache à une culpabilité,le Maestro l’a déjà proposée
au sujet de la meuf au matelas, Emma Sukowicz.
Ne sachant pas ce qu’il faut entendre par le mot « écriture » (pris dans son sens nouveau, non courant-celui des narrtologues et autres)-ainsi que l’a souligné tout récemment Josip gavrilovic- Lormier se gardera bien de chercher à savoir si dans ce paragraphe le Maestro sepréoccupe de récit comme discours et donc écriture ou de récit comme histoire.
Rappel:
ECHO 27 août 2025 à 11h08
Pourquoi s’ intéresser au récit en tant que discours serait la seule approche valable ? Et s’intéresser au récit en tant que récit, pour ce qu’il raconte, une attitude inculte ( ou d’inculte)?
vous m’avez ôté les mots de la bouche:Josip Gavrilovic parle du « récit comme histoire. »
Il est plus simple et percutant de dire « récit comme récit ». Lormier s’intéresse au récit comme récit.
Dans le laïus de Josip Gavrilovic, une seule chose est vraie:Lormier ne sait pas ce que c’est que « l’écriture » (hors le sens courant du mot).
Tout le reste n’est qu’allégations sans fondement. Il n’y a aucune citation à l’appui.
Lormier va-t-il lire les narratologues ,essayer de comprendre le concept d’écriture ? Non.
Après un certain âge,on fait des choix;la narratologie,c’est sûrement intéressant, mais il y a des domaines qui intéressent bien davantage Lormier. Et le temps est compté.
Tant pis, Lormeir lira des fictions sans les comprendre et ses commentaires sur les billets du Maestro resteront superficiles,sans intérêt.
L’étape suivante, ce sont les modifications physiques
Je me demande si cette pratique a quelque rapport avec le bio-hacking; Les bio-hackers sont ces gens qui, sans qu’on leur ait rien demandé cherchent à « hacker » leur corps,à coups d’hormones et de substances chimiques,afin de le transformer, de l’augmenter.
L’idée même de modifiez ses gènes ,de se transgéniser est dans l’air.
Beaucoup de gens (lobotomisés ou non) n’ont pas hésité à se faitre injecter une substance qui fait produire par leurs cllules une protéine étrangère.
On commence à se demander si cela ne peut aboutir à une transformation permanente de leurs gènes.
modifier
Tiens…je suis tombé là-dessus
Collection dirigée par Jean Paul Brighelli et Michel Dobransky
https://www.calameo.com/read/000015856ba325e792c5e
Et ça a bien marché !
Le texte sur lequel je suis tombé s’intitulé » « La cicatrice »…je n’ai lu que le titre.
JG
27 août 2025 à 13h50
Brighelli botte un peu en touche avec cette réponse.
Faisons néanmoins un arrêt de volée sur ce coup de pied en touche :
– un texte peut être jugé sur son efficacité : les commentaires de Lormier concernent-ils l’efficacité du texte ? Jamais.
– un texte peut être jugé sur son potentiel de séduction: les commentaires de Lormier concernent-ils le potentiel de séduction du texte ? Jamais.
– un texte peut être jugé sur le plaisir qu’il donne : les commentaires de Lormier concernent-ils le plaisir donné par le texte ? Jamais.
Et pourquoi cela ?
Parce que les commentaires de Lormier, le plus souvent, ne s’intéressent ni au signifiant ni au signifié. Lormier a les yeux fixés sur le(s) référent(s).
C’est ce qui m’a permis de dire un jour que Lormier ne sait pas ce qu’est la Littérature et qu’il n’y comprend rien.
JG
27 août 2025 à 14h16
ECHO : « Pourquoi s’ intéresser au récit en tant que discours serait la seule approche valable ? Et s’intéresser au récit en tant que récit, pour ce qu’il raconte, une attitude inculte ( ou d’inculte)? »
Je vais essayer d’être clair :
1. S’intéresser au récit en tant que discours, c’est tout simplement prendre en compte le fait littéraire. L’approche narratologique est une des façons de prendre en compte le fait littéraire, une parmi d’autres : il y a aussi l’approche thématique (G. Poulet, J-P. Richard…), il y a l’approche psychanalytique (J. Starobinski, G. Bachelard, G.Woodroffe…) etc. Toutes ont en commun de prendre en compte le fait littéraire, et donc de considérer le récit en tant que discours.
2. Ça n’est pas être inculte ou sot de considérer le récit en tant qu’histoire. C’est la lecture-plaisir, c’est le plaisir de se laisser emporter par les événements que raconte l’histoire, c’est le plaisir de se laisser manipuler par un suspense bien ficelé, c’est le plaisir que procure Scheherazade…
Mais en aucun cas on ne peut considérer cela comme une analyse critique du texte.
(Précision toujours utile : « critique » ne signifie pas ici « contestation, reproche ».)
Et si on ne se livre qu’à une critique ou analyse de l’histoire que raconte le texte ? Je me sens mal armé pour analyser certains textes mais bien capable d’en critiquer l’histoire racontée.
En fait, l’histoire ne compte guère. C’est ce qui fait que certaines histoires ont été racontées souvent — parce que ce qui compte, c’est l’interprétation. Giraudoux a intitulé l’une de ses pièces « Amphitryon 38 » parce que c’était la 38ème version de la même histoire.
Dans un air d’opéra, on juge la réalisation — pas l’histoire; Eh bien, c’est pareil en littérature ou au cinéma. Voir Arlequin serviteur de deux maîtres, de Carlo Goldoni. Ça a inspiré aussi bien Kurosawa (Yojimbo, 1961) que Sergio Leone (Pour une poignées de dollars, 1964) ou Walter Hill (Dernier recours, 1996). Même histoire — mais ds traitements fort différents.
JG
27 août 2025 à 13h59
ECHO :
« ceux qui « replacent » leurs connaissances »
Légèrement désobligeant, ce « replacent », comme s’il s’agissait de vouloir impressionner la galerie et se faire mousser…
Quand Dugong évoqué René Thom, Newton ou Einstein, « replace »-t-il des connaissances ? Non. Il s’appuie sur des éléments de connaissance qui l’ont marqué, qu’il a validés, et qui lui servent à expliquer le monde – autant que faire se peut.
Quand j’évoque Barthes, Genette, Todorov, Starobinski ou Culioli, je m’appuie sur des éléments de connaissance qui m’ont marqué, que j’ai validés, et qui me servent à expliquer la Littérature et plus généralement le Langage – autant que faire se peut.
Lormier
» L’idée même de modifiez ses gènes ,de se transgéniser est dans l’air. »
Il y a une tendance a refuser l’état « naturel » du corps également visible dans la revendication transgenre.
Ce que signifie profondément cette tendance, et comment elle s’impose toujours plus ( effet de mode ?) mérite l’attention.
modifier
» Quand j’évoque Barthes, Genette, Todorov, Starobinski ou Culioli, je m’appuie sur des éléments de connaissance qui m’ont marqué, que j’ai validés, et qui me servent à expliquer la Littérature et plus généralement le Langage – autant que faire se peut. »
Pardonnez moi la pique. Nous replaçons tous ce que nous connaissons. Mais vous concernant, j’ai l’impression que vous maniez volontiers les concepts, mais on reste un peu sur sa faim quant à l’analyse et l’enrichissement apporté au texte.
Peut être ( je le dis sans ironie) pourriez vous choisir un texte relativement court de la littérature et faire une démonstration de narratologie. Vous me répondrez que vous l’avez déjà fait ( sur Proust par exemple ) mais cela restait allusif.
Le plus » scolaire » que sera la démonstration, et le mieux ce sera pour la compréhension.
« on reste un peu sur sa faim quant à l’analyse et l’enrichissement apporté au texte. »
Je n’ai jamais prétendu enrichir un texte. Jamais je n’aurai l’arrogance et l’outrecuidance de prétendre « enrichir » un texte.
En revanche, quand je prends en compte le fait littéraire, j’essaie d’éclairer tel ou tel aspect du texte. Cet éclairage peut s’exercer sur un aspect du texte qui a même échappé à son auteur…
Cela peut être plus ou moins réussi, plus ou moins convaincant, bien sûr.
Je tiens à dire ici avec force que j’ai une vraie admiration pour ceux qui franchissent le pas de l’écriture de fiction. C’est pourquoi j’admire Brighelli, mais j’admire aussi par exemple abcmaths, qui s’y est lancé.
Quant à moi je n’ai jamais eu ce courage et ne l’aurai sans doute jamais.
« Lormier lira des fictions sans les comprendre et ses commentaires sur les billets du Maestro resteront superficiels, sans intérêt. »
Lormier, votre ego en souffre certainement, mais si vous avez un peu de lucidité et d’honnêteté intellectuelle, vous avez dû constater que vos commentaires des textes de Brighelli n’étaient jamais repris par d’autres, ni suivis de remarques vous rendant hommage pour avoir éclairé tel ou tel aspect du texte.
A contrario, quand il m’est arrivé de me livrer à cet exercice du commentaire, j’ai recueilli quelques marques d’approbation, venant parfois de Brighelli lui-même…
Je ne dis pas cela pour sottement plastronner et me faire plus grand que je ne suis, ni pour méchamment vous inférioriser.
Je dis cela parce que cette différence de réactions du commentariat face à vos commentaires et face aux miens signifie quelque chose. Elle signifie que l’un d’entre nous prend en compte le fait littéraire et que l’autre a le regard fixé sur le référent.
Voilà tout.
Un jour,j’en suis certain, vous cesserez de vous comaprer aux autres. Ce jour-là,on peut dire que vous serez sorti de votre névrose.
Quant à votre crapulerie,c’est une autre paire de manches. Je crains (sans en être sûr) qu’elle ne survive à votre névrose.
En effet,dans vos proppos crapuleux, on ne trouve pas trace de cette névrose;c’est toute une panoplie de fouberies,d’approximatins, d’esquives et de mensonges bien maîtrisés.
Vous avez bien sûr votre style particulier mais tout de même vos techniques se retrouvent chez d’autres crapules.
On peut être une crapule heureuse,ce n’est pas le sujet.
Je ne sais pas si l’on se rend bien compte de ce qui est train de se passer sur ce blog.
Lormier tient à mon égard des propos insultants, extrêmement désobligeants.
On a quitté le terrain de la controverse pour entrer dans celui de la diffamation.
Je crois qu’on a perdu Lormier. Il a fini par prendre pour argent comptant ses inventions à mon sujet.
Lormier, emporté par ses propres fictions…
Metalepse, encore et toujours !
Mais attention tout de même : l’insulte et la diffamation ne sont ni des tropes ni des figures de rhétorique.
ECHO :
« Peut être ( je le dis sans ironie) pourriez vous choisir un texte relativement court de la littérature et faire une démonstration de narratologie. Vous me répondrez que vous l’avez déjà fait ( sur Proust par exemple ) mais cela restait allusif.
Le plus » scolaire » que sera la démonstration, et le mieux ce sera pour la compréhension. »
Vraiment ?
Je veux bien essayer.
Mais ne perdez pas de vue une donnée essentielle : l’approche narratologique est une parmi d’autres. Je ne serai jamais exclusivement « narratologue », même Genette ne l’a jamais été !
Il faut me laisser un peu de temps : pour choisir le texte, l’analyser, et rédiger quelque chose qui tienne debout.
Ça vous convient ?
Tout à fait.
ECHO 27 août 2025 à 14h35
Peut être ( je le dis sans ironie) pourriez vous choisir un texte relativement court de la littérature et faire une démonstration de narratologie.
Ca ne vous a pas suffi le tissu d’âneries sur Proust ?
Moi qui ne m’énerve pas facilement,je reconnais que ça m’a énervé.
Au point de mauvaise foi où il en est arrivé, Lormier en est à faire croire que je me suis lancé dans un commentaire de Proust et de La Recherche…!
Quelle est la réalité?
J’ai commenté un morceau de phrase de Brighelli – même pas une phrase entière. Ce morceau de phrase, le voici :
« À temps perdu — et je n’ai plus le temps de le perdre… »
Je rappelle que l’hypothèse que j’ai avancée concernant ce morceau de phrase a été validée par l’auteur, Brighelli lui-même.
Ça n’a pas l’heur de plaire à Lormier. Tant pis, je crois que tout le monde s’en fout.
Mais j’apprécierais qu’il arrête de mentir. Ça devient agaçant.
Il ne s’agit pas du tout de cela. Il s’agit de vos grosses conneries sur « la matière de l’oeuvre » (la Recherche) et de votre énorme contresens sur l’expression « temps perdu ».
Vous avez bel et bien aligné un paragraphe de pures âneries sur Proust.
Vous avez réussi à m’énerver,alors que je suis habituellement très calme.
Le menteur,c’est vous. Je vais finir par devoir employer avec vous un langage explicite;
1. « votre énorme contresens sur l’expression « temps perdu » « .
Votre Maestro a confirmé que ça n’était pas un contresens. Ça vous fait probablement bien chier. En ce cas bourrez-vous d’Imodium.
2. « la matière de l’oeuvre » (la Recherche) : allez-vous nous dire que cette œuvre ne se prête qu’à une seule et unique interprétation, la vôtre ? Allez-y, ridiculisez-vous encore un peu plus, c’est très amusant à voir.
Bonaparte disait : « Quand l’adversaire commet une erreur, il ne faut surtout pas l’interrompre. »
Je ne vous interromps surtout pas : continuez, je vous en prie.
Sur la »matière de l’oeuvre »,je vous avais répondu:la matière de l’oeuvre,c’est l’oeuvre.
(Autrement dit, Madame Verdurin et son salon c’est tout autant la « matière de l’oeuvre » que tout le reste.)
Jean-Paul Brighelli
27 août 2025 à 15h29
En fait, l’histoire ne compte guère.
Je vous en conjure, M’sieur Brighelli, déployez tout votre talent pédagogique pour expliquer ça à Lormier.
Expliquez-lui que le fait littéraire n’est pas dans l’histoire.
On vous a déjà conseillé de bien vouloir vous occuper de vos fesses. C’est un bon conseil, je vous assure, fait de bon coeur.
Il est amusant, Lormier, quand son Maestro lui dit en fait la même chose que moi, et que je le lui signale.
Il se sent désavoué – et de fait, il l’est.
Alors il se cabre.
Oui, c’est assez amusant à observer.
Je n’en ai pas dit assez ?
Pour moi, si.
Pour Lormier, visiblement, non.
L’animal est rétif.
(il arrive aussi et encore, que pour signer, on laisse sa griffe… et même sur écran.)
Dans les administrations,certains fonctionnaires ont accès à la griffe du chef de service. privilège.
Joe Biden, président sénile,qui,parfois ne savait pas où il était ,ne signait rien;
C’est l’auto-pen (version moderne de la griffe) qui signait. Bien sûr l’auto-pen était manié par quelqu’un ou quelques uns. Qui ? On a parlé de la bande à Obama.
Les grapheurs,ces artistes des rues ,sont-ils des griffeurs ?
Il faudra que Lormier vous retrouve le texte de la conférence du Maestro,prononcée devant
un parterre de psychanalystes, sur écriture et cicatrice. Vous vous en souvenez ? Mais peut-
être l’avez-vous archivée.
JG 27 août 2025 à 14h52
« on reste un peu sur sa faim quant à l’analyse et l’enrichissement apporté au texte. »
Je n’ai jamais prétendu enrichir un texte. Jamais je n’aurai l’arrogance et l’outrecuidance de prétendre « enrichir » un texte.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voyez comme il ruse.
ECHO n’a pas dit que JG prétend « enrichir un texte ». Tout le monde a compris qu’il a voulu dire « enrichir la lecture du texte, enrichir la compréhension du texte ». C’est une expression un peu ramassée,économe,Joisp Gavrilovic le sait très bien mais fait semblant de ne pas comprendre.
ECHO a bien dit « enrichir un texte ».
Il n’a pas dit « enrichir la lecture d’un texte ».
Ratiocinez tant que vous voulez, les faits sont là, aisément vérifiables, à votre grand dam.
Seriez-vous devenu subitement gratte-papier chez un comptable, rond de cuir myope et graisseux ? Ne considérant que la lettre ?
Une analyse n’est pas la réécriture d’un texte ;elle ne modifie pas le texte lui-même,évidemment; ce qu’on espère d’un commentaire, c’est qu’il nous fasse relire le texte d’un oeil plus vif et que donc notre lecture en soit enrichie.
Tout le monde l’a compris.
Vois jouez au con.
(Je rejette a priori et a posteriori l’hypothèse que vous soyez vraiment con.)
« ce qu’on espère d’un commentaire, c’est qu’il nous fasse relire le texte d’un oeil plus vif et que donc notre lecture en soit enrichie. »
Je valide intégralement cette affirmation de Lormier.
Que Lormier aille au bout de cette affaire et se demande honnêtement si ses commentaires des textes de Brighelli parviennent à accomplir la mission qu’il assigne au commentaire.
C’est tout l’objet du débat.
Je n’ai pas fixé une norme,j’ai seulement expliqué la phrase d’ECHO que vous vous ingéniez à comprendre de travers.
Décidément,vous êtes souvent à côté de la plaque; comme dit Trump à propos de Macron: »you always get it wrong. »
(Rappel:vous avez pris un exemple destiné à poser une question d’udsage du français pour le début d’un récit.)
En fait je me souvenais d’un de vos posts (mais retrouver lequel et à la suite de quel billet …) dans lequel vous disiez à peu près que l’analyse d’un texte par la narratologie lui apportait un intérêt supplémentaire , ce que j’ai traduit par enrichissement. On peut en effet juger que ce n’est pas le texte qui est enrichi directement, mais il s’agit bien de lui conférer un intérêt supplémentaire par rapport à une lecture ordinaire.
Tout le monde avait compris,même Josip Gavrilovic. Il fait le con.
Si vous dites « enrichir la lecture d’un texte », la formulation me plaît.
Pour ma part je dis « éclairer tel ou tel aspect d’un texte ».
Pourtant vous n’êtes pas toujours aussi lourd.
Laissons Le Spécialiste jargonner dans Son domaine… et
au passage, merci aux autres Spécialistes qui ont eu la décence de ne pas imposer, ici, leur Spécialité.
Désolée pour mon médiocre niveau… (j’espère ne pas faire trop honte à ce blog).
J’ai au moins parfaitement entendu le message suivant – certains ont l’art de faire passer, d’autres pas, ou si mal – :
« En fait, l’histoire ne compte guère. C’est ce qui fait que certaines histoires ont été racontées souvent — parce que ce qui compte, c’est l’interprétation. Giraudoux a intitulé l’une de ses pièces « Amphitryon 38 » parce que c’était la 38ème version de la même histoire.
Dans un air d’opéra, on juge la réalisation — pas l’histoire; Eh bien, c’est pareil en littérature ou au cinéma. Voir Arlequin serviteur de deux maîtres, de Carlo Goldoni. Ça a inspiré aussi bien Kurosawa (Yojimbo, 1961) que Sergio Leone (Pour une poignées de dollars, 1964) ou Walter Hill (Dernier recours, 1996). Même histoire — mais ds traitements fort différents. »
« jargonner » ?
Récit ? Histoire ? Discours ? Du jargon ?
L’observateur devenant trop souvent voyeur ? Du jargon ?
Le commentateur ne faisant plus vraiment la différence entre les vraies personnes de la vraie vie et les personnages inventés d’une fiction? Du jargon ?
Allons allons WTH, vous galéjez.
Pas de « personnage inventé » sans sa correspondance dans la « vraie vie ».
Et vice versa.
Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas ça n’a rien de jargonnant. Vraiment rien.
« c’est à mes yeux plus gênant —, rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ? »
Il me semble que dans ce passage,le critique s’intéresse au « récit comme récit »,plus précisément au « personnage comme personnage ».
Et pour quelques indices de plus (suite) :
Lu dans le Fogari : « L’Éducation nationale va proposer une intelligence artificielle aux professeurs « pour les accompagner dans leur métier » »
J’en connais qui accepteront de se faire greffer une connexion dans le cerveau (ou ailleurs si ça convient mieux)
Et pour quelques points d’indice de plus…
Déjà signalé, espèce d’enkh :
[Reprise de la formule « ça veut dire ce que ça veut dire… » –
EN :
Non seulement « portables en pose »
et « exigences » du Bac « resserrées »
et « Nouveau programme d’éducation à la vie affective et sexuelle »
Mais encore :
« L’EN va proposer une intelligence artificielle aux professeurs « pour les accompagner dans leur métier »
« L’IA servira à lui débroussailler le travail »
« un vrai levier pour faciliter l’apprentissage. Il faut que chacun soit conscient que c’est un peu comme un cerveau auxiliaire… »
« Un appel à projets financé à hauteur de 20 millions d’euros par « France 2030 » lancé «pour développer une IA souveraine (…) qui sera disponible dès l’année scolaire 2026-2027». (😁)
« Cet outil permettra de soutenir les enseignants »…
(lefiga)
L’EN : « rebel(le) »… with a cause !
Les cahiers au feu (déjà fait), les profs au milieu (c’est en… cours).]
et même que j’insiste :
Les cahiers au feu (déjà fait),
les profs au milieu (c’est en… cours).
(espèce d’enf’ : c’est mieux ; pas question de devenir aussi grossière que Lormier – 😁)
enkh se comprend habituellement comme enkhulé, mais pourrait fort birn se comprendre (en fonction du contexte) comme enkhuleur;
(ou enf’ pour enfileur – qui ne se contente pas d’enfiler des perles)
Oui
Laissons Le Spécialiste jargonner dans Son domaine…
On ne dit pas jargonner,on dit technolectiser.
« jargonner » ?
Récit ? Histoire ? Discours ? Du jargon ?
L’observateur devenant trop souvent voyeur ? Du jargon ?
Le commentateur ne faisant plus vraiment la différence entre les vraies personnes de la vraie vie et les personnages inventés d’une fiction? Du jargon ?
Allons allons Lormier, vous galéjez.
Encore à côté de la plaque!
Lormier n’a rien dit sur le fond,il a proposé de remplacer un vocable par un autre,plus gavrilovicien.
Dugong adore compter les points.
Oui…
(le jeu de fléchettes reste amusant)
JG 27 août 2025 à 16h25
2. « la matière de l’oeuvre » (la Recherche) : allez-vous nous dire que cette œuvre ne se prête qu’à une seule et unique interprétation, la vôtre ?
J’ai oublié de noter qu’impiicitement vous reconnaissez que votre baratin ne portait pas exclusivement sur le texte du Maestro mais bel et bien sur La Recherche;
« c’est à mes yeux plus gênant — rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ? »
gênant ? En quel sens ? Le personnage serait plus cohérent,plus convaincant si nous connaissions davantage son histoire préalable ? Certes, un personnage (réel ou fictif) a toujours une part de mystèr,un personnage qui se soumet à de tels protocoles encore plus,certes il n’est pas question de tout expliquer…mais enfin le critique estime qu’il y a une lacune.
Je n’ose décider si dans ce paragraphe le Maestro traite du récit comme discours ou du récit
comme récit mais j’incline très fortement à penser qu’il s’agit bien du récit comme récit.
Lors des fêtes de Dax, une connasse sapée ras la moulasse monte sur une table et agite son dargeot sous le nez de braves gars attablés. Pour épurer l’air, une main aurait bougé là où il ne fallait pas.
Evidemment, la presse de canival (des caniveaux) a sauté sur l’occase
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/agression-dune-influenceuse-a-dax-le-parquet-ouvre-une-enquete-20250820_BEWFPLBK4BE25BD4A4ETQ3PGQE/
Le Parquet exigera-t-il une reconstitution de la saynète ?
Et quid si l’influenceuse tente d’influencer le Parquet, en omettant de porter une culotte ?
JG 27 août 2025 à 16h11
Je ne sais pas si l’on se rend bien compte de ce qui est train de se passer sur ce blog.
Lormier tient à mon égard des propos insultants
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il s’offusque parce que Lormier le traite de crapule ? La crapule monte sur ses grands chevaux ?
Alors ça,c’est la meilleure!
Le crapulet monte dans les aigus.
Quand Dugong commente une toile:
https://www.galerie-com.com/oeuvre/bonnie-and-clyde/332749/
Quand Dugong se paie ma fiole, c’est une fiole de poison made in Vérone estampillée WS. C’est ça, la classe.
Ce pôvre Lormier, lui, s’ingénie à tirer vers le bas un débat pourtant diablement intéressant : qu’est-ce que le fait littéraire ? Peut-on le commenter ? Faut-il le commenter ? Si oui, pourquoi et comment ?
A se comporter comme il le fait actuellement, Lormier va très vite devenir le maillon faible et la honte de ce blog.
Le commentariat jugera.
« fiole de poison made in Vérone estampillée WS » :
‘reusement que le Spécialist’ est là pour éclairer notre lanterne ;
Mais passer de « Vérone » au « maillon faible », c’est quand même loin d’être « la classe ».
« Le commentariat jugera. »
@WTH
« Crapule, crapuleries, toute une panoplie de fourberies, d’approximations, d’esquives et de mensonges bien maîtrisés » (dixit Lormier à mon propos), c’est ça la classe, selon vous ?
Le commentariat jugera.
Encore à côté de la plaque:votre crapulerie,c’est d’avoir imputé à Lormier des idées qu’il n’a jamis eues ni exprimées,c’est d’avoir inscrit Lormier dans la liste des cinq partisans de la « solution finale ».
Je répondrai peut-être à ça à mon retour de l’île de Pag.
Pour l’instant, je me prépare à honorer au mieux ma douce et tendre épouse, après une exploration très fructueuse de la gastronomie croate.
Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça.
Je crois qu’elle m’aime.
A plus !
WTH 27 août 2025 à 17h32
« L’IA servira à lui débroussailler le travail »
Je connais des professeurs;ce qui leur plairait et leur serait vraiment utile ce serait une IA qui corrige leurs copies.
Dugong 27 août 2025 à 16h40
Et pour quelques points d’indice de plus…
Le plus probable est que cette innovation serve à demandre aux professeurs de faire plus d’heures;l’IA vous fait gagner du temps,alors en échange travaillez plus.
Enfin une bonne nouvelle (les occludés volontaires et les lobotolisés ne la verront pas)
Kennedy wrote, “I promised 4 things: 1. to end the emergency. 2. to end covid vaccine mandates. 3. to keep vaccines available to people who want them, especially the vulnerable. 4. to demand placebo-controlled trials from companies.”
“In a series of FDA actions today we accomplished all four goals. The emergency use authorizations for Covid vaccines, once used to justify broad mandates on the general public during the Biden administration, are now rescinded,” he added.
L’autorisation d’urgece pour les vaccins anti-covid est annulée.
https://www.wtaj.com/hill-politics/fda-rescinds-emergency-use-authorizations-for-covid-19-vaccines-rfk-jr/
G 27 août 2025 à 21h07
Pour l’instant, je me prépare à honorer au mieux ma douce et tendre épouse
Branchez la GO Pro et uploadez sur xhamster;vous savez qu’il y a un voyeur ici.
Lu plus haut sous la plume du maître des lieux : « l’histoire ne compte guère ». En désaccord complet, c’est à mon sens parce que l’histoire est « bonne » (a définir) qu’elle donne lieu à plusieurs interprétations, chacune littérairement différente.
Jean-Paul Brighelli 27 août 2025 à 15h29
En fait, l’histoire ne compte guère. C’est ce qui fait que certaines histoires ont été racontées souvent — parce que ce qui compte, c’est l’interprétation.
=========================================================
Oui,mais évidemment, la condition première c’est que l’histoire soit bien ficelée.
Les histoires qui ont été racontées mainte et mainte fois étaient dès le départ d’excellentes histoires susceptibles d’être sans cesse ré-interprétées.
Tout cela me semble évident.
Dans la recension que vous faites de Sally,il y a cette critique (critique au sens de criticable, mise en évidence d’une faiblesse):
« Ensuite — et c’est à mes yeux plus gênant —, rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé »
C’est une critique de l’histoire en tant qu’histoire (pas en tant que « discours »,whatever hat may mean);
Le personnage (personnage comme personnage pas « fait littéraire ou je ne sais quoi) le personnage ne « tient pas vraiment » Il y a une lacune;on n’en sait pas assez sur elle pour « adhérer »,il y a manque de cohérence.
Bien sûr,dans un récit les personnages gardent toujours une part de mystère…mais là c’est trop.
Par ailleurs vous avez votre théorie sur la soumission (élaborée au cours de vos soixnte années d’étude de la femme,notamment de la femme soumise):presque toujours la femme soumise héberge en elle un sentiment plus ou moins diffus de culpabilité.
Vous n’avez rien trouvé de ce genre dans le livre (mais vous n’auriez pas rejeté une autre « explication »)
Là on a simplement une meuf qui fait que des trucs bizarres sans qu’on sache du tout pourquoi.
L’écriture,je sais pas ce que c’est…c’est pas le style ,paraît-il;dans le fond je me fous de savoir ce que c’est au juste et je présume que les diverses écoles de narratologie en donnent des définitions divergentes et se battent là-dessus comme les grands-boutiens et les petits-boutiens. Si ça les amuse. Moi,ils me barbent.
Bon,ces choses ayant été dites,je crois quand même comprendre à peu près cette phrase:
L’écriture joue raisonnablement sur l’empathie, et le technicien rationaliste que je suis déplore parfois que Chloé Saffy ne se c ;
Là il s’agit du récit comme discours/fait littéraire .
L’écriture joue raisonnablement sur l’empathie, et le technicien rationaliste que je suis déplore parfois que Chloé Saffy ne se cantonne pas à la froide observation clinique
Pourquoi ce serait mieux de se cantonner à la froide observation clinique ?
Sherlock déplore régulièrement que Watson enjolive ce qui selon lui devraient être des analyses logiques désincarnées.
Souvenir douloureux d’un analyseur logique Textronik de 15kg qui m’était tombé sur le pied quand je bossais chez STMicroelectronics, c’est mes ongles de pied qui ont été désincarnés.
Pour le reste, le plus souvent, la littérature est une distraction dangereuse -tu le sais jipé- qui fait grimper le pratiquant imprudent au 20ème étage de la cave réservée aux intellectuels narcissiques, bourrés d’orgueil.
Sans plus…
La logique c’est lourd, mais lourd !
Mais qu’est ce qu’ils sont lourds les analystes ! Un analyseur logique, c’est lourd ! et ça a des coins, des arêtes, qui aspirent à taper des orteils sous gravité A fuir !
Le lieu naturel d’un analyseur logique ce sont les gros orteils. Aristote nous l’a révélé, pas la peine d’en faire une histoire…
« le technicien rationaliste que je suis »
Maestro,vous êtes maÏtre de mainte technique;de laquelle s’agit-il ici ?
Les hôpitaux français invités à se préparer à la guerre d’ici mars 2026, selon des instructions du ministère de la Santé
Figaro ce jour.
Avertissement de routine selon la ministre …
» Il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises»
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-hopitaux-francais-invites-a-se-preparer-a-la-guerre-d-ici-mars-2026-selon-des-instructions-du-ministere-de-la-sante-20250827
Le Royaume Uni a commandé des morgues « portatives ». On discute Outre-Manche du pourquoi.
Les complotistes disent que c’est pour faire face à l’épidémie de morts inexpliquées.
Les anti-Starmer pensent que le gouvernement prévoit de faire tuer des militaires britanniques en Ukraine.
Ce Starmer s’est d’ailleurs fait tancer vertement,à la Chambre des communes par le Speaker qui a usé d’un langage explicite (You are a disgrace!) et s’est emporté.
Ce ton est extrêmement rare chez un Speaker. Ce « discours » (avec son « écriture » et son rendu sonore) est déjà un morceau d’anthologie.
Motif ?
Starmer a dévoilé ses projets stratégiques au cours d’une conférence, alors qu’il aurait dû le faire au Parlement;
Et oui,pour un Français c’est difficile à comprendre:au RU, le Parlement,ça compte, le PM est responsable devant lui.Il en est issu et quoique Ministre,reste un parlementaire;
Jean-Paul Brighelli 28 août 2025 à 3h15
Sherlock déplore régulièrement que Watson enjolive ce qui selon lui devraient être des analyses logiques désincarnées.
Si je comprends bien,il faudrait que certains passages soitient écrits dans un style sherloch holmesien…Cela contrasterait avec d’autes,alors ?
Bon, je n’ai pas lu le roman, je spécule dans le vide.
PS Tout d’un coup, cette histoire d’analyse désincarnée, ça me fait vaguement penser à Bachelard et à son histoire de « surcharge »…Je ne me rappelle plus trop;de toute façon, Bachelard…
Quand on est détective et qu’on cherche l’auteur d’un meurtre,on fait pas de la littérature,d’ac, mais quand on fait de la littérature,on peut se permettre de faire un peu de littérature quand même, ou pas ?
Watson comme personnage-personnage il se définit un peu par l’écriture (son langage propre, ses « enjolivements »). Alors Zut! on peut pas vraiment séparer le « plan du discours du plan de l’histoire » !
Le narratologue a oublié de nous dire si ces plans éraient parallèles, se coupaient et selon quel angle…On ne sait d’ailleurs pas pourquoi il appelle ça des plans.
Le sait-il lui-même ?
Des plans,pourquoi pas des sphères ? Pourquoi pas des tubes ? Pourquoi pas des tores ?
Le discours du narratologue c’est de la bouillie.
Par ce post de 8h33, Lormier continue à se ridiculiser de belle manière. Et ayant bien assimilé le conseil stratégique de Bonaparte (« Quand l’adversaire commet une erreur, il ne faut surtout pas l’interrompre »), je l’encourage à continuer sur le même ton, encore et encore.
Continuez, Lormier, continuez. Je ne vous interromprai surtout pas.
Zut! Moi qui croyais qu’on allait ^tre tranquille quelques heues…que vous lliez devoir vous reposer de vos efforts de la nuit passée.
Les efforts auxquels vous faites allusion ont sur moi un effet régénérant.
Dommage pour vous, je pète la forme !
Comme d’habitude, le « narratologue » ne sait pas quoi répondre à Lormier.
Peut-on mettre cela sur le compte de la fatigue post-coïtale ?
Pas vraiment,car c’est tout le temps la même chose avec lui, coït ou pas coït;
Mais enfin, Lormier, pourquoi vous répondrais-je ? Vous ne comprenez pas ce que je dis, ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre.
Et l’ironie dont vous faites preuve ne ridiculise que vous, et vous n’en avez même pas conscience…
Alors continuez, continuez, continuez.
ECHO 28 août 2025 à 8h27
Les hôpitaux français invités à se préparer à la guerre
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Citation:
« la ministre de la Santé Catherine Vautrin n’a pas nié l’existence de cette lettre. «Les hôpitaux sont tout le temps en train de préparer des épidémies, des accueils (…) Il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises, les conséquences de ce qu’il se passe. Cela fait partie de la responsabilité des administrations centrales», a-t-elle déclaré.
On l’a bien vu avec les masques et les blouses,du temps de Buzyn.
NB « écriture » (tore du discours ministériel)
« tout le temps en train de préparer des épidémies » pas « se préparre à », non préparer verbe transitif.
En effet la pandémie a été très bien préparée,planifiée; c’est pourquoi on l’appelle « plandémie »
Shdrlock Holmes est souvent présenté ( surtout dans les premières œuvres) comme une sorte d’esprit désincarne ( désolé pour le dernier accent) .
Dans les annees 1900 un auteur américain d’origine française, Jacques Futrelle ( mort je crois dans le naufrage du Titanic ) inventera un personnage de détective qu’il surnommera » la machine à penser ».
Holmes est aussi présenté ( un peu artificiellement) par Conan Doyle comme une machine à penser.
Il est normal qu’il regrette que l’aspect logique de son travail ne soit pas mieux mis en évidence par Watson, qui enjolive par du romanesque..
Mais évidemment ce qui a fait le succès des histoires de Sherlock Holmes, c’est l’alliance du logique et du romanesque ( attribué au narrateur Watson, prête nom de Conan Doyle) .
Réduites à leur pur aspect de déduction intellectuelle, les enquêtes de Holmes n’auraient pas eu de succès.
Et voilà;deux personnages (pris comme personnages) qui contrastent l’un avec l’autre;c’est ce qui fait fonctionner le recit (pris comme récit). Pour chacun des deux une « écriture » (whatever that means) spécifique;
La sphère du récit/ discours intersecte avec la sphère du récit/récit.
Un lecteur inculte tel que Lormier peut apprécier Conan Doyle bien qu’il manque à parler Genette .
Utiliser Watson comme narrateur, c’est précisément une astuce narratologique.
Conan Doyle : « Sherlock Homes and his stupid friend. »
Il y a quelques rares nouvelles où c’est Holmes le narrateur. Et je crois qu’il y en a au moins une, « His last bow », (qui si je ne m’abuse, est la dernière dans la chronologie diégétique) avec une focalisation zéro.
Sans surprise, elles sont moins percutantes que le reste du canon.
Le choix du narrateur, c’est un truc tout simple qui peut produire des effets très puissants : Humbert Humbert dans Lolita, Max Aue dans les Bienveillantes… et bien sûr le narrateur de Molloy.
Pour employer les termes adéquats, Watson est la plupart du temps à la fois le narrateur homo-diégétique et extra-diégétique des récits holmesiens écrits par Conan Doyle.
Miraculeux ! Personne n’a encore émis l’hypothèse que Cocoon et JG soient une seule et même personne…
Pardon ?
Retour sur une réflexion qui mérite commentaire :
Lormier
27 août 2025 à 16h50
Sur la »matière de l’oeuvre »,je vous avais répondu:la matière de l’oeuvre,c’est l’oeuvre.
1. « La matière de l’œuvre, c’est l’oeuvre ». On n’y est pas encore tout à fait, mais avec pareille lapalissade on n’est plus très loin de la tautologie, caractéristique de l’anti-intellectualisme poujadiste pourfendu en son temps par Barthes…
2. « Ô privilège du génie ! Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. »
(Sacha Guitry)
Guitry, par delà le trait d’esprit, percevait quelque chose d’essentiel : la matière de l’oeuvre c’est l’oeuvre (lapalissade), et l’oeuvre trouve un prolongement naturel, en quelque sorte un appendice, dans les sensations et/ou réflexions qu’elle suscite chez le lecteur.
Reprenant le mot de Guitry, on peut, en exagérant à peine, dire : « Ô privilège du génie ! Lorsqu’on vient de lire La Recherche de Proust, les innombrables réflexions qu’elle suscite sont encore de Proust. »
Je laisse Lormier ratiociner à loisir sur tout ça.
Lorsqu’on vient de lire La Recherche de Proust, les innombrables réflexions qu’elle suscite sont encore de Proust. »
Pas si le lecteur est Josip Gavrilovic.
Continuez à vous ridiculiser avec des piques de cour d’école maternelle, ça manquait à votre panoplie.
@ECHO
Je n’oublie pas votre demande.
Je ne suis pas actuellement dans les meilleures conditions pour la satisfaire, étant loin de chez moi et de ma bibliothèque. Je regagne mes pénates la semaine prochaine. Il vous faudra attendre jusque là.
Mais soyez certain que je ne me déroberai pas.
Aucun souci, profitez de vos vacances !
Bonjour,
rien à voir avec cet article mais je ne sais pas comment poser la question à M. Brighelli. Sur vos interventions sur la stratégie de Lisbonne, les 90% de consommateurs, et les 10% de cadres: je cherche à trouver la source, le texte qui mentionne cela, je n’ai pas encore réussi. Pouvez vous m’aiguiller si vous l’avez sous la main?
Vous pouvez chercher longtemps.
Un revenant ! sincères salutations.
Je suppose que vous êtes au courant des déclarations du Hamas sur la réussite du 7 octobre , les « fruits » de l’opération,dont la nouvelle politique de Macron à l’égard de la Palestine ?
On entend souvent que Macron est complètement démonétisé sur le plan international (Trump ayant dit que cses déclarations sont sans importance…)
Il y a du vrai:il ne pèse pas grand chose.
Mais tout de même il y a une entité politique qui l’apprécie énormément:le Hamas.
https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel
Ghazzi Hamad se félicite aussi que,gâce au 7 ocobre, des milliers de Josip Crapulovic- qui se terraient entre les lattes des parquets et derrière les lambris -soient sortis et manifestent au grand jour.
Utiles soutiens de la cause djihadiste en Occident.
https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel
Que dire ?
On a perdu Lormier.
Je me demande si il vaut la peine qu’on essaie de le retrouver.
Sans vouloir trop relancer ce sujet , il m’apparaît qu’il y a aujourd’hui, chez les pro palestiniens, un discours basé sur de fausses évidences, ou même des contre vérités, que personne parmi les sachants ne corrige.
L’une de ces fausses évidences est que la Palestine existait avant Israel. La preuve, au 19 eme siecle, on parlait de Palestine .
Voir sur le mode « savant » cet article de Blast qui attribue aux Israeliens la volonté de nier qu’on ait jamais parlé de Palestine avant le 20 eme siècle.
Ce que ne comprend pas cet article et encore moins les ignares qui s’expriment, c’est que le nom Palestine autrefois ne désigne pas ce qui vient a l’esprit aujourd’hui. C’est un mot utilisé par les Occidentaux depuis longtemps et synonyme de Terre Sainte, autre appellation de la région. Personne sur place ne parle de Palestine parmi la population arabe et encore moins de Palestiniens. Par contre les juifs qui immigrent sur ce territoire parlent, eux de Palestine.
Quand le mot désignera de nouveau une entité politique, ce sera avec le mandat britannique sur la Palestine.
https://www.blast-info.fr/articles/2025/herodote-chateaubriand-flaubert-quand-les-ecrivains-nomment-la-palestine-WcZrVCA1Q9iL2nRNdMLm_g
« L’écriture, qu’est-ce que c’est ? » se demande Lormier.
Son maestro lui donne ici quelques indices :
« Ce qui, du coup, nous amène à penser que toute cette histoire est peut-être une fiction, et qu’en fait
de reconstruction, c’est le Texte qui, sous nos yeux, est la chair modifiée par les mots. C’est là que la référence à Kyôko Okazaki prend tout son sens. Mais pourquoi pas ? Une fiction est l’élaboration maniaque d’un objet de papier, par griffures successives sur la page, ajouts ici, suppressions là — élaboration d’un être de papier plus réel que les poupées des magazines et de nos boulevards. »
Je n’ai pas envie de savoir ce qu’est « l’écriture ». Je m’en fous. Des Trissotin ont lancé ce vocable dans les années 60;je les ai ignorés,ils étaient ridicules. Croyez-vous que soixante ans plus tard Lormeir veuille se lancer dans une carrière de Précieux ridicule ?
Si jamais vous voulez, après mûr examen, vous lancer dans une carrière de Précieux Ridicule, sachez que vous avez déjà fait la moitié du chemin.
Ridicule, vous l’êtes déjà abondamment.
Dans l’expression « Précieux ridicule », l’adjectif n’est pas séparable du substantif.
JG 28 août 2025 à 9h53
1. « La matière de l’œuvre, c’est l’oeuvre ». On n’y est pas encore tout à fait, mais avec pareille lapalissade on n’est plus très loin de la tautologie,
Josip Gavrilovic tronque;c’est une fourberie élémentaire. Mais il en a bien d’autres bien plus subtiles
Lormier 27 août 2025 à 16h50
Sur la »matière de l’oeuvre »,je vous avais répondu:la matière de l’oeuvre,c’est l’oeuvre.
(Autrement dit, Madame Verdurin et son salon c’est tout autant la « matière de l’oeuvre » que tout le reste.)
« Autrement dit »…signifie que ce qui suit cette expression est une reformulation : dire autrement ce qu’on a déjà dit.
Donc, en prenant en compte votre première formulation et en considérant la deuxième comme inutile car redondante, je n’ai évidemment rien tronqué.
CQFD.
Je vous rappelle que selon vous,le salon Verdurin, ce n’est pas « la matière de l’oeuvre ».
Ca, c’est complètement idiot.
Bon ,je laisse tomber,je n’ai pas envie de me replonger dans vos conneries ,qui m’avaient énervé.
D’ailleurs cette histoire de « matière » n’est venue que parce que vous prétendiez n’avoir commenté que le propos du Maestro et rien dit sur Proust.
Implicitement vous l’avez reconnu.
Comme vous êtes fourbe, vous ne le reconnaissez pas explicitement,cela ne m’étonne pas.
Bis :
JG
28 août 2025 à 10h03
Mais enfin, Lormier, pourquoi vous répondrais-je ? Vous ne comprenez pas ce que je dis, ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre.
Que diriez-vous d’un petit échantillon d’intelligence ? https://share.google/v75aWiBUcWqO2uYIE
Ca pourrait servir d’antidote ?
Oui, pour un patient gravement atteint comme vous, par exemple.
Je plaisante.
Vous, vous êtes un cas désespéré.
🙂
Swift (pourrait écrire JG – mais pas Jonathan) récapitulation * à ma façon d’une matinée (synthèse dirait Lormier),
pleines de signes (et non singes **) savants, dont :
– « Aristote » et les orteils
– « dernière dans la chronologie diégétique) avec une focalisation zéro. Sans surprise, elles sont moins percutantes que le reste du canon.» *
————-
* pas question de capituler : bientôt le pas-encore-loqueàterre pourrait nous faire l’article (16), avant la distribution de « Tous résilients », au son du canon (« et il dit : Lève-toi, Tue-les »)
** ce n’est pas la mousmé de JG habituée à son ramage éclairé (cf les Lumières) qui irait passer « une nuit avec des perroquets, au parc animalier Parrot World » (lefigaro)
Vous avez noté l’effronterie ?
« Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça. »
Définitions de « autrement dit »
Autrement dit – Locution adverbiale
Autrement dit — définition française (sens 1, locution adverbiale)
Cette locution sert à reformuler de façon différente, souvent plus précisément ou de manière mieux compréhensible, ce qui est dit précédemment.
[…], on doit se rappeler que […] l’islam insiste sur la communauté, non sur l’individu, et que la croyance religieuse est, en même temps, de ce monde et de l’autre ; autrement dit transcendante ou eschatologique et immanente en une seule et même fois. — Panayiotis Jerasimof Vatikiotis, L’Islam et l’État
Usage du mot « autrement dit »
Mon « autrement dit » introduisait une application concrète de la notion.
ECHO 28 août 2025 à 11h20
Sans vouloir trop relancer ce sujet , il m’apparaît qu’il y a aujourd’hui, chez les pro palestiniens, un discours basé sur de fausses évidences,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Moi non plus je ne voudrais pas trop relancer le sujet. Je veux juste inviter à écouter Ghazzi Hamad, haut dignitaire du Hamas.
Il s’est félicité de la réussite du 7 octobre ,en a décrit les résultats positifs dont les deux que voici:
i) Macron s’est déclaré favorable à la reconnaissance d’un Etat palestinien. Or un Etatt palestinien est indispensable à la poursuite de la guerre contre Israêl et à son extension en Occident.
Autrement dit, Macron est un soutien du djihad. Cela ne serait pas arrivé sans l’opération du 7 octobre;
ii ) En Occident, sont apparus au grand jour des mililiers de Crapulovic. Jusque là ils se terraient entre les lattes du parquet ou derrière les lambris; le 7 octobre les a galvanisés et maintenant ils manifestent ouvertement.
C’est encore un soutien précieux au djihad.
https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel
Bis :
JG
28 août 2025 à 11h19
Que dire ?
On a perdu Lormier.
Je me demande si il vaut la peine qu’on essaie de le retrouver.
Vous n’avez sans doute pas besoin d’écouter Ghaszzi Hamad;vous le connaissez bien et communiquez régulièrement avec lui.
C’est la faut’aux boomers !
a dit le Béarniais (74 ans) – jeune boomer, comme les Barnier et Rebsamen, et même Larcher ;
… ainsi que 50 sénateurs entre 70 et 80 ans, et même 4 de plus de 80 ans (senat.fr) –
sans oublier Jack L., 85 ans.
L’ancêtre Lormier a donc toute sa place ici.
Mais conscient du problème, fera-t-il l’effort (en dehors du VTT) de se cantonner à des publicités moins tapageuses de produits haut de gamme ?
Seul l’avenir nous le dira.
Publicites honteuses, j’suis d’accord.
Et en plus, il part dès qu’on parle de dette.
Oui…
Le bicarbonate c’est pas luxueux.
» …Ils ont travaillé mais il faut qu’ils protègent les plus jeunes… » a dit le Béarniais qui a peur de paumer et craint sa chute.
Par exemple, Lormier devrait aider le jeune JG, l’encourager, éventuellement le féliciter parfois.
Oui…
Mais je ne manque pas de le féliciter!
a peur de paumer et craint sa chute.
a peur de CHômer et craint sa Pute.
part dès qu’on parle de dette.
pETe dès qu’on parle de dARD.
(fine allusion aux queefs)
Rappel: Kennedy a déjà annulé l’autoristaion de mise sur le marché au titre de l’urgence des « vaccins anti covid »;plus question d’obligation vaccinale pour quicoque,sur tout le territoire;
Des gens bien placés annoncent qur Trump pourrait déciderr prchainement de retirre ces saloperies du marché.
« The Trump administration is considering phasing out COVID-19 vaccines, with insiders citing a 2022 peer-reviewed study showing a 16% higher risk of serious adverse events in vaccinated individuals compared to placebo. »
https://www.naturalnews.com/2025-08-26-covid-jabs-could-be-banned-by-trump-administration-within-months.html
Si seulement Tromp décidait de se retirer lui-même très prochainement…
« Si seulement »…en latin: »Utinam »…On peut s’offrir des moments « hors du temps » où l’on rêve d’un monde plus à notre goût. Des moments qu’il ne faut pas prolonger.
Retour au réel.
Trump est bien ,là, Kennedy aussi.
Susan Monarez, la vaccinolâtre néo-mengeléienne que Kennedy avait poliment prié de démissionner refusait de le faire.
Alors, Trump l’a virée.
Il suffit maintenant d’attendre le développement des effets délétères.
IAL ne sait rien du réel mais il en parle beaucoup.
Utinam, suite :
Rubayat, »traduction » Fitzgerald
LXXIII.
Ah, Love! could thou and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits—and then
Re-mould it nearer to the Heart’s Desire!
nearer to the heart’s desire (refaire un monde plus conforme à ce que le coeur désire)
Comme pour toutes les personnes condamnées, laissons à IAL son droit à mourir dans l’indignité.
De l’individu considéré comme tube…et du bonheur fugace
Il est arrivé que Dugbeong (personnage-personnage ou personnage-discours?) se présente à nous comme tube.
Savoureux couplets sur l’ataraxie atteinte matitudinalement par la défécation en plein air lorsque le péristaltisme est harmonieux.
C’est pendant ces moments arrachés au cours du monde que Dugong s’autorise quelques divagations sur le mode « utinam ».
Toujours soucieux de son prochain, Lormier a conseillé à Dugong de planter des bégonias qui recueilleraient ses matières.
Mais Dugong refuse obstinément;
Quant à Lormier,oui, il lui arrive,comme à tout hmme, de dire « utinam ».
Mais quand le réel est angoissant, Lormier accepte de trembler et s’interdit de dire
« utinam ».
Ainsi,jamais vous ne l’entendrez dire : »si seulement tous les Crapulovic, tous les cloportes,tous les cafards pouvaient retourner dans les parquets et les lambris !
Non, il faut faire face:les suppôts du Hamas sont bien là, parmi nous en Occident.
Ghazzi Hamad est là à se frotter les mains. Macron aussi est là;
Nous allons connaître de grandes calamités.
Vous avez noté l’effronterie ?
« Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça. »
Ce n’est pas que de l’effronterie;on trouve dans ce texte des thèmes névrotiques habituels.
« simple agrégé de lettres » c’est un sparadrap sur la blessure jamais cicatrisée de l’échec au concours.
C’est aussi l’obfuscation de l’oeuvre. Le sujet n’a pas d’oeuvre,il pleure sur son incapacité à écrire et par conséquent fait mine d’ignorer l’oeuvre du Maestro.
WTH 28 août 2025 à 18h43
C’est la faut’aux boomers !
Qu’est-ce qu’un boomer ? C’est quelqu’un qui est né pendant le « baby boom » . Autrement dit,c’est quelqu’un qui est né peu après la guerre,quansd l’euphorie de la victoire,le retour des prisonniers ont conduit les couples à se reformer,et à copuler comme des lapins.
Combin de temps cette euphorie copulatoire a-t-elle duré ?
Il faudrait consulter les historiens.
Je dirais trois ans:de 45 à 48.
Ce qui veut dire que le plus vieux boomer vivant a 80 ans et le plus jeune 77.
Le Maestro, qui nous a raconté sa conception,dans une calanque, lors d’une permission de son papa, nest pas exactement un boomer.
Bayrou,suivi par un vain peuple et un ramassis de crapules pose une fausse égalité: boomer= retraité.
(Il parle aussi de « l’aisance de l’après-guerre » Il invente une autre Histoire).
Baby boom, baby boomers
Wikipedia :
» Un baby boomer, ou babyboumeur (orthographe rectifiée de 1990), aussi appelé boomer (péjoratif)[1] est une personne née en Occident pendant la période du baby boom, après la Seconde Guerre mondiale. Selon la théorie générationnelle de Strauss-Howe, cette génération comprend les personnes nées entre 1943 et 1960[2]. Une autre acception assigne cette catégorie aux personnes nées entre l’immédiat après-guerre et 1964[3],[4],[5],[6],[7]. Les baby boomers font partie d’une génération entre la génération silencieuse et la génération X. Pendant cette période, la proportion d’adultes mariés augmente ainsi que le taux de natalité[8].
Étymologie
Le terme baby boom désigne une augmentation notable du taux de natalité. L’augmentation de la population après la Seconde Guerre mondiale est décrite comme un « boom » par divers journalistes, dont Sylvia F. Porter dans une chronique publiée le 4 mai 1951 dans le New York Post, basée sur l’augmentation de 2 357 000 dans la population des États-Unis entre 1940 et 1950[9].
La première utilisation enregistrée de l’expression « baby boomer » se trouve dans un article du Daily Press daté de janvier 1963, écrit par Leslie J. Nason. Cet article décrit une augmentation massive des inscriptions dans les universités, alors que les premiers boomers atteignent l’âge adulte[10],[11]. Le Oxford English Dictionary attribue le sens moderne de ce terme à un article publié le 23 janvier 1970 dans le The Washington Post[12]. »
Les dates du phénomène (?) varient donc selon les pays.
La date extrême 1943 concerne, semble-t-il, les USA .
Pourquoi prendre comme date de fin du phénomène 1964 ?
» Les Anglo-Américains parlent alors de « l’âge d’or » et les Français des « trente glorieuses » pour décrire une croissance économique continue. »
Or si on place la fin des trente glorieuses (concept applicable à la France) vers 1974, les derniers boomers seraient nés en 74 (voire 75?)
Une des illustrations (1948, USA) de l’article wikipedia qui part un peu dans tous les sens (le féminisme, les hippies etc tous produits du baby boom) : le baby boom se confond avec la croissance économique et l’augmentation du niveau de vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer#/media/Fichier:The_Ladies'_home_journal_(1948)_(14765206281).jpg
« Il faudrait consulter les historiens. » Et deux lignes plus bas, sans aucune explication :
« Je dirais trois ans:de 45 à 48 »
Tout le monde se fout du désir de IAL d’en être ou pas.
Tout le mobe ?
Non,il exiiste quelqu’un qui ne s’en fout pas.
Dugong 29 août 2025 à 9h52
Comme pour toutes les personnes condamnées, laissons à IAL son droit à mourir dans l’indignité.
Lormier ayant toujours vécu dignement,aura une mort digne.
On verra.
Vous aussi,vous aurez une mort digne,allons…
Toi-même !
Trente glorieuses
wiki
Les Trente Glorieuses sont la période de forte croissance économique et d’augmentation du niveau de vie qu’a connue la grande majorité des pays développés entre 1945 et 1975.
(…)
Après un début difficile, les vingt-huit ans qui séparent la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, du choc pétrolier de 1973 se caractérisent par etc »
1973 ou 1975 ? l’épaisseur du trait. Les choses ne s’arrêtent pas brusquement en 73, mais le repli commence.
Noter que l’expression est d’origine française et a sa source dans une étude sur l’économie et la société française, ce qui rend un peu discutable son application à tous les pays occidentaux (en Italie on parle plutôt du miracle économique etc):
» Ce chrononyme rétrospectif a été créé par Jean Fourastié en 1979[4], car il s’agissait d’une « révolution invisible » lente, en contraste avec la révolution rapide des Trois Glorieuses[5]. Comme l’a montré Pascal Ory, cette expression a vite rencontré le succès et s’est durablement installée[6].
Depuis le XXIe siècle, toute une historiographie s’attache à déconstruire l’expression de Trente Glorieuses[7], ce qui signifie refuser le titre de glorieuses à ces années. »
» une historiographie s’attache à déconstruire etc »
Que ne déconstruit-on pas…
Si ça amuse des gens de constamment changer le sens des mots,pourquoi pas ?
L’euphorie copulatoire, le baby boom, est le résultat de la victoire,retour des prisonniers, espoirs nouveaux.
Que les naissances aient encore été nombreuses jusque dans les années 60, c’est une autre affaire. Dire que c’est encore le boom, c’est un abus de langage.
Par définition,un « boom », c’ezt un truc qui ne dure pas..
épicétou.
Nous produisons constamment des mythes historiques.
« La Belle Epoque », mythe déjà caractérisé comme tel.
Les « Trente Glorieuses »,mythe bientôt caractérisé comme tel;
« Le Moyen Age » obscur et obsurantiste, mythe complètement démonétisé;
L’exterminator détruit les cafards, les cloportes, les termites (pas les crapules,hélas) l’historien détruit les mythes, le rêveur supplie qu’on lui donne une belle bite et se retrouve avec un gros mythe.
Lormier : « tous les Crapulovic, tous les cloportes,tous les cafards »
L’insulte érigée au rang d’instrument privilégié de la dialectique.
Lormier, (in)digne héritier de Rebatet. (Car Rebatet, lui, avait un peu de talent.)
La fachosphère, à la recherche d’une forme d’honorabilité mais irrémédiablement déterminée par son ADN, finit toujours par retomber sur ses fondamentaux.
On avait perdu Lormier. On vient de le retrouver dans la fange. Alors forcément, ce qu’il dégage est assez nauséabond.
On a p
Je termine : on a peut-être intérêt à le laisser là où il est…éloigner l’origine des odeurs désagréables, c’est une mesure de salubrité publique, non ?
« Nous allons connaître de grandes calamités » : Lormier fait son Philippulus !
Le Béarniais à la Fouère de Chalons en Champagne, est encore plein d’espoir :
«Je crois que quelque chose est en train de bouger. » ! (Attention néanmoins au bord de la « falaise » : risque de tomber dans le vide).
On pourra compter sur
« Les plus jeunes… qui s’engagent dans ce combat. Ils ont des armes » » (!), « leurs cercles d’amis », « les réseaux sociaux» (!)
Ainsi a-t-il continué, seul attraction (divertissement ?) gratuite de la Fouère.
Conscient du problème, JG avait décidé de rentrer… en stop pour tenter de convaincre jeunes et moins jeunes qu’il était temps de passer à l’action.
Difficile, car son obsession anti-Lormier reste un sérieux handicap.
Et, tandis que Cramon s’est lui immiscé en Moldavie, histoire de convaincre là-bas aussi le peuple de faire le bon choix,
l’Ambass ricain, Charlie K., après avoir déclaré que Cramon ne faisait pas le bon choix, et en conséquence convoqué au Quai d’ Orsay (enfin ce qu’il en reste), s’est lui empressé d’envoyer un sous-fifre…
Que faire ?
Peut-on compter sur Diabolo pour faire quelque chose ?
https://storage.canalblog.com/86/74/460923/127449758_o.jpg
Josip Gavrilovic qui ne lit pas tous les mots n’est pas non plus attentif à la ponctuation.
« tous les Crapulovic, tous les cloportes,tous les cafards »
Les termes sont séparés par des virgules:un cloporte n’est pas identique à un cafard,ni à un Crapulovic.
Il est vrai que les cloportes et les cafards ont tendance à se cacher entre les lattes et derrière les lambris.
Dire des Crapulovic qu’ils font de même, c’est user d’une image (d’ailleurs,empruntée à l’anglais: »crawling out of the woodwork ») .
Qu’est-ce qui a galvanisé les Crapulovic au point qu’ils se manifestent au grand jour ?
J’adopte l’explication de Ghazzi Hamad,fin connaisseur,bon terroriste et haut dignitaire du
Hamas:c’est le 7 octobre.
https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel
JG : « la fachosphère », « la fachosphère », « la fachosphère », « la fachosphère », « la fachosphère » !…
https://comicvine.gamespot.com/a/uploads/scale_small/11/111746/5120010-c0908a4philippulus.jpg
WTH : « je ne veux pas savoir ! », je ne veux pas savoir ! » ,je ne veux pas savoir ! » ,je ne veux pas savoir ! »
Lisez Rebatet, vous saurez.
L’exterminator détruit les cafards, les cloportes, les termites (pas les crapules,hélas) l’historien détruit les mythes, le rêveur supplie qu’on lui donne une belle bite et se retrouve avec un gros mythe.
illustration:
https://www.youtube.com/watch?v=xloUOlLdz_s
WTH 29 août 2025 à 11h47
l’Ambass ricain, Charlie K., après avoir déclaré que Cramon ne faisait pas le bon choix, et en conséquence convoqué au Quai d’ Orsay (enfin ce qu’il en reste), s’est lui empressé d’envoyer un sous-fifre…
pas le bon choix: reconnaître maintenant un Etat palestinien. En effet cet Etat ne pourra être qu’un état djihadiste permettant la poursuite de la guerre contre Israël, la rendant bien plus efficace et permettant son extension vers l’Occident tout entier.
C’est exactement ce que pensele Hamas qui estime que le choix de Macron est l’un des « fruits » du 7 octobre. C’est ce qu’a dit Ghazzi Hamad à Al Jazira.
Autre propos intéressant de l’ambassadeur: l’antisionisme c’est l’antisémitisme,épicétou.
Les Américains ne m^chent pasleurs mots. Une crapule est une crapule,épicétou.
La reconnaissance de la Palestine par quelques pays importants va t elle changer quelque chose ?
Elle est déjà reconnue par plus de 100 pays. Et pour etre admise a l’ONU comme membre à part entière, je suppose que ce n’est possible que si aucun pays membre du conseil de sécurité ne met son veto ( à vérifier) or les USA n’accepteront pas, du moins pas avant des changements politiques indiscernables avant longtemps.
On est dans le symbole.
Par contre l’installation de la Palestine comme Etat de plein exercice n’aurait pas forcément des conséquences défavorables à Israël : il y aura des compétitions pour le pouvoir qui occuperont les factions palestininennes plus que la lutte contre Israël (vision optimiste).
Les plans » comment sortir de l’impasse » du style de celui ci
https://www.jean-jaures.org/publication/sortir-de-limpasse-a-gaza-une-strategie-alternative-pour-mettre-fin-a-la-guerre/
sont évidemment des plaisanteries car qui va se charger de l’imposer . Certainement pas la Fondation Jean Jaures, émanation du PS.
Néanmoins que de mesures aptes a susciter la colère de la « rue » , au moins en France ( comprenez les LFI et les habitants des cités et autres racises):
» Le Hamas ne sera plus une entité gouvernementale ni impliquée dans la gouvernance de Gaza. Un mécanisme efficace sera mis en place pour assurer le désarmement du Hamas et garantir la démilitarisation à long terme de la bande de Gaza.
Israël assumera une responsabilité accrue en matière de sécurité afin de contrer les menaces et d’empêcher la reconstruction d’infrastructures militaires et terroristes à Gaza. Cela nécessitera de préserver sa liberté d’action opérationnelle. »
» Une administration civile palestinienne sera mise en place, composée de technocrates – des professionnels qui ne sont pas affiliés au Hamas – et liée à l’Autorité palestinienne (AP). L’AP s’associera à l’Égypte, qui dirigera le processus de formation de l’administration technocratique, sous réserve de l’approbation d’Israël en matière de sécurité. Cette administration fonctionnera sous le parrainage et avec l’aide d’une force opérationnelle interarabe, dans l’esprit du plan égyptien visant à mettre fin à la guerre et à stabiliser Gaza, approuvé et adopté par la Ligue arabe en mars 2025. »
« Une force de police palestinienne sera mise en place sans membre du Hamas. Elle sera entraînée en Égypte et en Jordanie, sous la supervision du coordinateur américain pour la sécurité. »
Ce que ne dit pas ce plan ( parce qu’on ne peut pas l’écrire) c’est ce qu’on fera des membres du Hamas.
Non, tous ensemble contre ce plan rédigé par les sionistes…
WTH 29 août 2025 à 11h47
Et, tandis que Cramon s’est lui immiscé en Moldavie, histoire de convaincre là-bas aussi le peuple de faire le bon choix,
Vous êtes légèrement vipérine:il est allé célébrer la f^te de l’Indépendance avec nos amis moldaves;
Comme nous avons beaucoup d’amis dans le monde et que les f^tesd’indépendance tombent à des dates très variées, Macron a un riche programme de voyages;
Je note qu’il n’a pas encore prévu d’aller célébrer la victoire du 7 octobre auprès de Ghazzi Hamade,au Quatar.
Dugong 29 août 2025 à 11h57
IAL ne sait rien du réel mais il en parle beaucoup.
Lormier ne pases pas trop de temps dans le monde de l’utinam.
Il recommande la même hygiène à Dugong qui, comme tout tube, a droit à une vie digne;
ECHO 29 août 2025 à 12h35
Les plans » comment sortir de l’impasse » …Les plans » comment sortir de l’impasse »…
sont évidemment des plaisanteries
=========================================================
Un mécanisme efficace sera mis en place pour assurer le désarmement du Hamas et garantir la démilitarisation à long terme de la bande de Gaza.
Ghazi Hamad : « Je le dis très clairement et en quelques mots : les armes constituent la cause palestinienne. Nos armes et notre cause sont une seule et même chose. Nous avons été élevés depuis l’enfance… Je ne parle pas seulement du Hamas, mais de tous les Palestiniens, et de tous les membres des factions palestiniennes, qui ont porté les armes, combattu, mené le djihad, sont tombés en martyrs et ont irrigué la terre de leur sang. Les armes ont toujours été notre principale force face à l’occupation. Par conséquent, il y a toujours eu un consensus palestinien à ce sujet. Aucun Palestinien ne dit aujourd’hui que la résistance doit cesser, car rendre nos armes signifie la fin de la résistance et la fin de la cause palestinienne. »
traduction Gogle de la traduction angalise des pros tenus en arabe par Ghazzi Hamad,bon terroriste (il y a le bon terroriste et le mauvais terroriste)
https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel
Pour les opinions qui s’expriment sur les » réseaux » (avec des pseudos maghrébins ou style LFI et associés) les gens du Hamas sont comparables aux résistants français, l’un de ces internautes ( probablement français d’origine vu ses références), disait qu’ils étaient comparables à Jean Moulin, Aubrac, Geneviève de Gaulle, P. Brossolette.
Jamais entendu que ces résistants s’étaient livrés a des exactions comparables a celle du 7 octobre, mais cet argument est inaudible pour les laudateurs fanatiques de la Résistance palestinienne qui disposent d’éléments de langage bien rodés.
Bien entendu,il y a de jeunes pro-palestiniens naïfs qui s’muvent à juste titre des souffrances endurées par les Gazaouis.
Il y a aussi des crapules aguerries qui savent très bien ce qu’elles font et qui reçoivent leurs « éléments de langage » directemlent des foyers terroristes du Moyen Orient.
Quant aux disnctions bysantines entre palestiniens ,Hamas et autres factions,ce n’est que poudre aux yeux ,comme on le constate à la lecture des propos de Ghazi Hamad:
» Je ne parle pas seulement du Hamas, mais de tous les Palestiniens, et de tous les membres des factions palestiniennes, qui ont porté les armes, combattu, mené le djihad, sont tombés en martyrs et ont irrigué la terre de leur sang. Les armes ont toujours été notre principale force face à l’occupation. Par conséquent, il y a toujours eu un consensus palestinien à ce sujet. »
Les crapules qui nous opossent leurs arguments sur les 25000 membres du Hamas et les millions de Palestiniens savent très bien ce qu’elles font.
D’ailleurs,c’est lepropre des crapules.
(ECHO – 12h35)
Un « think tank » !
Faut-il être naïf, et/ou stupide pour aller jusqu’à oser écrire :
« Une force de police palestinienne sera mise en place,
sans membre du Hamas.
Elle sera entraînée en Égypte et en Jordanie,
sous la supervision du coordinateur américain pour la sécurité. »
Je doute fort que la Jordanie, et encore moins l’Egypte, accepteraient quoi que ce soit de ce plan (!), d’autant que le « coordinateur américain » * a bien mieux à faire (affaires) ailleurs…
* toujours… sous la tutelle… ricaine **!
Incapable de sortir de cette vision,
cette pauvre Europe de l’ouest,
qui s’acharne, qui se refuse à comprendre, que le monde est vaste,
que les Ricains s’éloignent de l’ère Brzeziński (et du PNAC),
face à Chine-Russie-Inde, etc.
** l’ancien commissaire européen en charge du Marché intérieur et du Numérique (!) : « Face aux nouvelles menaces de Donald Trump, l’Union européenne ne peut plus accepter
la soumission »
(lefigaro) – 😁
WTH 29 août 2025 à 13h45
(ECHO – 12h35)
Un « think tank » !
Faut-il être naïf, et/ou stupide pour aller jusqu’à oser écrire :
Il y a des naïfs;il y a aussi des crapules. Les crapules ne sont pas naïves.Elles sont chapitrées par le Hamas.
Lormier, toujours aussi nul dans l’analyse des techniques narratives, ne voit pas que l’origine énonciative de « simple agrégé de Lettres », c’est ma douce et tendre épouse.
Pourquoi ma douce et tendre épouse dit-elle cela ? Parce qu’elle connaît mon CV, et qu’en regard de ce CV elle estime qu’être agrégé de Lettres n’est pas grand-chose (C’est elle qui parle, voir PS1 ci-dessous).
Mais Lormier ne veut pas en savoir plus. Sans doute a-t-il peur de découvrir qu’il existe d’autres ENS que Saint-Cloud, d’autres Grandes Ecoles prestigieuses, peut-être encore plus prestigieuses que Normale Sup, en France mais aussi à l’étranger, et que tout cela relativise l’importance d’une agrégation de Lettres.
Cela dit, la fréquence avec laquelle Lormier répète sa pure fiction maladive sur mon prétendu « échec au concours » me donne à penser que ce sujet, au fond, le taraude : comme il peut très facilement se montrer « nosy », comme on sait que les détails biographiques de ses interlocuteurs l’intéressent, je parierais volontiers qu’il aimerait bien savoir ce que ma douce et tendre épouse sait qui lui fait dire « simple agrégé de Lettres »…
Eh bien Lormier, si vous voulez savoir, y a qu’à demander !
PS 1 : Lormier a de toute évidence besoin de remettre à jour ses connaissances sur les techniques narratives dans le domaine des énoncés rapportés : discours direct, discours indirect, discours indirect libre, discours narrativisé, voix intériorisée, monologue intérieur…le malheureux est un peu perdu dans cette « jungle hostile » qu’il attribue pour se rassurer à des Trissotins sodomisateurs de drosophiles…
PS 2 : Quand la fiction devient pur mensonge : » il pleure sur son incapacité à écrire et par conséquent fait mine d’ignorer l’oeuvre du Maestro. »
– JG ne pleure rien du tout : il sait ce dont il est capable ou pas. Il se sait donc capable d’écrire des multitudes de choses diverses, à l’exception des textes de fiction. JG assume sereinement ses atouts et ses manques.
– « Faire mine d’ignorer l’œuvre de Brighelli » ? Non mais je rêve : sur ce blog, à part votre serviteur, qui traite les écrits de Brighelli à la hauteur de ce qu’ils méritent et avec la hauteur qu’ils méritent? Lormier et ses commentaires en rase-motte qu’on croirait sortis de Femme Actuelle ou Télé Poche ? WTH et ses soupirs d’admiration inconditionnelle énamourés de groupie professionnelle ? Laissez-moi rire.
Le Brighelli écrivain et commentateur de littérature a droit à toute mon admiration et à toute mon estime intellectuelle (au contraire de ses prises de position politiques, mais ça n’est pas le sujet).
Je répète : j’admire et j’estime ceux de mes congénères qui osent s’exposer en franchissant le pas de l’écriture. J’admire et j’estime abcmaths pour cela. J’admire et j’estime Brighelli pour cela.
« Faire mine d’ignorer l’œuvre de Brighelli »….Non mais des fois !
Symétrie
a) Le Hamas est plus fort qu’on ncroit:
JG 24 août 2025 à 14h21
Mais…mais alors…si le risque existe encore…se pourrait-il que le Hamas ne soit pas to-ta-le-ment-é-ra-di-qué de la région ? Se pourrait-il que l’opération menée par Tsahal ne soit pas un succès total ?
b) Gazzi Hamad: Israêl n’est pas si fort que ça:
Today,through October 7 we proved that defeating Israël is not as difficult as people thought.
(Aujourd’hui grâce au succès de l’opération du 7 octobre,nous avons prouvé que battre Isral n’était pas aussi difficile que nele croyait les gens. »)
https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel
« Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C’était
peut-être hier.
L’asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d’Alger. Je prendrai l’autobus à deux heures et j’arriverai dans l’après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même dit : « Ce n’est pas de ma faute. » Il n’a pas répondu. J’ai pensé alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n’avais pas à m’excuser.
C’était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. Après
l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m’a dit : « On n’a qu’une mère. »
Quand je suis parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y
a quelques mois.
J’ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J’ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais tassé
contre un militaire qui m’a souri et qui m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit « oui » pour n’avoir plus à parler. » (fin du texte cité)
Ce texte bien connu a suscité depuis sa parution en 1942 un nombre incalculable de commentaires.
J’ai pu me procurer les remarques notées par Lormier lors de sa lecture du texte dans les années 1960, notes qu’il a l’intention de regrouper en un commentaire structuré et organisé pouvant faire l’objet d’une communication publique. Aux dernières nouvelles, il y travaille encore : la publication de son analyse est toujours différée sine die. Mais je me suis laissé dire que dans la version définitive, il n’y aurait pratiquement pas de modifications. Ci-après, retranscription des notes de Lormier.
Lormier : De quoi est morte la mère du narrateur ? Et quel âge avait-elle ? Le lecteur aimerait bien le savoir.
Lormier : Le rédacteur du télégramme aurait quand même pu présenter ses condoléances.
Lormier : Tiens, Marengo…Et le narrateur ne fait même pas allusion à la victoire de Napoléon en 1800…Niveau d’études assez bas sans doute.
Lormier : On peut quand même comprendre la réaction du patron. L’absence d’un employé, pour un patron, c’est toujours un problème.
Lormier : Le narrateur a pris l’autobus à 2 heures comme il s’y était engagé. Les gens qui tiennent parole, c’est bien agréable.
Lormier : Le narrateur monte un escalier, et le voilà étourdi…Il est certainement en sur-poids, peut-être en obésité morbide…Quel est son IMG ? Le lecteur aimerait bien le savoir…
Lormier : On peut comprendre le narrateur qui n’a pas envie de parler. Parfois, dans les transports en commun, la compagnie des autres voyageurs peut être très désagréable.
Pas de doute : ça donne envie de lire l’analyse complètement redigée. On a hâte.
🙂
La parodie est souvent plus drôle que l’original. La suite, vite…
Je trouve que c’est quand il se parodie lui-même que Joisp Gavrilovic est le meilleur.
D’ailleurs,il est quasi-impossible de distinguer l’original de la parodie.
Je préfère penser que souvent vous ne faites plus que vous parodier vous-même . Penser autre chose manquerait de charité.
La charité est une vertu.
Et je vous sais gré de ne pas avoir noté un « z » abusif. Charité ?
Il a disparu.
Je vous suis reconnaissant enfin de ne pas remarquer que ce « z » n’a rien d’abusif. Tout au plus est-il fautif.
Encore un miracle aujourd’hui !
Hcc1 semble avoir apprécié un tant soit peu ma prose, et personne n’a pour l’instant envisagé que Hcc1 et JG soient une seule et même personne !
Hier Cocoon, aujourd’hui Hcc1, demain, qui ?
Verrry funny !
croyaient
Discours de Saleem Nussibeh devant l’ambassade d’Israël à Londres. Auditoire enthousiaste:
https://www.memri.org/tv/palestinian-activist-london-rally-israel-destroyed-us-hegemony
C’était le 25 aoüt 2025.
Il est un peu curieux que Madame Gavrilovic ne sache pas encore que le Maestro n’est pas un « simple agrégé ». Pourtant elle est mariée à un homme qui connaît et estime l’oeuvre de Jean Paul Brighelli.
Ma douce et tendre épouse ne s’intéresse pas spécialement à Brighelli. Elle a donc sur lui des informations non exhaustives.
Il faut dire aussi que Brighelli ne fait pas partie de nos sujets de conversation et/ou de préoccupation les plus fréquents, les plus récurrents, les plus cruciaux de notre quotidien. Brighelli n’est pas un sujet qui pour elle mériterait approfondissement.
IAL est comme étranger au réel qui n’est jamais comme il aimerait qu’il soit.
Une maladie dégénérative qui le fait parfois confondre certains humains avec un tube. A l’EHPAD, ils s’y sont habitués.
Le personnage-tube,c’était une image.
ECHO 29 août 2025 à 13h45
Pour les opinions qui s’expriment sur les » réseaux » …
Il y a aussi des « opinions » qui s’expriment devant des ambassades…je veux dire qu’il y a des harangues, des appels à la destruction d’Israël; ces harangues sont applaudies.
Citation:
« Tomorrow, this will be the embassy of Palestine. This will be the embassy of Palestine. There won’t be any Israel! There won’t be an Israel anymore!
(Demain ceci [amabssade d’Israêl, Londres] sera l’ambassade de la Palestine. Israël n’existera plus.)
https://www.memri.org/tv/palestinian-activist-london-rally-israel-destroyed-us-hegemony
Dugong 29 août 2025 à 8h14
Si seulement Tromp décidait de se retirer lui-même très prochainement…
Le réel ne plaît pas à Dugong.
Prolongeons sa phrase.
Si seulement Tromp décidait de se retirer lui-même très prochainement…on pourrait reprendre l’expérience néo-mengeléienne.
Saleem Nussibeh,le 25 août2025 , appelle à la destruction d’Israël; Il le fait publiquement,devant l’amabassade d’Israël:.
Discours enflammé: »Israêl est la tumeur dans le corps du Moyen Orient et il n’y aura pas de paix au Moyen Orient tant que cette tumeur n’aura pas été détruite. »
comme dit ECHo:il y a plusieurs marches au podium.
https://www.memri.org/tv/palestinian-activist-london-rally-israel-destroyed-us-hegemony
Il est un peu curieux que Josip Gavrilovic rapporte les propos de son épouse ,alors qu’elle ne s’intéresse pas particulièrement au Maestro . Pourquoi nous faire savoir qu’à ses yeux c’est un simple »agrégé des lettres » ?
Lormier oublie toujours le contexte, la situation d’énonciation. C’est plus fort que lui, trop fort pour lui, il n’y arrive pas.
Voici le contexte :
« Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça. »
Ma douce et tendre épouse était, à ce moment-là, assez impatiente, d’où cette manifestation langagière un tantinet irritée. Il ne fallait pas lui en promettre. Il fallait passer à l’acte. Ce fut un plaisir.
» Citation:
« Tomorrow, this will be the embassy of Palestine. This will be the embassy of Palestine. There won’t be any Israel! There won’t be an Israel anymore! »
le site de cette chaine d’infos (arabe) donne le transcription suivante:
» Crowd: « Palestine will be free! »
Nussibeh: « From the River to the Sea! »
Crowd: « Palestine will be free! »
Chant Leader: « Palestine is Arab! »
Crowd: « Palestine is Arab! »
Chant Leader: « Palestine is Arab! »
Crowd: « Palestine is Arab! »
Chant Leader: « Intifada, Intifada! »
Crowd: « Intifada, Intifada! »
Chant Leader: « Intifada, Intifada! »
Crowd: « Intifada, Intifada! »
C’est intéressant car il y a deux strates : la protestation contre le « génocide »
mais l’autre strate est bien la volonté d’éradiquer Israel et d’affirmer l’arabité de la Palestine entière (dans les frontières de 48 dit l’orateur ( plutôt ou de 47 ?), donc les frontières de la Palestine avant partition (comiquement, cette Palestine est la Palestine « coloniale « ).
ou plutôt de 47
C’est qu’ils sont nombreux les islamisés, en Europe… de l’ouest.
Il est vrai que les plus vilains d’entre eux ont eu carte blanche (!) pendant des décennies en GB – et pour que même wiki y consacre une rubrique ! *
… parce que les dénoncer aurait été… du racisme !
De même que les me(r)dia se gardent bien d’évoquer les manifestations anti-immigration (Allemagne, GB, Irlande, Espagne…)
… parce que c’est… du racisme !
S’y rajoutant une situation explosive,
sur le plan économique,
seuls les plus « naïfs, et/ou stupides »
pourraient encore croire que
« l’ogre prédateur », « à nos portes » auraient envie de nous boulotter ! même pas en rêve !
*
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_viols_collectifs_de_Telford
Et pendant ce temps, en GB, opération Raise the colours ( le drapeau proprement anglais avec la croix de Saint George, ou l’Union Jack, ou les drapeaux gallois, écossais, nord- irlandais ) divise l’opinion.
Les autorités locales les enlèvent parfois.
Le regard de la BBC.
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/news/articles/c626vxyxgj6o.amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&aoh=17564869700642&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Farticles%2Fc626vxyxgj6o
… Et pas de drapeau de… l’UE, en vue.
Et d’ailleurs Starmer n’a pas fait le déplacement en Moldavie.
Merz, est de passage à Bregançon (« fort diplomatique »),
pour tenter de relancer le « couple franco-allemand » – 😁
Merz qui, lui, n’a pas hésité à déclarer, il y a quelques jours :
https://www.dw.com/en/german-welfare-state-can-no-longer-be-financed-merz/a-73742270
… Ne faut surtout pas oublier la Bundeswehr !
https://www.lecho.be/economie-politique/international/economie/allemagne-rheinmetall-inaugure-une-usine-de-munitions-de-500-millions-d-euros/10621677.html
(« production entièrement automatisée » : ‘heureusement qu’il y aura encore des guerres…
Même si prédominance de drones et autres,
il y aura toujours possibilité de se rabattre sur les « civils » –
en bien trop grosse quantité,
d’autant plus facile s’ils se sont appliqués à suivre – à la lettre – le… « Tous résilients ».)
De quoi se compose le public de Saleem Nussibeh ?
Assez peu d’images…on peut cependant constater qu’il y a un bon pourcentage de visages pâles,qui ont tout l’air d’être des Anglais de souche. On en voit un en particulier ,cheveux tirant sur le roux,coupe en brosse, embonpoint, visage porcin, qui semble connaître quelques mots d’arabe et hurle des slogans, repris par les autres.
Quelle importance donner à l’événement ?
(« Le foot, le foot, le foot » : non, il n’y a pas que ça ; il en est des – « cheveux tirant sur le roux,coupe en brosse » – qui préfèrent « l’intifada », mais juste en rêve !)
Pourvu que je ne mette pas à superposerl’image de ce mec au signifiant « Crapulovic « !
WTH 29 août 2025 à 20h55
… Ne faut surtout pas oublier la Bundeswehr !
=========================================================
Ah surtout pas; la Bundeswehr est client de Hanwag;cela est un atout pour la marque plus que centenaire.
Bundeswehr Schuh Tatra Leder
HanwagArtikel-Nr.: H2326-12-6EAN: 4047761313372Hersteller: Hanwag
https://sportsandmore-24.de/marken/hanwag/bundeswehr/
« Ma douce et tendre épouse… me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. »
Et si ,finalement,il ne s’agissait que de pouvoir écrire « simple agrégé de lettres »…en se cachant dans les jupes de son épouse ?
Lormier a de toute évidence besoin de remettre à jour ses connaissances sur les techniques narratives dans le domaine des énoncés rapportés : discours direct, discours indirect, discours indirect libre, discours narrativisé, monologue intérieur…le malheureux est un peu perdu dans cette « jungle hostile » de voix venues il ne sait d’où…
Qu’il ne compte pas sur moi pour cette remise à niveau. Qu’il s’adresse à son maestro.
Vous oubliez le psycho-récit.
Meilleure (re)mise à niveau : La Transparence Intérieure de Dorrit Cohn.
Merci. Je ne connais pas. Je vais découvrir.
« …en se cachant dans les jupes de son épouse ? »
JG aurait un gros morceau de rouille à cacher ?
Oui…
gros morceau de rouille à cacher ?
gros morceau de Couille ARRachée ?
Je ne sais pas ce qu’l a mais ce qu’il raconte de sa vie privée est à dormir debout.
Sa femme est au lit,toute pomponnée ,à l’attendre et lui, il est encore sur Internet à polir ses vannes…Elle s’impatiente et se demande ce qu’il peut bien raconter sur le « blog d’un simple agrégé. »
Et mon khul c’est du poulet ?
Lormier s’avère plus doué pour la fiction que pour l’analyse.
On est content pour lui : c’est bien qu’il se soit trouvé un domaine qui le valorise un peu et vienne contrebalancer la cruelle exhibition de ses gros manques.
« Sa femme est au lit,toute pomponnée ,à l’attendre »
C’est fou comme Lormier se fait des films…
La réalité est tout autre :
JG
27 août 2025 à 21h07
Pour l’instant, je me prépare à honorer au mieux ma douce et tendre épouse, après une exploration très fructueuse de la gastronomie croate.
C’était tout simplement une sortie de restau ! Le lit, c’était pour plus tard…
Je n’en dirai pas plus.
Dugong 29 août 2025 à 8h14
Si seulement Tromp décidait de se retirer …
Que Dugong ne s’inquiète pas;il pourra se procuere sa dix-huitième dose, m^me si Trump est toujours-là; c’est vrai que kennedy a annulé l’autorisation d’urgence pour les prétendus vaccins mais il ne les a pas retirés du marché. De toute façon les labos européens sont capables de produire cette merde .
De plos Neuder, notre Ministre
radote encore: »sûr et efficace »,et il vient de placer un désinformateutr de première à la tête d’un groupe chargé de traquer la désinformation. Ce désinformateur de première ,c’est le professeur Molimard,alias Molibobard. Il s’est illustré pendant la plandémie, racontant partout que le « vaccin » empêchait la transmission. Puis il a fait de la pub pour une « étude » complètement bidon,rtéactée quelque temps plus tard.
Lzq accros à la piqouse n’ont rien à craindre ici;ils seront servis.
Grosse pute vérolée,mange tes morts,salope de merde. Tu voulais rouvrir ta salle de théâtre,connard, et c’est pour ça que t’as fait ta tribune dans Libé, jouranl de merde .
Ni oubli ni pardon.
Stanislas Nordey, directeur du TNS (Théâtre national de Strasbourg) est à l’initiative d’un manifeste signé par 200 personnalités du monde de la culture en faveur de la vaccination contre la Covid19. Histoire de montrer l’exemple et « de sortir de l’impasse ».
https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/covid19-stanislas-nordey-directeur-du-theatre-national-strasbourg-s-engage-se-faire-vacciner-acte-citoyen-1912230.html
IAL a déraillé mais ne sait pas comment réparer son dérailleur. Alors, il débloque en nazifiant tout ce qui lui tombe dans les circonvolutions (« Ni oubli ni pardon »)
PS : Nordey est un metteur en scène médiocre, actuellement réfugié au Portugal.
Momo3*2 * refait surface :
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2025/08/29/mohammed-vi-l-islam-et-les-islamistes_6637418_3451060.html
* pour IAL : inutile de s’entêter , 6 n’est pas premier…
@ECHO et quiconque s’interroge sur l’écriture et le fait littéraire.
Chose promise…
La commande était : « du clair, de l’accessible, du scolaire même s’il le faut »…
Voici donc ma « Défense et Illustration de la Narratologie ».
Texte :
Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L’angoisse lui tordait l’estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n’était capable en cet instant que d’y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible
qu’une ombre, et d’où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même — de la chair d’homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d’électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l’un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés !
La vague de vacarme retomba : quelque embarras de voitures (il y avait encore des embarras de voitures, là-bas, dans le monde des hommes…). Il se retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière, immobiles dans cette nuit où le temps n’existait plus.
Il se répétait que cet homme devait mourir.
Bêtement : car il savait qu’il le tuerait. Pris ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n’existait que ce pied, cet homme qu’il devait frapper sans qu’il se défendît, — car, s’il se défendait, il appellerait.
Les paupières battantes, Tchen découvrait en lui, jusqu’à la nausée, non le combattant qu’il attendait, mais un sacrificateur. Et pas seulement aux dieux qu’il avait choisis : sous son sacrifice à la révolution grouillait un monde de profondeurs auprès de quoi cette nuit écrasée d’angoisse n’était
que clarté. « Assassiner n’est pas seulement tuer… » Dans ses poches, ses mains hésitantes tenaient, la droite un rasoir fermé, la gauche un court poignard. Il les enfonçait le plus possible, comme si la nuit n’eût pas suffi à cacher ses gestes. Le rasoir était plus sûr, mais Tchen sentait qu’il ne pourrait jamais s’en servir ; le poignard lui répugnait moins. Il lâcha le rasoir dont le dos pénétrait dans ses
doigts crispés ; le poignard était nu dans sa poche, sans gaine. Il le fit passer dans sa main droite, la gauche retombant sur la laine de son chandail et y restant collée. Il éleva légèrement le bras droit, stupéfait du silence qui continuait à l’entourer, comme si son geste eût dû déclencher quelque chute.
Mais non, il ne se passait rien : c’était toujours à lui d’agir.
(Fin du texte)
La Condition humaine, A. Malraux.
Je vous propose une analyse aussi claire que possible de la première page de La Condition Humaine, de Malraux.
– Cette analyse essaie au maximum d’éviter le « jargon », mais ça n’est pas toujours possible, car il faut parfois bien nommer les choses, et les périphrases n’y parviennent pas toujours. Cet effort pour ne pas jargonner conduira certainement à des approximations, à des maladresses. Tant pis, ça n’est pas grave, je ne suis pas en train de me livrer à une soutenance de thèse.
– Bien que cela ne me semble pas totalement satisfaisant, j’ai décidé de m’appuyer sur la définition que donne Brighelli d’une « narratologie bien comprise »,
Jean-Paul Brighelli
27 août 2025 à 11h41
« Récit en tant que discours…
La narratologie bien comprise (Barthes) suppose au fond que l’on applique au Texte les mêmes jugements qu’à tout exercice de communication : efficacité, séduction, capacité à subjuguer et à faire jouir — ou au moins donner du plaisir. »….
….Donc 3 critères : efficacité, séduction, capacité à donner du plaisir.
– Enfin, comme je l’ai déjà signalé, il est impossible de s’en tenir stricto sensu à une analyse des techniques narratives. Cette analyse débouche naturellement (et c’est tant mieux) sur une ébauche d’interprétation.
Voici :
1. Rien de plus agaçant que de rater le début…
…Car comme au rugby, tout commence ici en première ligne :
« Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers? »
Réaction immédiate sans doute commune à tout lecteur : qui parle? Qui pose ces deux questions ?
Le lecteur poursuit sa lecture quelques secondes, quelques lignes, et comprend.
Le narrateur du texte est entré dans la conscience de son personnage et voit le monde par les yeux de son personnage, et ni plus ni moins que cela : ces deux questions, c’est le personnage de Tchen qui se les pose. (Focalisation interne, dans le technolecte genettien)
On aurait pu avoir :
– » « Tenterai-je de lever la moustiquaire? Ou bien frapperai-je au travers? » se demanda Tchen. » Discours direct, mot pour mot ce que pense ou dit le personnage.
On aurait pu avoir également : « Tchen se demanda s’il allait lever la moustiquaire ou bien frapper au travers ». Discours indirect, énoncé rapporté par un narrateur « interventionniste ».
On aurait pu avoir encore : « Tchen réfléchissait au choix à faire entre deux options, soit lever la moustiquaire, soit frapper au travers. » Discours narrativisé par un narrateur encore plus interventionniste.
Dans chacune de ces possibilités alternatives, il aurait fallu avoir recours à un verbe introducteur : se demander, réfléchir à…
Malraux, lui, a mis en place un narrateur qui nous fait part des pensées du personnage Tchen grâce au Discours Indirect Libre.
« Evaluons » cette entrée en matière avec les critères brighelliens :
– Efficacité ? Très élevée. Le lecteur est d’emblée interpellé par les questions initiales, et mis en situation d’espérer une suite captivante (« a state of expectancy »).
– Séduction ? L’absence de verbe introducteur permet d’aller droit au but.
– Plaisir donné ? Substantiel. On n’a pas envie d’interrompre la lecture. « Oh oui…continue…continue…encore…encore…! » (Heu bon, va falloir que je me calme)
Le même procédé, la même technique narrative (que les anglophones appellent « point of view technique ») est utilisé de façon encore plus explicite ici : » Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés ! » Accès direct et « en direct live » à la pensée de Tchen. On pourrait parler ici de discours direct libre…
Comme on va le voir, le choix de cette technique narrative dès le début du roman ne doit rien au hasard.
2. Le personnage seul au monde dans le récit/Le lecteur seul au monde devant lui
On a vu que par le biais de cette technique narrative de la focalisation interne, le lecteur suit les pensées verbalisées du personnage Tchen. Mais ça n’est pas tout :
il accède également en direct à ce que Tchen voit (le rectangle de lumière, l’image saisissante du pied de la future victime), entend (les klaxons), ressent tactilement (rasoir/couteau dans les poches) et psychologiquement (tension, angoisse).
Pour le lecteur qui lit ce début de roman, toutes les informations viennent du personnage de Tchen. C’est à travers Tchen et à travers lui seul que le lecteur lit la scène, vit la scène.
On comprend que Malraux a voulu mettre en place toute une série d’oppositions relativement basiques (silence vs bruit, ombre vs lumière, intérieur vs extérieur, sommeil vs tension…), mais son choix narratologique initial et décisif de la focalisation interne aboutit au résultat que ces sensations de confinement, d’enfermement, et au bout du compte de solitude, c’est le lecteur qui les éprouve, c’est le lecteur qui vit la même « tempête sous un crâne » que Tchen. Et sa lecture de la suite du texte en sera nécessairement imprégnée, pour peu que l’écrivain ait du talent…(c’est le cas de Malraux ici).
Je veux ici être parfaitement clair : cette scène initiale, il y avait d’autres techniques narratives possibles pour la présenter au lecteur : par exemple déléguer tout pouvoir à un narrateur omniscient qui aurait d’emblée tout expliqué du pourquoi de cet assassinat, du moment, du lieu, des protagonistes etc. Ça aurait évidemment donné un résultat très différent, correspondant à des objectifs narratifs différents. Malraux a bel et bien fait un choix entre plusieurs techniques possibles. Et il a choisi la technique narrative qui met le mieux en valeur son propos : l’enfermement de l’homme seul face à une décision et un acte qui vont bouleverser son monde.
La narratologie a le mérite de mettre en lumière la nature et la fonction de ces choix : sur un plateau de cinéma ou de théâtre, on voit en quoi consiste le travail du metteur en scène qu’on appelle « la direction d’acteur ». Eh bien la narratologie nous fait voir en quoi consiste le travail de « direction de lecteur » accompli par l’écrivain. La narratologie expose et démonte les rouages de la mécanique narrative, cette mécanique narrative étant un aspect parmi d’autres – mais un aspect ô combien important – de l’écriture, du fait littéraire.
Dans ce texte de Malraux, on a vu que le choix narratif fondamental était celui de la focalisation.
Mais la narratologie s’intéresse également à d’autres types de choix stratégiques, liés à la structure générale du récit. Par exemple un récit peut-être présenté par enchaînement (les contes de fée pour enfants), par enchâssement (Les Mille et Une Nuits, les récits racontés par Scheherazade enchâssés au sein du récit de son histoire à elle), par alternance (Les Liaisons Dangereuses en sont un bel exemple)…avec des combinatoires possibles…Là encore, il s’agit de choix qui ne doivent rien au hasard, chacun de ces types de récit permettant à l’auteur une « direction de lecteur » (manipulation bienveillante pour lui donner du plaisir à la lecture) à chaque fois différente.
Je m’en tiens là pour aujourd’hui, de crainte de lasser.
Je suis prêt à entendre toutes les critiques, contestations, remarques ou questions.
PS 1: l’arrivée du cinéma au XXeme siècle en tant que support de récit a eu un impact important sur l’évolution des études narratologiques. Songez par exemple à Eisenstein qui faisait du montage l’essence même de son art du récit, ou Abel Gance qui mettait sur l’écran en simultané plusieurs points de vue de la même scène…
PS 2 : ce que Malraux a magistralement réussi dans son début de roman, on le retrouve aujourd’hui dans bon nombre de « blockbusters » du genre Mission Impossible, James Bond, Jason Bourne etc., où le spectateur est immergé dès les premières minutes dans une scène à couper le souffle où le réalisateur joue avec les focalisations. A Hollywood, on sait ce qu’est la narratologie, de toute évidence. Et on la prend très au sérieux.
Et je suppose que ces notions, ou concepts, seront à très court terme maîtrisés par l’IA qui pourra donc écrire un roman « idéal ». Il reste « l’histoire », sera-t-elle le propre de l’homme-auteur ?
Comment s’y prenait-on pour penser avant que Boole n’écrive « Les lois de la pensée »?
Quelle différence entre les romanciers qui maîtrisent la narratologie et ceux qui l’ignorent ?
Quid des romanciers des temps anciens, obscurs, temps d’avant Genette,d’avant les narratologues ?
La littérature a-t-elle besoin de la narratologie pour être de la littérature ?
La narratologie expose – et en partie seulement – la façon dont la littérature agit sur le lecteur à partir des choix effectués par l’écrivain. Rien de plus. Mais c’est déjà beaucoup.
Très juste. J’ai un excellent collègue et ami qui écrit actuellement un roman par IA.
L’IA maîtrise déjà les fondamentaux de la narratologie, c’est fascinant à voir à l’œuvre.
Mais comme vous le dites, en amont du récit comme discours, il y a le récit comme histoire. Eh bien figurez-vous que l’A est également très performante dans ce domaine : rien qu’avec les données du travail de Propp sur la morphologie du conte, elle est capable de vous ficeler une histoire qui tient debout…!
Mais le « roman idéal », bien sûr, n’existe pas. Et l’IA n’aura jamais ce qui rend les grands romanciers uniques en leur genre : une vision du monde, une idéologie, une conception de l’homme dans le monde etc., et une utilisation particulière du langage qu’on appelle le style.
(Mais l’IA peut déjà pasticher ou parodier.)
Mon post de 14h27 est une réponse à Hcc1.
Merci JG, je vais lire attentivement et je poserai sans doute des questions.
Dugong (9h16) – (avant le déluge ci-dessus, « chose promise »… : ne pas confondre avec Terre promise.)
M6, c’est lui l’chef : le seul à disposer du droit (divin) de porter cette chasub’ avec capuche.
« C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien… » comme disait karl L. !
Peut-être, mais M6 est ainsi assuré de gagner le paradis des élus,
loin de celui des fanfreluches où Karl L. a eu le malheur de retrouver YSL et sa suite.
Dans un style plus occidental (mais old fashioned) , costume 3 pièces et épingle de cravate pour le fils, pochette blanche pour les deux.
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2025/08/24/au-maroc-une-atmosphere-de-fin-de-regne-pour-mohammed-vi_6634562_3451060.html
Rappel
Ni oubli ni pardon est un petit groupe d’individus qui retrouve dans les archives des déclarations de personnes ayant,pendant la plandémie, collaboré avec la macronasserie.
Ils ont nourri la propagande ,secondé le pouvoir dans sa tentative d’imposer une expérimentaion bio-chimique à un maximum de cobayes humains.
Les gens du show biz et du spectacle ont agi ainsi par cupidité:se rallier à la macronasserie était la condition mise par le pouvoir à la réouverture des salles etdonc à la possibilité de faire de la thune;
La bêtise a été,pour beaucoup, un facteurauxiliaire; l’absence de principes est un trait qu’ils partagent tous.
Bref, ce sont des ordures et il convient de ne pas les oublier.
Devoir de mémoire.
« Je n’ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m’opposer à l’énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. »
SOLJENITSYNE
Mémoire et censure
La macronasserie s’y prend encore maladroitement. Quand une vidéo qui était diffusée par un site officiel (genre une préfecture de Région) est devenue gênante, elle la retire.
Mais il arrive(plus souvent que pas) que des gens avisés l’aient archivée de longue date et la balancent sur les réseaux sociaux, avec quelques explications.
Cela donne à cette vidéo une énorme publicité.
C’est ce qui vient de se passer avec une petite vidéo où une conservatrice du musée de Bayeux détaillait la fragilité de la tapisserie et expliquait pourquoi un voyage l’endommagerait gravement ,risquait de la détruire .
C’est Didier Rykner, de la Tribune des Arts qui a exhumé la vidéo, lancé une pétition,parlé à la presse anglaise.
Macron (qui devrait être interné d’office) ne renonce pas à son plan dément d’envoyer la tapisserie en Angleterre, c’est pourquoi la Préfecture du Calvados a retiré de son site l’entretien avec la conservatrice.
Les Anglais sont notre ultime espoir;s’ils comprennent que le voyage va abîmer la tapisserie,ils s’adresseront au roi et le roi demandera que la tapisserie reste en France;
Le mieux est que cette tapisserie fasse tapisserie
Le patronyme Bayeux existe. Ce sont des gens qu’on entend peu.
Comment les crapules vont-elles fêter cette année l’anniversaire du 7 ocobre ?
Je ne sais pas si vous avez lu JG du 30 août 2025 à 0h11.
Honorer sa femme , c’est l’inviter à Dîner, pas à Piner.
Lormier a encore fait un contresens, un de plus.
Je crois que vous aussi…Ils sont allés dîner puis sont rentrés etc…Revoyez un peu tous les élements (pas leur fiction); les étreintes,loin de fatiguer JP, le régénèrent.
Comment se fait-il qu’au cours de la conversation sur le chemin du retour, il ait été question de Bonnet d’Ane (dont ils ne parlent que rarement) ? Mystère et boule de gomme. En tout cas ,Josip Gavrilovic a tenu à en rendre compte .
C’est ainsi que nous avons appris que,pour Madame Gavrilovic, le Maestro est un simple « agrégé de Lettres ».
Je ne me suis que trop appesanti;il s’agit de la vie privée du scripteur. Il s’offusque que l’on commente la vie privée de Tousseau,telle que racontée dans les Confessions; Alors…
Lormier 28 août 2025 à 9h47
Zut! Moi qui croyais qu’on allait être tranquille quelques heues…que vous alliez devoir vous reposer de vos efforts de la nuit passée.
JGJG 28 août 2025 à 9h53
Les efforts auxquels vous faites allusion ont sur moi un effet régénérant.
Dommage pour vous, je pète la forme !
Coucou, la revoilou !
Demain on board la Global Sumud Flotilla,
avec même du beau monde attendu – les boomers, comme moi, se rappelle la guérillera Fonda au nord-vietnaaaaaaaaam –
https://pictures.laprovence.com/cdn-cgi/image/width=800,format=auto,quality=80/media/melody/2025/08/11/greta-thunberg-sur-le-bateau-a-destination-de-gaza-1754903105_b2dfc4a6ff386b6dfc4a6ff388adfcv_.jpg
Pas de soutif, pas de culotte au mat chinois ?
Elle va exploser sa capsule de garantie !
Photo un peu floue, mais Beata (mona lisa), sa sœur, n’est clairement pas du même tonneau…
https://freelanceinfos.fr/wp-content/uploads/2025/06/Chant-Beata-Thunberg-1140×570.jpg
… heureusement qu’elle ne fait pas partie de la Global Sumud Flotilla !
https://pbs.twimg.com/media/DG3UaVvXcAARxRD.jpg
JG 27 août 2025 à 21h07
Je répondrai peut-être à ça à mon retour de l’île de Pag.
Pour l’instant, je me prépare à honorer au mieux ma douce et tendre épouse, après une exploration très fructueuse de la gastronomie croate.
Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça.
Je crois qu’elle m’aime.
A plus !
=========================================================
L’auteur des lignes ci-dessus ,qui les a « pensées » d’une certaine façon, estime que les propos sur « le simple » agrégé ne sont attribuables qu’à la tendre et douce épouse;
C’est faux.
De toute façon,même si on les attribue à ce locuteur, demeure une question essentielle: dans quelle intention l’auteur rapporte-t-il ce passage de la conversation,alors que nous savons par ailleurs que Bonnet d’Ane n’est que très rarement un sujet de conversation pour ce couple ?
Elle me considère au dessus de tout ça.
Je crois qu’elle m’aime.
Quand on voit un être avec les yeux de l’amour, on le surestime, parfois.
WTH 30 août 2025 à 14h38
Coucou, la revoilou !
Demain on board la Global Sumud Flotilla…
Le 7 octobre ,au Quatar, chez Ghazi Hamdane ?
Avant octobre, un possible mois de septembre regorgeant d’aventures rocambolesques ?
l’Ol. Faure ayant en effet déclaré :
« Le président peut choisir parmi nous. »
Attention, danger! Tout peut arriver au 55 du fbg St Ho’ !
voire même, à la demande, une séance spéciale dans la room of La Pompadour !
De plus en plus rocambolesque (😁) :
L’Ed’ Philippe du Havre « alerte » à son tour et parle lui aussi de « noeud coulant. »
Le maire socialeux Karim B. ajoute : « pour l’après-Bayrou, le bloc de gauche, hors LFI, doit nouer un accord de non-censure avec le socle commun. »
Allez ! Tous dans la room de La Pompadour ! Et que ça saute !
» Dansons la Carmagnole
Vive le son (bis),
Dansons la Carmagnole !
Vive le son
Du canon ! «
« Le mieux est que cette tapisserie fasse tapisserie » (Dugong)
« Le patronyme Bayeux existe. Ce sont des gens qu’on entend peu. » (Lormier)
Bayer aux corneilles ou faire tapisserie ?
Que nenni ! « Dansons la Carmagnole… »
S’il est viré, Sylvie est guérie.
Rappel:
« Sylvie avait commencé à contrepéter après les résultats de la première élection de l’actuel Président, alors qu’elle n’avait pas réussi à voter au second tour, pour la première fois de sa vie, il y a donc maintenant bientôt sept ans.
Elle contrepétait non seulement quand elle s’adressait à Paul mais aussi lors de ses échanges avec ses enfants et son entourage en général. Paul lui fit comprendre plusieurs fois que c’était devenu très lassant. Et Sylvie lui expliqua qu’elle en avait parfaitement conscience, mais que c’était plus fort qu’elle, c’était une sorte de maladie mentale. Elle lui confia qu’elle avait même consulté, en catimini, deux psychiatres, qui avaient établi le même diagnostic : Il n’y a rien à faire, son état reviendra très probablement progressivement à la normale lorsqu’on changera de Président. »
Extrait du chapitre VII :
https://fictionpauletvanessa.blogspot.com/2024/05/chapitre-vii-confidences-saint-malo.html
Corrélation n’est pas causalité.
Mais quand c’est trop tentant, faut pas vous gêner (dans l’esprit « print the legend »).
Global Sumud Flotilla
Sumud ?
Wiki.
» Le sumud est la persévérance des Palestiniens à rester sur leurs terres et à résister à la colonisation israélienne[1]. Ce terme est apparu dans les années 1970 pour désigner une manière de porter politiquement la cause palestinienne dans la vie quotidienne[2]. Le sumud est pratiqué en maintenant une présence continue (wujud) face à ce qui est vécu comme une catastrophe permanente (nakba)[3]. C’est une valeur qui a particulièrement trouvé écho parmi les médecins et soignants palestiniens[4]. Pour Lara et Stephen Sheehi, le sumud est une culture du soin mutuel par laquelle les Palestiniens se préoccupent que les besoins de leurs proches soient comblés[5]. Il y a plusieurs façons de faire, qui vont des tâches ménagères aux festivités en passant par l’organisation politique, et qui revêtent une importance particulière pour les femmes palestiniennes engagées dans la lutte[6]. Dans la diaspora, la valeur sumud est perçue par de nombreuses personnes comme fondamentale pour la continuation de leur lien avec la terre palestinienne et leur peuple[7]. »
C’est très édifiant.
Comment une banalité peut accéder au rang de » valeur » proposée a l’admiration des belles âmes, avec la connotation de convergence des luttes ( la notion serait en particulier propre aux femmes palestiniennes).
Exemple de sumud: les youyous le 7 octobre ?
Abdullah Al-Amadi , journaliste qatari
https://www.memri.org/sites/default/files/2025/08/sd12141.jpg
Nous n’avons pas du tout la même vision de l’histoire que les pro-palestiniens du Moyen Orient.
Pour Abdullah Al-Amadi, journaliste qatari, la bataille pour Gaza est une répétition d’une bataille contre les Mongols au 13ème siècle;c’est une étape dans la guerre pour rétablir je ne sais quel empire mahométan. Bien sûr la disparition d’Tsraël, l’extermination des Juifs sont nécessaires et donc au programme.
Nous remontons au 19ème, eux au Moyen Age.
En tout cas les journalistes mahométans sont très engagés. Ceux qui couvrent Gaza font du journalisme le matin et du terrorisme l’après-midi (ou vice versa).
« What is currently happening in Gaza is not strange to the history of our nation, which has seen disasters and massacres against various Islamic cities in the past, greater and more criminal than the present events in Gaza… Whoever reads about the savage Mongols’ disastrous invasion of Baghdad, the capital of the Islamic caliphate, in the Hijri year of 656 [1258 CE], and historians’ accounts of the horrific sights that went on for forty days and nights as the Mongols sowed unprecedented ruin and destruction, is shocked to the core… A barbaric state emerged from remote northern China and spread outward, disseminating a culture of death, destruction and devastation and stubbornly opposing [all] construction, productivity and life…
…
« The Zionist barbarity and tyranny are no different from those of the Mongols at the time. The crushing of Gaza means that the Zionists’ tyrannical campaign against the Arab and Islamic world will continue, unless there is a new [Battle of] Ayn Jalut.[3] I believe Gaza is now retracing the path of Qutuz[4] and the Mamluk believers against the evil infidel Mongols, and is declaring to the world – despite all the pressure it is facing from the forces of the West and the East – that there are noble, lofty and exalted souls [in Gaza] who refuse to be humiliated, who understand the language and the mentality of the enemy, who hold the [key] junctions of the [Gaza] Strip and who will not be deceived by the cheating evil politicians in the West and the East.
Mais putain de merde, qu’est-ce que vous voulez dire à des mecs comme ça ,
D’ailleurs,ils ne veulent pas discuter avec vous,car ils pensent que ça ne mène à rien.
Leur méthode ? Les attentats et les pogroms.
Les pauvres connards occidentaux qui se mettent des serpillères sur la tête et hurlent
« from the river to the sea » n’y comprennent évidemment rien.
Les crapules qui soutiennent le mouvement comprennent-elles mieux ?
https://www.memri.org/reports/qatari-journalist-victory-jihad-fighters-gaza-will-spell-end-zionist-era
« Mais putain de merde, qu’est-ce que vous voulez dire à des mecs comme ça »
Ne leur dites rien, vous ajouteriez du malheur au monde qu’est déjà assez un cloaque comme ça…
J’avais oublié de poster le titre de l’article
Abdullah Al-Amadi , journaliste qatari: The Victory Of The Jihad Fighters In Gaza Will Spell The End Of The Zionist Era
August 26, 2025
Voilà, la bataille de Gaza fait partie du djihad. Si vous êtes pro-palestinien, vous êtes pro-jihad;
et au Canada une crapule (Charlotte Kate) harangue des connasses à serpillière;son éloge du 7 octobre va la conduire devant un tribunal.
https://globalnews.ca/news/11342663/dallas-brodie-charlotte-kates-private-prosecution/
« Ce ne sont pas des serpillières, ce sont les plans du futurs parking. Y’en aura pas pour tout le monde !
On peut acheter sur plan avec un léger (a)rabè. Pas la peine de discutailler les tarifs, faut bien que les irresponsables du hamasse se gobergent à Dubuy…
ECHO 30 août 2025 à 21h33
Global Sumud Flotilla
Sumud ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il semble que ce soit lié aux prisonniers en Israël. Le mouvement samidoun le met à l’honneur.
(Samidoun: se présente comme une organistion caritative d’aide aux prisonniers des geôles israéleinnes;a des liens avec des organisations terroristes;est classé comme terroriste par certains états ,les EU par exemple.)
https://samidoun.net/fr/2022/01/sumud-un-livre-sur-la-resistance-des-prisonniers-palestiniens/
« Je m’en tiens là pour aujourd’hui, de crainte de lasser. »
Tellement drôle de voir l’Oustachiant suer son urine coincé dans sa statue comme dans un pâté en croûte.
Ce qui me fait de la peine, ici, ce n’est pas ce développement de cour de récré, mais le temps qu’il a du te falloir pour le rédiger.
Dans le même temps tu aurais pu regarder un bon Haneke, écouter l’intégrale des symphonies de Chosta, dîner aux chandelles avec ton amoureuse, observer un chat.
Tranche de vie gâchée.
« un bon » Haneke
Sans dek ?
On dit Chostako
Enfin, un sujet édifiant au Vespéral :
https://www.lemonde.fr/videos/video/2025/08/27/pourquoi-les-pick-up-toyota-sont-ils-utilises-dans-tous-les-conflits_6636463_1669088.html
Dugong 31 août 2025 à 8h25
Enfin, un sujet édifiant au Vespéral :
Parce que ce sont les meilleurs véhicules 4×4 du monde, avec les UNIMOG mais c’est une autre catégorie. Les BJ, et dans une moindre mesure les HiLux, sont solides, fiables, rustiques, faciles à réparer, on trouve des pièces de rechange partout et l’immensité du parc civil permet le cannibalismre, et en version 2 ponts ils passent partout. Avec un peu d’accessoires ils deviennent les couteaux suisses des guérillas tropicales.
Mais surtout Toyota en dépit d’être un champion du RSE, de la compliance, d’un code de conduite des affaires dignes du Talion, est très peu regardant sur le devenir de ses véhicules vendus dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite ou UEA.
Samidoun
Samidoun (Arabic: صامدون, romanized: Ṣāmidūn, lit. ’steadfast’—see sumud for the cultural context of this term), officially Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, is a pro-Palestinian advocacy group based in Canada. Since the October 7 attacks and ensuing Gaza war, Samidoun has organized Palestinian solidarity protests in the United States and Canada.
Wiki.
Considéré comme groupe d’appui au terrorisme dans plusieurs pays dont récemment la Belgique.
Veritable logorrhée dans le style habituel à l’EG par laquelle le mouvement Samidoun Belgique proteste contre l’intention du » gouvernement fasciste belge » d’interdire le mouvement, et lie sa cause a la répression d’autres mouvements » populaires » comme les écologistes radicaux ( convergence des luttes encore)
https://samidoun.net/fr/2025/08/samidoun-belgique-de-la-repression-des-mouvements-populaires/
Situation de M. Georges Ibrahim Abdallah (17 juillet 2025)
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères prend acte de la décision rendue le 17 juillet 2025 par la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Paris, concernant la demande de libération conditionnelle de M. Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat, et emprisonné à ce titre depuis 1984.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/situation-de-m-georges-ibrahim-abdallah-17-07-25
On peut désormais interroger ce spécialiste sur la situation à Gaza. Comme il a eu tout loisir d’étudier la narratologie au cours de ses 41 années de détention,la conversation nous permettra aussi de bien comprendre le récit qui nous est offert par les porteurs de serpillères.
En tant que narratologue,il est aussi compétent que Josip Crapulovic;en tant que terroriste,c’est l’infini comparé au zéro.
Le Jojo il est sérieusement atteint! Je ne sais pas si c’est à cause de ses 40 années de placard ou s’il souffre d’une affection psychiatrique mais son discours est complètement dingue. Et il e trouve des individus comme le croasse qui pensent que l’on pourrait aboutir à une solution à deux états avec des frappadingues de ce calibre.
La seule solution pour avoir la paix c’est de les buter.
Voilà l’opinion du spécialiste ès cause palestinienne et terrorisme George Ibrahim Abdallah sur la connasse Montagne de thune
personne n’a manifesté. Où sont-ils à part la jeune Greta, qui a fait tout le trajet de Suède pour tendre un verre d’eau en solidarité avec Gaza ? Où sont-ils à part Rima Hassan, qui est venue de Belgique et a tendu un verre de lait en solidarité avec Gaza ?
Où sont les marins de l’Égypte ? Ces activistes sont venus à bord d’un bateau pas même équipé pour transporter du poisson et les marins de l’Égypte les regardaient comme des « singes ». Où est la révolution palestinienne dans tout cela ? La trahison est dans le peuple arabe tout entier ; une manifestation au Yémen ou dans d’autres villes arabes ne suffit pas. Où est la Jordanie ? Où sont les masses de la Jordanie ? Où sont les 60 % de la population d’Amman qui sont à l’origine des Palestiniens ? Certes, tout ceci s’inscrit dans la crise du projet national, parce que ces forces sont responsables de l’action nationale. Soit l’action nationale palestinienne s’emploie à dresser la Palestine en tant que levier révolutionnaire de toute la nation arabe, soit elle s’emploie à protéger ces régimes.
https://www.chroniquepalestine.com/un-entretien-avec-georges-ibrahim-abdallah-pas-de-paradis-sans-gaza/
Les pro-palestiniens européens,qu’ils soient narratologues ou non, se demandent où ils vont fêter l’anniversaire du 7 octobre.
Beyrouth ? Doha ?
Dugong 31 août 2025 à 8h25
Enfin, un sujet édifiant au Vespéral :
Un sujet dont Dugong nous a souvent parlé:Toyota bien supérieur à Land rover, tout le temps en panne;
Le pick-up Toyota très commode pour ramasser (pick up) des grosses putes africaines et aller partouzer dans la nature.
Je vois des gens transporter leur VTT ae dans ces pick up;y a pas la longueur nécessaire. Alors ils mettent un gros boudin en caoutcouc sur le rebord , mettent le vélo à « califourchon dessus, la roue avant dépassant à l’extérieur.
Lormier est dubitatif:si quelqu’un vous empapaoute,y a plus de vélo.
Pour transporter un VTT ae, une seule solution:la fourgonnette équipée pour.
aménagement d’une fourgonnette:
https://jaimelesvelos.fr/wp-content/uploads/2023/07/amenagement-tidy-sur-mesure-scaled.jpg
Allez installer une 12.7 opérationnelle et 5 ou 6 gonziers équipés dans une fourgonnette tôlée
Faites 50 bornes de piste constellée de nids de poule (maousses les poules) et d’ornières de ruissellement…
Lormier
30 août 2025 à 22h35
Si vous êtes pro-palestinien, vous êtes pro-jihad.
Admirable raccourci.
Admirable sécurité péremptoire du néant.
Pour ma part je suis pro-justice et pro-paix : deux tics.(pcc Dugong)
Longtemps, je me suis fait traiter de linguistre pontifiant.
Ces derniers temps, je me fais traiter de crapule narratologue.
Que me réservent les temps futurs ? Si la tendance se confirme, à l’entrée de la dernière ligne extrême-droite, qui est sur ce blog le champion de l’anti-intellectualisme poujadiste qui tient la corde, pour me pendre ?
Des hyènes dactylographes aux crapules narratologues, que de chemin parcouru !
Je m’ennuyais un peu et j’avais du temps libre ces derniers jours, alors je me suis amusé à lister quelques-uns des mensonges prorusses répétés à l’envi par les nombreux égarés qui sévissent sur ce blog, puis la façon dont ils sont démentis par les faits et les tentatives de rationalisation (au sens freudien) utilisés par lesdits égarés pour essayer de faire tenir debout le fragile édifice qui leur permet de donner un sens à leur vision du monde. Spéciale dédicace à Gégé.
1. Propagande prorusse : « C’est l’OTAN/les USA qui a/ont déclenché la guerre »
• Fait : L’invasion de l’Ukraine commence le 24 février 2022 par une attaque russe sur plusieurs fronts, avec troupes et blindés traversant la frontière. Ou en
• Rationalisation : « Oui mais l’OTAN a provoqué la Russie », « Les Américains veulent une guerre par procuration » : la Russie est présentée comme “réactive” alors qu’elle a initié l’agression.
2. Propagande prorusse : « Les Russes ne visent que des objectifs militaires »
• Fait : Les bombardements massifs sur Kyiv, Marioupol, Kharkiv et autres villes touchent hôpitaux, théâtres, immeubles résidentiels (photos satellites, vidéos, rapport ONU).
• Rationalisation : « C’est l’armée ukrainienne qui se cache dans les immeubles civils » ou « Les frappes sont des accidents ». Pourtant la répétition systématique prouve l’intention.
3. Propagande prorusse : « Le massacre de Boutcha est une mise en scène »
• Fait : Images satellites de Maxar montrent les cadavres dans les rues avant le retrait russe. Témoignages locaux corroborent.
• Rationalisation : « Ce sont des acteurs », « On doit attendre l’enquête », « Les Ukrainiens ont placé les corps après ». Ce déni persiste malgré preuves irréfutables.
4. Propagande prorusse : « La Russie protège les russophones du Donbass d’un génocide »
• Fait : L’ONU et l’OSCE n’ont trouvé aucune trace de génocide en Ukraine. Les victimes civiles dans le Donbass avant 2022 étaient liées au conflit, mais pas à une politique d’extermination.
• Rationalisation : « L’ONU est sous contrôle occidental » — donc tout organisme international devient suspect si ses conclusions contredisent Moscou.
5. Propagande prorusse : « L’Ukraine voulait attaquer la Russie »
• Fait : Les forces ukrainiennes étaient massées à l’intérieur de leurs frontières, sans aucune préparation logistique d’offensive majeure.
• Rationalisation : « Ils allaient attaquer demain » — affirmation invérifiable, qui justifie une attaque “préventive”.
6. Propagande prorusse : « La Russie est militairement invincible »
• Fait : L’armée russe a échoué à prendre Kyiv, perdu des dizaines de milliers de soldats, et abandonné Kharkiv et Kherson.
• Rationalisation : « C’était un repli stratégique », « La Russie ne voulait pas vraiment prendre Kyiv », ce qui contredit le discours initial de « conquête éclair ».
7. Propagande prorusse : « Les sanctions occidentales ne font que nuire à l’Europe »
• Fait : L’économie russe s’effondre (fuite des entreprises, industrie automobile paralysée, budget militaire aspirant toutes les ressources). L’UE a résisté au chantage au gaz avec stocks remplis à >95%.
• Rationalisation : « Les Russes s’adaptent, ils vivent mieux qu’avant », alors que Moscou doit brader son pétrole à la Chine/Inde et couper dans les budgets civils.
8. Propagande prorusse : « L’UE et les USA vont se lasser et lâcher l’Ukraine »
• Fait : Malgré tensions politiques, les aides militaires et financières se poursuivent depuis plus de 3 ans, et l’Ukraine est candidate officielle à l’adhésion à l’UE.
• Rationalisation : « Oui mais la prochaine fois ce sera la fin », chaque année la prophétie est repoussée.
9. Propagande prorusse : « Les Européens n’ont pas d’autonomie, ils obéissent aux USA »
• Fait : Quand Zelensky a rencontré Trump, plusieurs chefs d’État européens ont choisi d’accompagner Zelensky pour ne pas le laisser seul face à Trump.
• Rationalisation : « Trump les a convoqués » : inversion totale de l’initiative.
10. Propagande prorusse : « La Russie ne cible pas les infrastructures civiles vitales »
• Fait : Campagnes systématiques de frappes sur centrales électriques, réseaux d’eau, chauffage urbain en hiver 2022–2023.
• Rationalisation : « Ce sont des cibles militaires car elles alimentent l’armée » : tout devient “militaire” et la définition perd tout sens.
11. Propagande prorusse: « L’Ukraine est un État nazi »
• Fait : Le président Zelensky est juif, sa famille a été victime de la Shoah ; l’extrême-droite ukrainienne pèse moins électoralement que dans plusieurs pays européens.
• Rationalisation : « Être juif n’empêche pas d’être nazi » : contorsion logique qui neutralise toute contradiction.
12. Propagande prorusse : « La Russie voulait juste empêcher l’OTAN de s’élargir »
• Fait : Depuis l’invasion, la Finlande et la Suède ont rejoint l’OTAN — exactement le contraire de l’objectif proclamé.
• Rationalisation : « Peu importe, la Russie s’y attendait », « Ça ne change rien » : déni pur et simple de la conséquence directe.
BONUS : Trump mettra fin à la guerre rapidement / en 24h. « Le Donbass deviendra russe. Et ça s’arrêtera là. »
• Faits :
o Trump a humilié Zelensky publiquement lors de leur rencontre dans le bureau ovale et s’est montré extrêmement complaisant envers Poutine à Anchorage. Les USA ont essayé de contraindre l’Ukraine à céder ses territoires. Or l’Ukraine est un Etat souverain. Si les Ukrainiens ne veulent pas céder, Trump ne peut pas y faire grand-chose.
o La guerre dure depuis plus de trois ans sans aucun signe d’apaisement. La Russie continue ses offensives, y compris en bombardant des civils. Le mois d’août a été le théâtre des bombardements parmi les plus meurtriers depuis le début de la guerre, avant, pendant et après la rencontre entre Trump et Poutine.
o Les décisions militaires et diplomatiques russes restent indépendantes des gesticulations de Trump.
o
• Rationalisation :
o « Zelensky refuse de céder des territoires, donc il est responsable de la prolongation de la guerre »
o Cette logique ignore que céder des territoires ne stoppe en rien l’agression russe, et que Trump ne peut imposer la paix.
o Les prorusses inversent causes et effets : ils blâment l’Ukraine tout en idéalisant un acteur incapable, pour justifier leur vision.
• Atermoiements successifs de Trump :
o Mars 2023 : « Je peux résoudre cela en 24 heures »
o Mai 2023 : « Je vais le faire en 24 heures »
o Août 2024 : « Avant même d’arriver à la Maison-Blanche, je vais régler cette guerre »
o Décembre 2024 : « Je vais essayer »
o Janvier 2025 : Son envoyé spécial propose une échéance de 100 jours
o Juillet 2025 : Nouvelle échéance de 10 à 12 jours
o Août 2025 : Rencontre avec Poutine en Alaska sans aucun résultat concret
(C’est si beau le mythe de l’homme fort. Le problème, c’est qu’il n’est pas si fort que ça.)
J’avais aussi bien aimé la prophétie de Cyrano qui en mars de cette année nous annonçait que Zelensky ne finirait pas le mois. Zelensky est toujours là. Pas Cyrano. C’est vraiment dommage.
Bon dimanche, tout le monde.
Mendax, votre catalogue/relevé d’informations est implacable.
Dans les « rationalisations », vous oubliez la spéciale WTH : « Oui mais Mendax s’appuie exclusivement sur des faits rapportés par des merdias mainstream ou gauchistes, alors oh hé hein bon. »
Je ne crois pas que les médias gauchistes soient particulièrement pro ukrainiens, simple remarque.
Et vous pensez que WTH s’arrête à ce genre de détails…? 🙂
Qu’est ce qu’être pro- palestinien ?
Si c’est être en faveur d’un Etat palestinien, c’est une chose. Une option diplomatique.
Si c’est admirer la » résistance » du peuple palestinien, avant garde de la révolution mondiale, liée à toutes les » luttes populaires » ( celles qui représentent 10 % des opinions!) , parler des » martyrs », mettre sur le même plan les otages capturés le 7 octobre avec les détenus palestiniens en Israël, baptiser résistants des criminels sadiques, , c’est tout autre chose.
La plupart ( je dis la plupart) des pro palestiniens qui manifestent, sont dans la deuxième catégorie comme Charlotte Kates
https://ici.radio-canada.ca/rci/fr/nouvelle/2186980/hamas-samidoun-kates-israel-poursuite
Voilà, exactement.
Ghazi Hamad, dignitaire du Hamas a un avis très clair sur les Occidentaux à serpillère: ils sont l’un des fruits du 7 octobre et c’est une très bonne chose qu’ils soient là;ils aident le djihad.
(Peu semble importer à ce grand stratège que parmi les mecs et meufs à serpillère il y ait surtout des connards et connasses qui ne comprennent rien à rien…il ne s’embête pas à distinguer entre connards absolus, connards relatifs et narratologues. Un climat s’est créé en Occident, grâce à tout ce monde, climat propice aux attentats, climat propice au développement de l’anti-israélisme chez les politiciens. Pour être élu, il peut être bon d’adopter une posture anti-sioniste.
L’autre fruit du 7 octobre selon notre stratège du Hamas, c’est Macron et tutti quanti:responsables politiques favorables à la reconnaissance d’un Etat palestinien.
lire et écouter
https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel
Mendax 31 août 2025 à 10h43
Je m’ennuyais un peu et j’avais du temps libre ces derniers jours, alors je me suis amusé à lister quelques-uns des mensonges prorusses répétés à l’envi par les nombreux égarés qui sévissent sur ce blog…
Merci pour ce catalogue; en effet on peut lire ici ou là de tels arguments.
Cependant, je ne les ai pas vus « répétés à l’envi » par le commentariat d’ici; vous donnez deux noms…sans citer leurs propos.
Remonter dans les archives pour trouver tous les propos que vous répertoriez serait fastidieux. Et à mon avis, vous ne trouveriez pas grand chose.
M’est avis que vous avez moissonné en bien des lieux et pas seulement ici.
JG 31 août 2025 à 11h22
Mendax, votre catalogue/relevé d’informations est implacable.
« implacable » à ceci près qu’il ne relie pas les « items » à des commentateurs identifiables.
De mon temps, on argumentait avec des citations d’auteurs.
Il y a au moins une citation (paraphrase) du taulier. Cherchez, je suis sûr que vous la trouverez. La déclaration de Cyrano est authentique également. Les jubilations idiotes sur Trump qui aurait convoqué les chefs d’états européens est récente et c’est une paraphrase d’un post de la rombière, repris peu de temps après par le facho autoproclamé. Le reste a été abondamment ressassé par Gégé/Flo au fil des mois – et encore, j’ai laissé de côté les trucs les plus délirants tels que les labos de moustiques génétiquement modifiés. L’argument sur l’invincibilité de la russie, c’est vous-même qui le ressortez régulièrement, sous une forme un tout petit peu plus sophistiquée : la population russe est plus nombreuse que la population ukrainienne, donc la russie va forcément gagner (argument déjà avancé par Cyrano au tout début du conflit et repris par le taulier sous la forme : « la russie a vaincu l’Allemagne nazie, alors l’Ukraine… »)
JG 31 août 2025 à 10h13
Longtemps, je me suis fait traiter de linguistre pontifiant.
C’est pas fini.
Lormier : « C’est pas fini. »
Je le sais bien : les ressources en psittacisme de l’anti-intellectualisme poujadiste sont hélas inépuisables.
Mais les micro-chiens ont beaucoup tenter d’aboyer….
https://share.google/QjB8XW9TRgOMzFbkR
…..la caravane de l’intelligence finit toujours par passer.
Comme la Wells Fargo.
*Les micro-chiens ont BEAU tenter d’aboyer…(et parfois beaucoup, aussi…)
PS : je rappelle que l’analyse culiolienne de « beau » dans l’énoncé ci-dessus invalide à elle seule la stupide affirmation de Lormier « La théorie des opérations énonciatives n’existe pas. »
Il est comme ça, Lormier : ce qu’il est incapable de comprendre, il en nie l’existence.
Que Lormier cherche donc dans sa bibliothèque, sur le Web, dans la British Museum Library, chez Jacqueline Pinchon, chez Vaugelas, chez Grevisse, dans la grammaire de Port-Royal, où il veut, une explication et une analyse intelligente de la présence de ce « beau » dans « les chiens ont beau aboyer… ». Je lui souhaite bon courage et beaucoup de patience.
Il aura BEAU chercher, il fera chou blanc.
En attendant qu’il commence ses recherches, qu’il fasse ce qu’il fait de mieux : se cacher les yeux avec les mains en croyant que fait disparaître le réel. Comme un gosse de 3 ans environ.
« se cacher les yeux avec les mains en croyant que ÇA fait disparaître le réel. »
NB « linguistre » est un mot-valise que nous devons à Dugong (orfèvre en matière de jeu sur les mots)
C’est l’amalgame des mots « linguiste » et « cuistre ». (Sa cuistrerie ne se manifeste pas uniquement quand il parle linguistique.)
Le langage standard le plus accessible paraîtra toujours cuistre aux yeux des experts-
commentateurs littéraires de Femme Actuelle ou de Télé-Poche.
Certains s’égarent parfois en ces lieux.
« femme actuelle » et « télé-poche » : ça existe encore ?
Lectures ordinaires (!) de la pouf’ à JG ?
Le M. (10h43) :
« Puppet on a string » : c’était une chansonnette d’une pouffette des années 60.
M. en est une, comme tant d’autres.
Un jour les meneurs du jeu tirent sur une ficelle,
le lendemain sur une autre.
L’essentiel étant que le spectacle continue,
… Et tout ce qui va avec : partages de territoires (enfin pas partout !), business-négociations, etc.
Rappels (quelques uns parmi d’autres) :
– sanctions ou pas, les Ricains ont continué d’importer l’uranium russe,
– BlackRock s’est totalement désinvesti de l’Ukr’ depuis février,
– Exxon Mobil de retour en Russie.
– le monde occidental ne s’intéresse pas (en particulier l’Europe de l’ouest), sinon pour les dénigrer, à ces forums … économiques,
lesquels intéressent pourtant une… grande partie de la planète, comme :
. l’OCS (« Sommet de l’OCS: la Chine reçoit Poutine et Modi » – la Presse, 31/08)
. le forum économique int’l de St Petersburg
. les BRICS…
Vastes territoires, très riches en matières premières et terres dites rares, au fort potentiel industriel Et humain…
ECHO 31 août 2025 à 11h27
Qu’est ce qu’être pro- palestinien ?
…
La plupart ( je dis la plupart) des pro palestiniens qui manifestent, sont dans la deuxième catégorie comme Charlotte Kates
=========================================================
Couple fusionnel:Charlotte Kates & Khaled Barakat
Charlotte Kates [Charlotte Lynne Kates] is affiliated with a designated foreign terrorist organization (FTO). Kates has shown support for terror groups and supported intifada violence. She has also spread hatred of Zionism and Israel.
In October 2022, Kates was banned from entering the European Union, along with her husband Khaled Barakat, who is a leader in the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) terror group. The couple were deported back to Canada.
https://canarymission.org/individual/Charlotte_Kates
Septembre,ce n’est pas encore la saison de la chute des feuilles (listopad en tchèque,opadanje lišća en croate) ,c’est la saison des listes.
Alors, Lormier vous offre une liste de responsables d’une organisation « humanitaire » ayant des liens étroits avec des organisations terroristes
Through uncovered photographic evidence, the report exposes the close relationship top UNRWA officials have with designated terrorist organizations. Current and former UNRWA officials with terrorist ties included in the report are:
UNRWA Commissioner-General Philippe Lazzarini (2019-present)
UNRWA Commissioner-General Pierre Krähenbühl (2014-2019)
UNRWA Director-General in Lebanon Dorothee Klaus (2023-present)
UNRWA Director-General in Lebanon Claudio Cordone (2017-2022)
UNRWA Deputy Director of Programs in Lebanon Gwyn Lewis (2015-2018)
UNRWA Director-General in Lebanon and Director of Operations in Gaza Matthias Schmale (2015-2021)
UNRWA Director-General in Lebanon Hakam Shahwan (2016-2017)
UNRWA Gaza Director Thomas White (2021-2024)
Acting UNRWA Director-General in Lebanon Munir Manna (2023)
UNRWA Director-General in Lebanon Anne Dismorr (2012–2015)
UNRWA Deputy Commissioner-General Leni Stenseth (2020–2023)
https://unwatch.org/the-unholy-alliance-unrwa-hamas-and-islamic-jihad/
NB Je crois qu’Anne Dismorr est narratologue,aussi.
Le JG (10h03) :
« Pour ma part je suis pro-justice et pro-paix »
Il n’y jamais (eu),
sur cette Planète,
ni Justice
ni Paix.
ça se saurait depuis le temps d’occupation de l’homo sapiens !
Les terroristes du Hamas ont construit un magnifique récit qui met en valeur leur héroïque noblesse .
Pour cela ils se sont attaché les services d’éminents narratologues;cela se voit tout de suite quand on examine leur récit comme discours.
quand on examine leur récit comme discours…. sans oublier l’histoire !
Et en particulier l’histoire de ses préfaces épurées .
Oui..
Je prends note avec le plus grand sérieux des liens et infos diverses que ECHO et Lormier nous communiquent sur le Hamas et ses soutiens. Je n’en suis pas étonné. Que les religions rendent cons est tout sauf une surprise pour moi.
Je demande à ECHO et à Lormier de prendre note des faits actuels : le Hamas et ses soutiens ont BEAU discourir (pour BEAU, voir plus haut) pour prôner la destruction d’Israël, aujourd’hui la destruction méthodiquement organisée et mise en œuvre est le fait d’Israël, et les victimes sont Palestiniennes.
D’un côté, des discours islamistes cons comme une valise sans poignée. De l’autre, un nettoyage ethnique à grande échelle avec des victimes se comptant en dizaines de milliers.
Fact is fact.
Que ECHO et Lormier en prennent note.
Que les religions rendent cons est tout sauf une surprise pour moi.
Je suis dubitatif sur cette implication de la religion comme seule motivation de l’action des Palestiniens. C’est certainement un des fondements de l’identité et de la revendication palestinienne. Mais quid des pro palestiniens extrêmes ou extrémistes, comme cette activiste canadienne ? Est elle musulmane ? Probablement elle soutient l’islam comme religion » discriminée » dans les pays occidentaux, et les musulmans comme nouveaux » damnés de la terre » , toujours dans les pays occidentaux , car dans les pays ou cette religion est dominante, la musique est différente.
« … seule motivation de l’action des Palestiniens. C’est certainement un des fondements…etc »
J’aurais peut être dû écrire du Hamas et non des Palestiniens, mais je pense que le Hamas et d’autres groupes similaires, représentent une bonne partie des Palestiniens. Je ne dissocie pas, jusqu’à plus ample informé, le Hamas, le FPLP, de l’ensemble des Palestiniens.
Le célèbre Georges Ibrahim Abdallah n’est il pas un » marxiste » ? Qu’est ce qui le différencie vraiment du Hamas ? Le moteur de celui -ci est l’islam, le moteur de celui là la détestation de l’occident, et dans tous les cas le désir de détruire Israël.
« Le célèbre Georges Ibrahim Abdallah n’est il pas un » marxiste » ? Qu’est ce qui le différencie vraiment du Hamas ?
L’âge. Les fondamentalistes ont progressé pendant que les socialistes disparaissaient. On a raté l’occasion à l’époque d’Arafat. C’est fichu.
Oui : disparitions (!) conjointes d’Arafat et de M. Beghin…
Le récit comme histoire/le récit comme discours.
Quand j’ai récemment proposé cette distinction basique (qui n’a rien d’original), c’est tout juste si on ne m’a pas traité de Trissotin.
Quelques jours plus tard, je constate avec satisfaction que cette distinction est validée par tous et qu’elle s’avère plus qu’utile.
C’est rassurant. Cela montre que même avec des apprenants rétifs voire hostiles, du genre Lormier, l’instructionnisme un peu exigeant finit par payer.
Rajout de la « rombière » au M. (12h19) :
« 10e Forum Économique Oriental (EEF) à Vladivostok »…
« fact is fact » (le JG ci-dessus) : certes.
Ainsi avec le EEF, il semble(rait) que les Ruskofs s’intéressent au développement de l’Arctique (!) et de leur l’Extrême-Orient, sous-exploité et sous peuplé.
Mais faudrait pas compter sur eux pour offrir aux Gazaouis une aide quelconque : les islamisés ne sont pas vraiment leur tasse de thé (samovar quand tu nous tiens)… pas plus qu’aux Xi…
Comme d’ailleurs la plus grande du monde… hormis les Occidentaux, au si grand coeur.
… « les Occidentaux, au si grand coeur » –
Dernière :
« Groenland: le ministre Jean-Noël Barrot sur place pour exprimer la « solidarité » de la France. » (la Presse, 31/08/25)
😂!
Retour aux origines.
Selon les pro palestiniens, il est faux de dire que tout a commencé le 7 octobre. Tout a commencé en 48 par l’expulsion violente des Palestiniens et l’accaparement de leurs terres.
Inutile de faire remarquer que personne d’un tout petit peu intelligent ne dit que » tout a commencé le 7 octobre » , c’est un argument rhétorique du style » homme de paille ».
Mais on peut remonter au delà de 47-48.
Voyons ce que disaient les précurseurs du Hamas vers 1930 au journaliste Albert Londres, venu enquêter sur les pogroms de 1929.
Voici ce que lui disent un chef palestinien et ses auxiliaires :
» Tous se tournent vers le sheikh Monafar.
(…)
– Le pays de Palestine est un pays arabe ; les Arabes étaient dans ce pays bien des années avant les Juifs. Les neuf autres approuvent par des murmures.
– Les Juifs, au cours de l’Histoire, ont occupé accidentellement quelques coins de la Palestine, mais jamais toute ! Pendant leur règne, qu’ont-ils créé ? Ils n’ont rien laissé comme civilisation. Comme marque de leur domination, que voit-on ? Une mosaïque! Les Romains les ont chassés. Ils sont partis. Le pays n’a rien gardé d’eux. Voilà pour le très vieux passé. Cinq cent soixante ans plus tard, l’Islam triomphait. Nos pères reprenaient la terre et la rendaient à leur ancienne nationalité. Depuis lors, nous étions chez nous.
– Chez les Turcs ?
– Enfin, nous étions presque entre nous. […]
– Que leur reprochez-vous ? [ aux juifs]
De nouveau, les voix s’élèvent ensemble
– D’être un « ramassis » de tout ce que l’Europe ne veut pas. De vouloir nous chasser ! De nous traiter en indigènes ! Voyons ! le monde ignore-t-il qu’il y a sept cent mille Arabes ici ? Si vous voulez faire ce que vous avez fait en Amérique, ne vous gênez pas, tuez-nous comme vous avez tué les Indiens et installez-vous ! Nous accusons l’Angleterre ! Nous accusons la France !
– Des faits !
– Premièrement, nous reprochons aux Juifs de nous ruiner. Exemple : la municipalité de Tel-Aviv, par suite de dépenses princières, était endettée de cent cinq mille livres. Le gouvernement palestinien a payé cette dette avec l’argent du trésor, et ce trésor c’est nous qui l’alimentons par l’impôt. Autre exemple : la Palestine est toute en travaux. On ne la reconnaît plus. Nous n’éprouvions nullement le besoin de cette transformation. À quoi bon l’électricité ? À quoi bon ces routes ? On fait des routes pour donner à manger aux ouvriers juifs. L’ouvrier juif travaille huit heures, l’ouvrier arabe douze heures. L’ouvrier juif est payé deux fois plus que l’ouvrier arabe. Le gouvernement que nous subissons n’est pas un gouvernement mais une association de bienfaisance pour étrangers. […]
– Troisièmement, nous leur reprochons de nous pousser hors de chez nous. Le pays s’appelle Palestine, ils l’ont baptisé Eretz-Israël (Terre d’Israël) La seule langue était l’arabe, ils ont fait accepter l’hébreu à égalité. Ils achètent nos meilleures terres. (Pourquoi les leur vendent-ils ?) Ils disent « Si vous n’êtes pas contents, prenez les os de vos prophètes et allez-vous-en »
À la place du Juif errant, alors, l’Arabe errant ?
– Messieurs, quelles conditions posez-vous pour ne plus égorger les Juifs ?
Tumulte ! Ils n’ont pas égorgé les Juifs ! Non ! Du moins, si je comprends bien, ils ne les ont pas égorgés pour les égorger, mais seulement pour attirer l’attention sur le sort fait aux Arabes. […]
Extraits du livre Le Juif errant est arrivé.
Référence des extraits
https://clio-texte.clionautes.org/albert-londres-la-question-juive-en-palestine.html
Les arguments des Palestiniens de l’époque ne sont pas ridicules. A. Londres les expose honnêtement.
Il est à la mode aujourd’hui chez les pro palestiniens de dénoncer le » cliché » selon lequel avant l’arrivée ( le retour ) des juifs, la Palestine était une terre sans cultures, à l’abandon.
Les chefs palestiniens interrogés par A. Londres admettent pourtant ( en trouvant cela inutile) que les juifs ( et les Britanniques) modernisent le pays ( » À quoi bon l’électricité ? À quoi bon ces routes ? « ).
….dénoncer le » cliché » ….
cliché catho ?
Oui…
… « Grand coeur » (suite) – même l’Inde ! (paroles, paroles, paro-les) –
« Ahead of Modi’s talks with Putin, Zelenskyy speaks to PM, says India ready to deliver signal to Russia »
Modi, in a post on X, thanked Zelenskyy for the phone call.
“We exchanged views on the ongoing conflict, its humanitarian aspect, and efforts to restore peace and stability.
India extends full support to all efforts in this direction,” he said. (😁) (indianexpress.com – 31/08/25)
ECHO 31 août 2025 à 15h31
Retour aux origines.
si je comprends bien, ils ne les ont pas égorgés pour les égorger, mais seulement pour attirer l’attention sur le sort fait aux Arabes. […]
C’est un peu ce que dit aujours’hui Ghazzi Hamad;le 7 octobre a remis la question palestinienne sur le tapis. Ca fait parler.
cliché catho ?
cliTO caCHE ?
préfaces épurées
préPUces éFFArés
effarés
Pour être complet ( ou compléter l’information) sur le pogrom de 1929 évoqué par A. Londres ( il n’a pas été témoin mais a interrogé témoins et survivants).
» Le vendredi 23 août, jour anniversaire de la Saint-Barthélemy, l’aurore voit des foules d’Arabes envahir Jérusalem. Ils marchent groupés, chaque homme tenant à la main un bâton ou un poignard lame nue. Ils chantent en entrant dans la ville sainte :
La religion de Mahomet
Défend son droit par l’épée,
Nous défendons par l’épée
Le prophète Mahomet.
Le grand jour est arrivé.
En face de la porte de Damas s’élève une grande bâtisse style château fort ; ce sont les bureaux du haut-commissariat anglais. Six jeunes juifs formant groupe sont là, dehors. Ils feraient mieux de se retirer, de laisser libre champ à la vague fanatique. Ils demeurent, représentant à eux six la révolte de la nouvelle âme juive. Ils en ont assez d’entendre dire que le Juif ne sait que courber le dos. Un orgueil trop longtemps contenu leur fait oublier que l’héroïsme ne marche pas toujours de front avec la raison. (…)
L’un des six, un journaliste autrichien, le docteur von Veisel, refuse de céder un mètre de sol à la colonne qui s’avance. Un musulman marche sur Veisel. Les deux hommes s’empoignent. Veisel a le dessus.
— Eh bien ! crie-t-il aux quatre soldats anglais et aux policiers qui sont là, devant les bureaux, l’arme au pied, un homme m’attaque, je le maintiens, venez l’arrêter ! Les agents de l’autorité ne bougent pas. Deux Arabes se détachent à leur tour et poignardent Veisel dans le dos. Les représentants de la loi contemplent le spectacle ; ils ne froncent même pas les sourcils. Pourquoi, alors, se gênerait-on ? Et les musulmans se précipitent sur les Juifs surpris par l’événement. Tous ceux qui passent y « passent ».
Plus on tue de Juifs, plus la police demeure immobile. »
Bien entendu aujourd’hui, les historiens ( ou prétendus tels) pro palestiniens affirment que les Britanniques étaient systématiquement du côté des juifs.
Suite de A. Londres
» – Mort aux Juifs !
— Le gouvernement est avec nous !
Ces cris à la bouche, le poignard au poing, les fils du prophète courent dans Jérusalem.
Ils attaquent les quartiers de Talpioth, de Gedud, d’Haavodah, de Beth-Hakerem et de Beth-Wegam, de Romena, de Gibeat-Chaoul, de San-Hedris, de Mahanain.
Ils tuent. Ils chantent.
(…)
[ A Hebron]
Le 23 août, le jour du grand mufti, deux étudiants talmudistes sont égorgés. Ils ne faisaient pas de discours politiques, ils cherchaient le Sinaï du regard, dans l’espoir d’y découvrir l’ombre de Dieu !
Le lendemain, dès le matin, des Arabes marquent leur inquiétude sur le sort des Juifs. Tous les Arabes ne font pas partie des fanatiques. La virginité d’esprit n’est heureusement pas générale en terre d’Islam.
— Sauvez-vous ! disent-ils aux Juifs.
Quelques-uns offrent aux futures victimes l’hospitalité de leur toit. L’un d’eux, même, ami d’un rabbin, marche toute la nuit et vient se planter devant la maison de son protégé. Il en défend l’entrée aux fous de sa race.
Lisez.
Une cinquantaine de Juifs et de Juives s’étaient réfugiés, hors du ghetto, à la Banque anglo-palestinienne, dirigée par l’un des leurs, le fils du rabbin Slonin. Ils étaient dans une pièce. Les Arabes, les soldats du grand mufti, ne tardèrent pas à les renifler. C’était le samedi 24, à neuf heures du matin. Ayant fait sauter la porte de la banque… Mais voici en deux mots : ils coupèrent des mains, ils coupèrent des doigts, ils maintinrent des têtes au-dessus d’un réchaud, ils pratiquèrent l’énucléation des yeux. Un rabbin, immobile, recommandait à Dieu ses Juifs : on le scalpa. On emporta la cervelle. Sur les genoux de Mme Sokolov, on assit tour à tour six étudiants de la Yeschiba et, elle vivante, on les égorgea. On mutila les hommes. Les filles de treize ans, les mères et les grand’mères, on les bouscula dans le sang et on les viola en chœur.
Mme X… est à l’hôpital de Jérusalem. On a tué son mari à ses pieds, puis saigné son enfant dans ses bras. « Toi, tu resteras vivante… » lui répétaient ces hommes du vingtième siècle ! «
Pour les extraits ci dessus
https://k-larevue.com/albert-londres-le-juif-errant-est-arrive/
Le 7 octobre, l’ONU,les narratologues, et tous les bien-pensants,ont eu la même attitude que la police lors du progrom de 1929.
ECHO 31 août 2025 à 17h28
J’aurais peut être dû écrire du Hamas et non des Palestiniens, mais je pense que le Hamas et d’autres groupes similaires, représentent une bonne partie des Palestiniens.
========================================================
Ghazi Hamdane est entièrement d’accord:le combat contre Israël est l’affaire de tous les Palestiniens, pas seulemnt du Hamas.
1 Le lendemain, dès le matin, des Arabes marquent leur inquiétude sur le sort des Juifs.
2 Tous les Arabes ne font pas partie des fanatiques.
3 La virginité d’esprit n’est heureusement pas générale en terre d’Islam.
Je comprends l’enchaînement 1-2 ceux qui s’inquiètent ce sont les non-fanatiques.
Si 3 est la reprise de 2 (reprise avec variation, tout sauf une redondance) alors fanatisme=
virginité d’esprit .
Curieux;il faut aller voir l’original, pour tirer ça au clair.
Je ne suis pas narratologue ,alors j’utilise la vieille méthode que m’ont enseignée mes
maîtres:je lis tous les mots.
Où avais-je la tête ? C’est l’original..
Grosse attaque des narratologues au profit du Hamas:
L’Humanité du 1 septembre :
150 médias, réunis à l’initiative de Reporter sans frontières, se mobilisent en solidarité avec les journalistes palestiniens de la bande de Gaza
https://www.humanite.fr/medias/armee-israelienne/genocide-a-gaza-quand-les-journalistes-francais-se-mobilisent-pour-leurs-confreres-palestiniens
Virginité d’esprit.
Peut etre dans un autre passage du livre non reproduit, A.Londres définit- il ce qu’il appelle » virginité d’esprit » ? L’expresion étonne car elle paraît s’appliquer au rebours du sens immédiat. La virginité d’esprit n’est pas ici synonyme d’innocence mais de violence commise sans scrupule moral , une sorte de naïveté meurtrière.
Encore une recherche à faire.
ECHO 31 août 2025 à 20h49
Pour être complet ( ou compléter l’information) sur le pogrom de 1929 évoqué par A. Londres ( il n’a pas été témoin mais a interrogé témoins et survivants).
=========================================================
Lors de ce pogrom, des Arabes sont morts aussi;certains ont été tués par la police britannique.
Les méthodes des Palstinines ne changent pas, ce sont leurs armes qui changent.
Le 7 octobre quelques terroristes ont été abattus ,soit par des civils israéliens qui avaient des armes, soit par des soldats qui ont eu le temps d’arriver.
Mais le bilan reste très lourd.
Et Ghazi Hamade (ainsi que ses soutiens occidentaux) se frotte les mains:on a démontré qu’Israël n’est pas invincible.
L’époque est tout de même très différente.
Si on se reporte aux autres extraits de A.Londres, il explique ainsi les raisons du pogrom de 1929 :
» Plus la situation des Juifs s’affirmait en Palestine, plus les privilèges féodaux des chefs arabes se trouvaient menacés. Les temps étaient venus d’arrêter l’invasion juive. Il fallait, pour cela, exciter les fellahs (les serfs) que les Juifs, dans l’ordinaire de la vie, ne gênaient pas outre mesure. Les fausses nouvelles avaient déjà commencé de travailler. Comme au moyen âge, on accusait les Juifs de véhiculer d’ignobles maladies. Le bruit courut qu’ils donnaient des bonbons et des fruits empoisonnés aux enfants musulmans. N’entendait-on pas dire qu’ils s’attaquaient aux femmes voilées ? Mais les preuves manquaient. Le fanatisme religieux serait seul capable de soulever la masse. »
Un incident sur l’esplanade des mosquées sert de prétexte; les musulmans avsient pris l’habitude pour narguer les juifs de faire defiler des ânes devant le mur des Lamentations. 400 jeunes juifs venus de Tel Aviv firent flotter le drapeau bleu et blanc devant le mur.
» Ce fut l’acte le moins politique, le plus imprudent commis par les Juifs depuis leur retour en Palestine. Il signifiait aux Arabes que désormais les Arabes n’auraient plus affaire avec les vieux Juifs à papillotes, mais avec eux, les glabres, les larges d’épaules, les costauds à col Danton ! »
» L’heure sonnait. Les batteries étaient prêtes. Le grand mufti, très gracieux jeune homme, entra en scène. Des tracts imprimés à la hâte furent envoyés aux imans des villages. Les imans les lurent aux fellahs rassemblés. Il y était dit que le drapeau sioniste devant le mur était le signal de l’attaque par les Juifs des lieux saints musulmans. Le mur, d’abord, n’était-il pas l’un de ces saints lieux ? À ce mur, Mahomet avait attaché Burak, son cheval, avant de le chevaucher pour monter au ciel. Le temps pressait. Les Juifs allaient détruire les mosquées d’Omar et d’Al-Aqsa. Des cartes postales truquées, montrant le drapeau sioniste au sommet d’Omar… »
En effet, les incidents ont commencé devant les mur des lamentations. Les Musulmans acceptaient que les Juifs y accèdent pour prier mais pas qu’ils apportent des chaises ou des paravents, car c’eût été tenter de s’arroger un droit de propriété.
Quand je dis que les méthodes sont les mêmes, je veux simplement dire que les palestiniens, aujourd’hui comme hier font des pogroms.
Le pogrom, c’est la méthode.
Voilà c’est ça;la religion a servi à manipuler les foules des alentours. La religion n’est pas le motif des progroms,elle est l’instrument grâce auquel les chefs mobilisent les foules.
« Washington Post » https://share.google/6ygg7Jt3PNSWhbIEc
Le 7 octobre quelques terroristes ont été abattus ,soit par des civils israéliens qui avaient des armes, soit par des soldats qui ont eu le temps d’arriver.
Mais le bilan reste très lourd.
Et Ghazi Hamade (ainsi que ses soutiens occidentaux) se frotte les mains:on a démontré qu’Israël n’est pas invincible.
Citation d’un pro-palestinien qui fait le même type de raisonnement que Ghazi Hamade;Tsahal n’est pas si fort que ça;la preuve, Tsahal n’arrive pas à venir à bout du Hamas
JG 24 août 2025 à 14h21
Mais…mais alors…si le risque existe encore…se pourrait-il que le Hamas ne soit pas to-ta-le-ment-é-ra-di-qué de la région ? Se pourrait-il que l’opération menée par Tsahal ne soit pas un succès total ?
Pogroms de 1929
Seuls deux arabes sont condamnés a mort par les tribunaux Britanniques ( bien que de nombreux autres sont condamnés a de la prison et des amendes collectives sont infligées aux villages aeabes):
» Après épuisement des recours, seuls Mohammed Jamjoum et ‘Ata al-Zir sont condamnés à mort et pendus le 17 juin 1930 pour le meurtre de 24 Juifs dans la maison d’Elizier Dan Slonim[172],[173]. Ils sont parfois décrits dans la presse arabe comme des « héros »[174] et seront ultérieurement parfois considérés par des Palestiniens comme des « martyrs d’Hébron » (chahids)[175],[176],[177],[178],[179], en particulier dans le poème Mardi rouge d’Ibrahim Touqan[180],[181],[182],[183].
Wiki Massacre d’Hebron
L’assassin devient un martyr. Virginité d’esprit…
Seuls deux arabes sont condamnés a mort par les tribunaux Britanniques
Correction : seuls deux arabes etc , s’agissant sauf erreur, du seul massacre d’Hebron.
Les historiens decoloniaux : la GB a utilise des méthodes violentes en Palfstine etc.
Réécriture de l’histoire
Ce qui a précédé le pogrom d’août 1929.
(Lormieir n’est pas historien, mais il a, comme tout Français, suivi des cours d’histoire. C’est ainsi qu’il a appris qu’il est toujours intéressant de connaître les faits qui ont précédé un événement. Cela ne permet pas (ou pas tojours) d’en déterminer les causes, mais cela nourrit la réflexion.
Josip Gavrilovic a,lui aussi suivi des cours d’histoire… Mais ,s’agissant de l’Ukraine,il croasse mécaniquement: »tout ce que je sais c’est que la Russie a envahi l’Ukraine. »)
=========================================================
L’esplanade du Mur du Kotel (des Lamentations), principal lieu de prières pour les Juifs, est, pour les Musulmans, à cette époque, la propriété du Waqf[2] qui gère le quartier maghrébin. L’exigence juive d’un libre accès au Mur se solde par un refus de la part des Musulmans. En rejetant le texte mandataire, les Arabes escomptent l’annulation de la Déclaration Balfour, ils attendent que les Britanniques leur confèrent l’autonomie et établissent un gouvernement national arabe indépendant en Palestine.
… En novembre 1911, l’Assemblée administrative de Jérusalem (Maglasse Al-Adara) établit que les Juifs ne disposent d’aucun droit de propriété, ni sur le Mur, ni sur l’esplanade, mais seulement d’un droit de visite pour prier. Il leur est interdit, dès lors, d’apporter un quelconque objet : ni chaises, ni paravent, ni chandeliers, ni rouleaux de la Torah. Rien qui puisse leurs donner un sentiment de propriété sur le site.
Au cours de l’administration britannique, l’exigence juive d’un libre accès au Mur suscite une opposition catégorique de la part des Musulmans. Après les incidents de Kippour 1925, lorsque Ronald Storrs[3] demande aux responsables du Waqf pourquoi cette obstination à refuser aux Juifs l’installation de sièges sur l’esplanade, ils lui répondent : « aujourd’hui ils installent des chaises, demain ils installeront des bancs en bois, ensuite ils les changeront en bancs métalliques, qui deviendront après demain des bancs en pierre. Ils monteront un toit pour se protéger du soleil et des murs contre le froid – subitement les Musulmans trouveront sur leurs terres des maisons dont ils ne voulaient pas. » Voici tout le conflit sur Israël note Ronald Storrs dans son journal. Ronald Storrs, qui comprend la manipulation arabe, propose au Waqf d’installer lui-même des bancs devant le Mur, ainsi, matérialiser sa propriété sur le lieu. »
https://hassidout.org/le-massacre-des-juifs-dhebron-le-24-aout-1929/
ECHO 1 septembre 2025 à 9h44
L’assassin devient un martyr. Virginité d’esprit…
=========================================================
Virginité retrouvée a posteriori.
Mais A.Londres avait l’air de dire que l’esprit du fanatique était vierge,avant même qu’il n’assassine .
Peut-on dire que les gens comme le narratologue qui pratiquent l’occluison mentale quant au 7 octobre ont l’esprit vierge ?
Rester vierge, c’est ne pas se laisser percer l’hymen.Garder les paupières bien closes est-ce comparable ?
Le plan de Trump concernant Gaza ne prévoit pas de tuer les 2 millions de Gazaouis (ce qui serait un génocide).
C’est un plan un peu fou mais quand même plus réaliste que celui de Josip Gavrilovic.
Lormier cite un de mes posts relatif à la situation Gaza/Tsahal/Hamas. Il me donne ainsi l’occasion de préciser mon raisonnement, sur l’interprétation duquel il se fourvoie dans les grandes largeurs.
Depuis bientôt 2 ans Tsahal bombarde, mitraille, tue à Gaza.
Quels étaient les objectifs de cette opération, objectifs clairement affichés par le Premier Ministre Israélien ? Supprimer totalement et définitivement le Hamas était un des quatre objectifs :
« Israel’s campaign has four stated goals: to destroy Hamas, to free the hostages, to ensure Gaza no longer poses a threat to Israel, and to return displaced residents of Northern Israel. »
Voir : Israeli invasion of the Gaza Strip – Wikipedia https://share.google/usPtxYs5IQDtgN2pr
(Article Wikipédia qui me semble plutôt bien documenté, avec des chiffres intéressants sur le nombre des victimes)
Il est plus que probable qu’à l’issue de cette opération menée par Israël depuis deux ans, le Hamas sera considérablement affaibli.
Mais l’objectif était de le détruire, de l’éliminer. Sera-t-il détruit, éliminé ? Il est plus que probable que non.
– Israël aura donc mené une opération qui aura fait quelques dizaines de milliers de victimes, sans que l’objectif de cette opération soit rempli : le Hamas n’aura pas été totalement éradiqué.
– Quand les armes se seront tues, il restera un territoire dévasté, à reconstruire, et surtout deux millions de personnes à déplacer. Nettoyage ethnique. Conditions d’existence épouvantables, déplacements forcés de populations. Un bordel sans nom. Mais le Hamas n’aura pas été totalement éradiqué.
Alors, la suite ?
– Les survivants du Hamas, même s’il n’en reste que quelques centaines (ce qui est déjà beaucoup), sauront se regrouper et se réorganiser.
– Financés et aidés militairement par l’Iran, ils ne tarderont pas à faire parler d’eux par quelques attentats à la bombe bien meurtriers, bien spectaculaires, en Israël, mais aussi hors d’Israël : les pays occidentaux si indulgents envers Israël « qui a le droit de se défen.en.en.endre, bon sang ! » et qui « laissent les bougnoules crever la gueule ouverte » (énoncés rapportés, Lormier. Énoncés rapportés) seront évidemment visés.
– Le pognon iranien n’aura évidemment aucun mal à convaincre les réseaux salafistes d’Europe (Belgique, France…) à prêter main forte à ces actions. On peut s’attendre à quelques jolis feux d’artifice.
Quand on s’attaque (avec un certain succès – même relatif ) aux effets plutôt qu’aux causes, on fait semblant de croire qu’on a éliminé les causes. Alors qu’au contraire on les renforce, on leur donne encore plus de raison d’être. Au Moyen-Orient, on dirait que personne ne comprend ça. C’est fou.
* convaincre les réseaux salafistes DE prêter main forte…
Lormier
1 septembre 2025 à 10h03
Le plan de Trump concernant Gaza ne prévoit pas de tuer les 2 millions de Gazaouis (ce qui serait un génocide).
C’est un plan un peu fou mais quand même plus réaliste que celui de Josip Gavrilovic.
——————-
Lexicologie appliquée à la géo-politique : ce qui est en cours à Gaza et qui serait amplifié par le plan Trump, ça s’appelle un « nettoyage ethnique ».
« Le nettoyage ethnique est une tentative de création de zones géographiques à homogénéité ethnique par la violence, la déportation ou le déplacement forcé. L’expression désigne une politique visant à faire disparaître d’un territoire un groupe ethnique. »
Lormier parle de réalisme. 80 ans après la création d’Israël sur le territoire de Palestine, on constate régulièrement à quel point cette décision était réaliste. Un franc succès qui emporte l’adhésion, sans le moindre doute.
Josip Gavrilovic, comme à son habitude, est à côté de la plaque. « He always gets it wrong » dirait Trump.
Ce qu’a souligné Lormier c’est que les pro-palestiniens se réjouissent des échecs d’Israël:vous voyez, Tsahal n’est pas si fort que ça,il ne vient pas à bout du Hamas. C’est exactement ce que disent les hauts dignitaires du Hamas, dont Ghazi Hamad. Et de se frotter les mains ,et de se féliciter de la réusite du pogrom du 7 octobre, et de se réjouir des « fruits » de l’opération dont celui-ci:en Occident les pro-palestiniens sont plus nombreux et plus actifs que jamais. Des Josip Gavrilovic ,on en ramasse à la pelle.
(Les chefs du Hamas ne sont pas à Gaza,ce serait bien trop risqué; le Mossad en a quand même trouvé 16 dans leurs planques diverses, au Liban ou ailleurs, et les a assassinés; Je suis d’accord:ce n’est pas suffisant pour éradiquer le Hamas.)
Lormier : « Ce qu’a souligné Lormier c’est que les pro-palestiniens se réjouissent des échecs d’Israël:vous voyez, Tsahal n’est pas si fort que ça,il ne vient pas à bout du Hamas.(…) Des Josip Gavrilovic ,on en ramasse à la pelle. »
Ai-je dit quelque part que je me réjouissais des échecs d’Israël ? Quand ? Où ? Lormier faux-cul démontre une fois de plus ses limites.
Ce que font Israël et le Hamas, le Hamas et Israël, ne me procure jamais aucune joie. Jamais. Je ne suis ni pro-palestinien ni pro-israélien. Je suis pro-justice.
En revanche, la façon dont a été traitée toute cette affaire depuis 1945 suscite toujours pour moi beaucoup d’interrogations. Je pense qu’il y avait moyen de faire mieux. Ceux à qui ça déplaît n’ont qu’à supprimer les formes interrogatives dans la syntaxe du Français.
Lormier, qui n’est pas historien mais a suivi des cours d’histoire, a retenu ceci: quand on « rapporte des énoncés » (comme dit le narratologue qui,lui aussi, a suivi des cours d’histoire)
on doit préciser qui les a tenus.
Josip Gavrilovic rapporte des énoncés, sans dire qui les a tenus.
Vous me direz:c’est moins grave que d’attribuer faussement des propos à quelqu’un. En effet c’est moins grave en ce sens que ce n’est pas crapuleux,c’est seulement un mépris des règles du travail historique.
« …c’est seulement un mépris des règles du travail historique… »
Lormier devrait lui offrir un guide pour des récits historiques.
Et lui demander, une fois pour toutes, pourquoi les biens des israélites l’obsèdent à ce point.
Oui…
(deux)
Pour le moment je sèche.
Un moment peut durer plus ou moins longtemps.
Quand un Suisse de Suisse alémanique vous dit « moment » (le t est sonore),prenez un siège et sortez votre anthologie des poètes persans.
« anthologie des poètes persans »
La version originale en tibétain classique ?
JG
» la création d’Israël sur le territoire de Palestine, on constate régulièrement à quel point cette décision était réaliste. Un franc succès qui emporte l’adhésion, sans le moindre doute »
Je remarque que prudemment, JG ne revient pas sur des événements comme les pogroms de 1929, et sans doute, s’il y revenait, ne manquerait il pas d’incriminer la religion ( explication bien insuffisante pour ces evenements où la religion fut instrumentalisee plus que motrice).
– puis ensuite nouvelle flambée de violence en 1935. 1929, 1935-36, ce me semble etre antérieur à 1945.
Sauf erreur JG a critiqué la décision de l’ONU de créer deux etats ( en basant cette décision sur l’impossibilité de faire cohabiter deux populations déjà séparées par des années de violences) .
Donc l’erreur n’était pas 1945 et au delà.
Elle etait déjà constituée par la déclaration Balfour ( avant cela, tout allait presque bien entre juifs et arabes , du moment que les premiers( une minorité assez négligeable) acceptaient de temps en temps de se faire humilier et même massacrer * sans se rebiffer.
Donc, l’erreur aurait été d’amener deux populations ethniquement différentes sur un même territoire.
Mais alors JG en vient a justifier l’idee qu’une population doit être ethniquement homogène ?
* pogroms de Safed en 1834 et 1838.
Réponses au post d’ECHO en plusieurs étapes. Trop de choses à ne pas mélanger.
Etape 1 :
ECHO : « Je remarque que prudemment, JG ne revient pas sur des événements comme les pogroms de 1929. »
JG, 25 août, 10h11 :
« Je réponds en tant qu’être humain ayant un sens moral : « Massacrer des civils de tous âges, face à face, les violer , les mutiler , les enlever pour pratiquer ces activités tranquillement, à la maison », ça révèle une cruauté, une jouissance dans l’abjection, un sadisme programmé et mis en œuvre de façon méthodique qui fait que pour moi, les auteurs de ces atrocités ont quitté le genre humain, sont sortis de l’humanité, sont devenus « autre chose », cet « autre chose » pouvant être appelé « monstres », « freaks », que sais-je. »
Et oui, mille fois oui, la religion a ce pouvoir de transformer des êtres humains en monstres. Par exemple, que s’est-il passé en France le 24 août 1572 ? Les Juifs n’ont hélas pas le monopole du « pogrom ».
Par ailleurs il y a sans doute lieu de s’interroger sur les raisons qui ont poussé ECHO à citer de façon détaillée les atrocités commises en 1929. ECHO sait fort bien l’effet prévisible chez le lecteur. Effet qui empêche la plupart du temps de réfléchir de façon sereine à une situation géo-politique donnée…La démarche d’ECHO n’est sans doute pas dénuée d’une certaine dose d’habileté.
Il faudra patienter pour l’étape 2, car j’ai à faire …
A plus.
Quelle(s) couleur(s) pour le revêtement de sol du parking ?
La grosse tru-ie aux pendeloques dorées s’excite – ça change du look palestinoche.
Petit rappel (2024 – depuis, en progrès ? ) :
« Je ne comprends pas votre question» : Mathilde Panot «ne sait pas» si la Palestine est à l’ouest ou à l’est du Jourdain » (sources ? dirait le JG – diverses – le Jourdain, lui, prend sa source… au Liban)
https://www.franceinfo.fr/pictures/BsvQl-WU4QzgFkV–1rXJ2XKeMA/0x10:1024×586/2656×1494/filters:format(avif):quality(50)/2025/08/24/000-72bp6xg-68aaffa2f04d1776673183.jpg
Dommage (gros plan) !
Autre :
https://cdn3.regie-agricole.com/ulf/CMS_Content/2/articles/886625/_MPanot-1000×562.jpg
La vainqueuse du championnat d’Auvergne de la fine saucisse ?
Lormier : « Ce qu’a souligné Lormier c’est que les pro-palestiniens se réjouissent des échecs d’Israël:vous voyez, Tsahal n’est pas si fort que ça,il ne vient pas à bout du Hamas.(…) Des Josip Gavrilovic ,on en ramasse à la pelle. »
J’ai exposé dans mon post de 10h28 ma vision de la situation actuelle et de ses conséquences prévisibles.
Si il y a des fous furieux pour penser que je m’en réjouis, il vaut mieux arrêter là toute discussion.
Il y a plusieurs sortes de pro-palestiniens en Occident, comme déjà dit.
Il y a un ramassis de connards et de connasses (souvent des étudiants) qui se mettent une serpillère sur la tête ou autour du cou et hurlent : »de la rivière à la mer,la Palestine sera libre ». Ils ne savent ce qu’ils disent,ils ne comprennent rien à rien.
Il y en a de moins cons…tout un dégradé au mons cinquante nuances,et puis il y a les crapules qui elles savent ce qu’elles font,par exemple les crapules de partis politiques qui manipulent connards, connasses et un peu moins cons afin d’en faire des électeurs.
Evidemment qu’aucune crapule pro-palestinenne ne vous dira qu’elle se réjouit du massacre du 7 octobre.
Pour Ghazi Hamade, ces distinctions n’ont guère d’importance:cette masse hétéroclite de pro-palestiniens en Occident en affaiblit les régimes, prépare l’élection de députés pro-palestiniens et favorise donc la cause djihadiste de mille manières.
Quand un Crapulovic dit:trala la lalère, le Hamas est toujours là,alors qu’Israël se vantait de l’éradiquer il redit à sa façon la même chose que le haut dignitaire du Hamas, sans bien sûr
reprendre le cri de victoire concernant le 7 octobre.
Mais le Hamas se félicite qu’il y ait maintenant tant de Crapulovic.
Ils se cachaient dans les rainures des paquets avec les cloportes, les cafards et les
cancrelats.C’est le succès du 7 octobre qui les a fait sortir.
Lormier aime dénoncer les cafards.
Oui…
« Quand un Crapulovic dit:trala la lalère… »
Lormier, arrêter de vous planquer comme un faux-cul : trouvez le « tra la la lalère » en question et dites où on peut le lire sous la plume de ce Crapulovic dont le nom évoque quelque peu celui de votre serviteur.
Pour le reste, je vous renvoie à mon post de 10h28. Je crois que contrairement à ce que vous ont enseigné vos maîtres, vous n’avez pas lu tous les mots. Loin s’en faut.
https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/01/en-inde-le-debat-passionne-autour-des-chiens-errants_6637969_3210.html
Bouffez-les !
JG 24 août 2025 à 14h21
Mais…mais alors…si le risque existe encore…se pourrait-il que le Hamas ne soit pas to-ta-le-ment-é-ra-di-qué de la région ? Se pourrait-il que l’opération menée par Tsahal ne soit pas un succès total ?
Non seulement Lormier lit tous les mots mais encore,il est attentif à la ponctuation et à la façon dont les mots sont écrits.
to-ta-le-ment-é-ra-di-qué
Pourquoi ces tirets ? Pour souligner ironiquemnt que l’on reprend les mots mêmes de
C’est une façon de dire Tra-la-la-la-lère, le Hamas il est pas éradiqué tu l’as dans l’os
Netanyahou ! Fallait pas faire le malin.
Que dire encore de cette fausse et crapuleuse interrogation,avec un conditionnel ironique ?
Se pourrait-il que l’opération menée par Tsahal ne soit pas un succès total ?
Post ci-dessus de Lormier 12h49 :
Il est impossible selon moi d’écrire ce post et de continuer à se prétendre intellectuel de bonne foi.
A la place de Lormier, j’aurais honte et j’irais me cacher mille pieds sous terre.
J’attribue généreusement ces contresens et ces dérapages à la rancœur et au ressentiment qui bouffent le foie de Lormier, qui, n’ayant rien de Prométhée, voit bien que son foie ne se reconstitue pas.
Sur le fond (et Lormier l’a touché), mon post de 10h28 répond à tout.
dénoncer les cafards.
déFoncer les caNards.
ECHO 1 septembre 2025 à 11h30
Mais alors JG en vient a justifier l’idee qu’une population doit être ethniquement homogène ?
=========================================================
Conclusion frappante d’une démonstration serrée.
Josip Gavrilovic fait mine de ne pas comprendre,comme d’habitude.
Il y a belle lurette que nous le savons indécrottable…
Mais pour le commentariat,ce n’est pas perdu.
JG
Je réponds à votre post de 12 h02 .
Vous vous méprenez sur mon intention en ce qui concerne le rappel des pogroms de 29 ( qui n’ont pas eu lieu qu’à Safed et Hebron).
Ce rappel, vis a vis des lecteurs lambda, avait pour but de montrer qu’il existe toute une antériorité au conflit israélo-palestinien, antériorité dans laquelle les arabes semblent avoir pris l’initiative des violences les plus dures (euphémisme, et il m’a semblé important d’en donner une idée précise ); avant cela disons entre 1880 et 1914, 1880 marquant plus ou moins le debut de l’immigration juive (dans le cadre sioniste ou » première alya ») , on trouve certainement des rixes entre membres des deux communautés, peut être avec mort d’hommes, mais jamais une attaque délibérée des arabes ( ou musulmans) dans une intention de massacre des juifs , et, faut il le souligner ( oui, je pense qu’il le faut) jamais d’attaque délibérée des juifs contre les arabes dans une intention de massacre.
Et ensuite, en remarquant que vous n’avez rien dit de ce rappel du pogrom de 1929*, mon intention etait de souligner que vous faites sinon une erreur du moins une simplification en considérant que les événements actuels proviennent des décisions de 1945 et au delà.
* Pogrom qui n’était pas le premier depuis la fin de l’empire ottoman en 1918 et l’occupation britannique de la région, transformée en mandat de la SDN en 1922.
Voir articles Wikipedia Émeutes de Jérusalem de 1920
Et pour les émeutes de 1921
https://fr.timesofisrael.com/emeutes-de-jaffa-de-1921-la-premiere-attaque-de-masse-en-palestine-mandataire/
L’article Wikipedia sur les émeutes de 1921 est curieusement succinct , je pense qu’il a ete modifié pour le réduire a peu de chose.
« Par ailleurs il y a sans doute lieu de s’interroger sur les raisons qui ont poussé ECHO à citer de façon détaillée les atrocités commises en 1929. ECHO sait fort bien l’effet prévisible chez le lecteur. Effet qui empêche la plupart du temps de réfléchir de façon sereine à une situation géo-politique donnée… »
Je vais donc en rajouter une couche.
» Quatre cinquièmes des victimes sont des Juifs ashkénazes, bien que certains d’entre eux aient eu un enracinement profond dans la ville. Toutefois, une douzaine de Juifs d’origine orientale, séfarade ou maghrébine, sont également tués[63]. Gershon Ben-Zion, par exemple, le pharmacien de la clinique de Beit Hadassah, un handicapé qui s’était occupé aussi bien de Juifs que d’Arabes pendant quarante ans, est tué avec sa famille ; sa fille est violée et assassinée et les mains de sa femme sont coupées[121]. » WIKI, massacre d’Hebron.
En effet les émeutiers ont prétendu s’en être pris (de préférence!) aux juifs askhenazes , » récemment » arrivés et non a ceux etablis depuis des générations. L’un des assassins et l’un des rares a etre exécutés ( considéré donc comme martyr par certains … ) declara : » De ces cinq hommes que j’ai tués, tous étaient des Juifs étrangers qui étaient venus en Palestine pour déplacer son peuple et il n’y avait pas un seul Juif arabe parmi eux[122″
Des arabes ont sauvé des juifs. D’autres juifs ont été tués par des gens qu’ils connaissaient et considéraient comme des amis :
Albert Londres, massacre de Safed :
» Alors, le 29, nous étions tous réunis à la maison. Nous entendons frapper. Mon père va à la fenêtre. Il voit une cinquantaine d’Arabes. Que voulez-vous, mes amis ? leur demande-t-il. – Descends ! Nous voulons te tuer avec ta famille. Mon père les connaît presque tous. Comment ? Vous êtes mes voisins ; je vois, dans votre groupe, plusieurs de mes amis. Depuis vingt ans, nous nous serrons la main. Mes enfants ont joué avec vos enfants. — Aujourd’hui, il faut qu’on te tue ! (…) Bientôt des coups de hache dans la porte. Puis un grincement : la porte a cédé. Mon père dit : « Ne bougez pas. Je vais encore aller leur parler. » Il descend. Au bas de l’escalier, en tête de l’invasion est un Arabe, son ami. Mon père lui ouvre les bras et va vers lui pour l’embrasser en lui disant : « Toi, au moins, tu ne me feras pas de mal, ni à ma famille. » L’Arabe tire son couteau de sa ceinture et, d’un seul coup fend la peau du crâne de mon père. Je descendais derrière, je ne pus me retenir. Je brisai une chaise sur la tête de notre ami.
Mon père s’affaissa. L’Arabe se baissa et lui redonna onze coups de poignard. Après il le regarda, le jugea mort et partit rejoindre les autres qui pillaient dans la pièce à côté. »
» Je m’appelle Abraham Lévy, je suis sujet français. Algérien. Je suis gardien à l’École de l’Alliance israélite. J’ai tout vu. Quand ils sont entrés à l’école, ils ont dit : « Abraham est de nos amis, il ne faut pas le tuer, mais seulement lui couper les mains. » Je m’étais enfui sur le toit. « Abraham ! criaient-ils, où es-tu ? Tu es notre ami, nous ne voulons que te couper une main ! » Je les connaissais tous. Tous étaient de bons camarades. J’ai pu me sauver. »
ECHO 1 septembre 2025 à 13h54
« Effet qui empêche la plupart du temps de réfléchir de façon sereine à une situation géo-politique donnée… »)
========================================================
Les membres de la flotille pro-palestinienne venus apporter un verre d’eau et un verre de lait aux Palestiniens (selon le célèbre pro-palestinien Abdallah) ont refusé de voir les images du pogrom (issues des caméras des terroristes-documentalistes en mission le 7 octobre).
Raison donnée:on ne veut pas être manipulés.
C’est le même type d’explication.
Ils craignaient de ne plus pouvoir » réfléchir de façon sereine à une situation géo-politique . »donnée…)
Et voilà:selon le narratologue, examiner des documents historiques obscurcit ou déforme votre vision de l’Histoire.
Il est fort quand même le croassant !
Et puis,un pays qui vole des documents appartenant à des documentalistes et met ces derniers en prison, vous appelez ça comment ?
Dugong (12h47) :
(Le Monde : en Inde, débat passionné autour des chiens errants…)
« Bouffez-les ! »
Débat vraisemblablement plus calme dans la Limousine Aurus de Pout’ :
« Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin engaged in an extended private discussion on Monday, taking place within Putin’s Aurus limousine following the SCO summit.
Putin offered Modi a ride, using the opportunity to continue their one-on-one talks for nearly an hour before their scheduled formal bilateral meeting »
(timesofindia, 01/09/25) (SCO : Sommet de l’OCS)
La Presse occidentale s’intéresse Pluto (ouaf) aux chiens errants ; c’est comme à Paris, où un adjoint au Maire (11e) a déclaré que le « surmulot » était un « animal très doux ».
https://pbs.twimg.com/media/GzvL_vYbwAAvtUx?format=jpg&name=medium
Pourtant le nom même de surmulot indique une tendance supremaciste vis a vis du mulot.
Cet élu de gauche place mal sa sympathie ( il faut espérer qu’il place mieux ses éconocroques – dans des studios parisiens à haute rentabilité par exemple).
Un certain Grégory Moreau – anti mort aux rats !
« chargé de l’alimentation durable, de la condition animale et de la propreté ».
Plutôt crever de faim que d’en croquer un (pouah!) – comme la Vache Sacrée, là-bas…
Mulots, tiniens, même combat !
Le meilleur piège à mulots c’est encore le bon vieux Lucifer !
https://5a6ac7c6.delivery.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/07/Produit-Tapette-a-souris-en-bois-Lucifer-2.jpg
JG 1 septembre 2025 à 14h14
Sur le fond (et Lormier l’a touché), mon post de 10h28 répond à tout.
Tiens, tiens…alors comme ça la forme, ça compte pour du beurre ? Les tirets ? L’ironie ?
Le « se pourrait-il que » ?
Le ricanement s’entend à l’oeil nu.
Bloub Bloub Bloub (suite)
https://reporterre.net/A-Marseille-des-ecologistes-prennent-la-mer-pour-ne-pas-abandonner-les-Palestiniens
Oukisson les nageurs de combat de la DGSE ?
Réponse à ECHO, suite.
Etape 2.
ECHO : Sauf erreur JG a critiqué la décision de l’ONU de créer deux etats ( en basant cette décision sur l’impossibilité de faire cohabiter deux populations déjà séparées par des années de violences) .
JG : Il y a erreur. Si vous voulez être honnête, il faut reconstituer les différentes phases de mon raisonnement :
– j’ai contesté l’idée même de la création d’un état juif, a fortiori sur des bases racialo-religieuses. Cette controverse nous a suffisamment occupé pour que je n’ai pas besoin d’y revenir.
– j’ai dit également : en 1945, l’énormité de l’horreur de la Shoah et l’énormité du traumatisme font que je puisse admettre, malgré les objections de principe ci-dessus, la création d’un état juif. Cette controverse nous a suffisamment occupé pour que je n’ai pas besoin d’y revenir.
– j’ai dit également : admettons la création d’un état juif. Mais pourquoi nécessairement en Palestine ? Cette controverse nous a suffisamment occupé pour que je n’ai pas besoin d’y revenir.
– j’ai dit enfin : puisque le projet est malgré tout de créer deux états, que cela soit fait avec équité. Or le projet était, à peu près: 60% de la population va se voir attribuer 40% du territoire, et 40% de la population population population va se voir attribuer 60% du territoire. Rien que sur les conditions territoriales de ce partage, oui, je le répète, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Beaucoup beaucoup mieux.
ECHO : Donc l’erreur n’était pas 1945 et au delà.
Elle etait déjà constituée par la déclaration Balfour ( avant cela, tout allait presque bien entre juifs et arabes , du moment que les premiers( une minorité assez négligeable) acceptaient de temps en temps de se faire humilier et même massacrer sans se rebiffer.
JG : Disons que dès avant 1945 la situation était, heu…comment dire…mal engagée. Les événements rapportés par Albert Londres et rappelés par ECHO permettaient de savoir que la situation n’était pas simple, et qu’elle avait toutes les chances de devenir explosives. Et on n’a pas été déçu.
ECHO :
Donc, l’erreur aurait été d’amener deux populations ethniquement différentes sur un même territoire.
Mais alors JG en vient a justifier l’idee qu’une population doit être ethniquement homogène ?
JG : Non. Comme je le dis plus haut, les circonstances particulières post-holocauste de 1945 expliquaient et justifiaient dans une certaine mesure que la tentative de voisinage sinon de cohabitation soit renouvelée, avec une nouvelle donne.
Encore aurait-il fallu que cette nouvelle donne respecte quelques règles élémentaires d’équité :
– on a vu plus haut l’aberration quantitative du partage du territoire. Pourquoi aurait-il fallu que les Arabes de Palestine se plient à ce partage aberrant et acceptent pareille injustice ?
– dans les modalités du partage : il était inévitable que l’iniquité quantitative aboutisse à chasser de leurs villages des milliers d’Arabes Palestiniens, au profit du tout nouveau Etat d’Israël. Comment cela a-t-il pu ne pas être anticipé ?
Oui, vraiment, il y avait moyen de faire beaucoup mieux.
Étape 3, pour le fun, mais pas que :
ECHO : Mais alors JG en vient a justifier l’idee qu’une population doit être ethniquement homogène ?
JG : L’idée d’une population ethniquement homogène me laisse de marbre. En revanche elle séduit actuellement bon nombre de nos compatriotes : ceux qui croient bon de faire une différence entre les « Français de souche » et ceux qui ne le sont pas.
Si ECHO a envie de leur expliquer les implications de l’idée d’une population ethniquement homogène, qu’il ne se prive surtout pas !
« L’idée d’une population ethniquement homogène me laisse de marbre »
C’est à dire blanche de peau.
C’est à dire blanc de peau. (?)
* pour que je n’aiE pas besoin d’y revenir.
En ce qui me concerne, je pense avoir fait le tour – peut-être provisoirement – de la question Gaza. Je frôle l’overdose.
Il y a d’autres choses excitantes dans ma vie : par exemple ma douce et tendre épouse (que WTH nomme élégamment « la pouff’ à JG »), ou bien la perspective et la préparation du prochain match de mon équipe de foot.
Alors, pour un temps, le Moyen-Orient, basta !
WTH 1 septembre 2025 à 14h13
Débat vraisemblablement plus calme dans la Limousine Aurus de Pout’ :
De quoi parle-t-on ?
le moteur de l’Aurus est un V8 de chez Poresche (600 cv)
Il n’est pas facile pour un Français d’acheter une Aurus,surtout en ce moment.
https://www.autoweek.com/news/a1697181/porsche-v8-engined-aurus-vladimir-putins-new-limo/
Difficile de trouver une Aurus en Europe.
En revanche si vous voulez pouvoir vous déplacer dans des bourbiers profonds, vous pouvez vous acheter un SHERP, véhicule inventé par un ingénieur ukrainien et commercialisé par une société canado-ukrainienne. Vous pouvez même rouler sur un lac gelé;si la glace craque, pas de problème, le véhicule flotte grâce à ses énormes pneux gonflés aux gaz d’échappement.
https://www.youtube.com/watch?v=luU6M4TZn7g
Les sauveteurs de Morecambe Bay s’en servent pour circuler sur les sables mouvants.
Suffit de tirer dans les pneus pour immobiliser cette chose voire la couler
« Difficile de trouver une Aurus en Europe »
Même en pompant le vendeur, ils ne vous en donneront jamais une.
biens des israélites
bITES des israélIENs
JG se sort de toutes les difficultés » les doigts dans le nez ».
Comment résoudre la situation de la Palestine en 45, divisée entre deux populations d’importance différente mais priori irremediablement hostiles l’une à l’autre ? Réponse : on pouvait mieux faire ( transférer tous les juifs déjà présents en Palestine à Pasadena, par exemple, mais j’en ai plein d’autres…)
Ça rappelle la vieille mention paresseuse sur les carnets de notes : peut mieux faire.
Quant aux États ethniquement homogènes, JG n’est ni pour ni contre, puisque cela le laisse de marbre. On peut quand même inférer de ce qu’il dit ensuite, qu’il n’aime pas l’idée, certainement » nauséabonde » comme on dit chez Libé ou l’Obs.
Or, comme la situation en Palestine ( au sens du territoire tel qu’il était en 1945) était potentiellement catastrophique ( et que l’ONU a cru éviter une catastrophe par la solution à 2 Etats, qui developpa évidemment d’autres problèmes) nous sommes, pour maintenir la logique du raisonnement de JG, amenés à penser que cette situation grosse de catastrophes, ne provenait pas du fait qu’il y avait en présence deux ethnies pour un seul territoire, puisqu’une telle condideration est attribuée par JG à des gens pour qui il n’a , manifestement, pas de sympathie. Mais alors d’où provenait-elle ?
Une idée, commissaire Bourrel ?
Bon sang, mais c’est bien sûr, j’ai trouvé le coupable. C’est la re-li-gion.
Et hop, double salto et rétablissement.
( Attention, je fais de l’appropriation culturelle en me substituant aux lacunes du raisonnement de JG, j’en suis conscient).
Disons que quand, involontairement ou pas, on caricature mes propos, on s’abstient de prendre en compte mes objections, on fait comme si à peu près tout ce qui sort de ma plume n’était que manipulation ou entourloupe rhétorique, eh bien oui quand tout ça se produit, je ne me donne pas forcément la peine de produire en réponse une inexpugnable forteresse intellectuelle : j’assure le service minimum.
Et ce service minimum est encore très au-dessus de ce qu’on peut lire habituellement sur ce blog au sujet du Moyen-Orient !
ECHO, soit dit en passant : il me semble que vous sous-estimez considérablement la nocivité des religions (toutes) dans l’Histoire.
Ce en quoi vous commettez une colossale erreur d’appréciation, pour le passé comme pour le présent.
Pour commencer, une lecture initiale vivement recommandée : « Les croisades vues par les Arabes », de Amin Maalouf.
Qui explique encore bien des choses sur notre monde contemporain.
Croisades…religion…vous ne voyez pas le rapport ?🙂
Ah, vous revenez aux croisades maintenant…
Non, je ne vois pas le rapport avec la question de la Palestine.
Que je sache ce ne sont pas les croisés ni les Européens ( les chrétiens) qui se sont installés en Palestine à la fin du 19 eme siecle , rejoignant un noyau qui s’y était maintenu depuis des siècles ?
Alors pourquoi ramener les croisades dans le débat ?
Le bouquin de Maalouf, vous l’avez lu, ou pas ?
Il y a pourtant un rapport avec la Palestine.
Cherchez bien.
Mais au-delà du fait que de génération en generation s’est transmis le récit des atrocités commises par les Croisés (encore pires que le pogrom de 1929 que vous avez un peu complaisamment exhibé), donnant naissance chez les Arabes à une hostilité plus ou moins larvée vis-à-vis de tout ce qui vient de l’Occident, au-delà de tout ça – qui n’est pas rien, vous avez un magnifique exemple de l’extrême nocivité de la religion dans l’Histoire, qui était le sujet dont je vous parlais dans mon post de 17h14.
Dans l’Histoire des peuples comme dans les Langues, il y a une diachronie. Et dans l’Histoire comme dans les Langues, il ne faut jamais la perdre de vue. La situation actuelle du Moyen-Orient a bel et bien une étymologie.
Le seul rapport que je vois avec la Palestine est que ce nom a survécu jusqu’au 19 ème siècle en Occident grâce au souvenir des croisades , alors qu’il s’était perdu au Moyen- Orient où personne n’en parlait plus.
Vers 1850, les puissances européennes commencèrent à nommer des consuls en Palestine et c’est ainsi que le nom commença à être réutilisé par les Moyen -Orientaux eux mêmes, jusqu’a sa consécration par l’institution par la SDN de la Palestine mandataire.
Et comme vous le savez sans doute, l’état juif failit s’appeler Palestine.
Le bouquin de Maalouf, vous l’avez lu, ou pas ?
Le récit des atrocités commises par les Croisés (encore pires que le pogrom de 1929 que vous avez un peu complaisamment exhibé), donnant naissance chez les Arabes à une hostilité plus ou moins larvée vis-à-vis de tout ce qui vient de l’Occident…
C’est le problème avec les musulmans : hier c’est aujourd’hui, et aujourd’hui c’est demain, puisqu’Allah est incréé.
Qui nous protègera un jour des croyants ?
De TOUS les croyants.
Exemple : USA, terre de croyants.
Les tenants et les aboutissants du suprémacisme blanc aux USA méritent le détour.
Au secours !
De TOUS ? Je vous croyais plus adepte de la nuance. La « croyance » débute avec l’acceptation ou le refus d’une forme de transcendance humaine, acceptation qui ne renie rien de l’évolution.
@Hcc1
Oui, il est vrai que ma détestation des religions me fait parfois prendre feu.
Disons alors que je suis riche de mes contradictions ! 🙂
Et non, je n’ai pas lu le livre de Maalouf ( supposé prouver que les Arabes ou musulmans ont raison de garder une dent contre les chrétiens ?) – mais quel rapport avec les juifs ?
Sinon le rapport bricolé par les decoloniaux qui « analysent » la présence des Israeliens au Moyen -Orient comme une colonisation européenne ( ou occidentale).
Chrétiens, Juifs, USA = Occident blanc. Colonisateur. Impérialiste.
Si vous sortiez un peu de vos schémas pré-mâchés par votre bien-pensance hémiplégique, il y a des choses que vous comprendriez un peu mieux, et des ressorts psychologiques dont vous comprendriez la nature.
L’hôpital se foutrait de la charité ?
Vous pouvez jeter un œil sur cet article:
https://theconversation.com/croisades-quand-lhistoire-deforme-la-realite-et-nourrit-la-haine-101789
Maintenant si vous me dites que certains arabo musulmans haïssent l’occident, vous ne m’apprenez rien. Qu’ils se trouvent des raisons de le faire n’est pas non plus étonnant.
Je fais confiance à votre curiosité intellectuelle :
« Dans « Les Croisades vues par les Arabes », Amin Maalouf dévoile avec maestria un récit poignant et captivant des Croisades, offrant une narration révélatrice qui diverge des
perspectives eurocentriques souvent enseignées dans les cours d’histoire. En explorant les chroniques, lettres et récits
personnels rédigés par des historiens et écrivains arabes médiévaux, Maalouf présente un récit richement nuancé de résilience, d’intrigues et de chocs culturels du point de vue de la partie perdante d’un des conflits les plus emblématiques de l’histoire. Le résultat est un portrait vivant et humanisé de
l’époque, mettant en lumière les impacts profonds et les héritages durables des Croisades sur le monde arabe. Ce livre
n’est pas simplement un récit historique ; il représente une invitation à repenser et à reconsidérer une époque significative
d’un point de vue alternatif, en faisant une lecture indispensable pour quiconque souhaite saisir une compréhension plus complète et nuancée du passé. »
ECHO :
« Maintenant si vous me dites que certains arabo musulmans haïssent l’occident, vous ne m’apprenez rien. Qu’ils se trouvent des raisons de le faire n’est pas non plus étonnant. »
Toute l’ambiguïté de votre posture intellectuelle est contenue dans votre « Qu’ils se trouvent des raisons de le faire… »
Comme si vous étiez incapable de concevoir QU’ILS AIENT des raisons objectives, factuelles, de le faire.
Incapable de le concevoir, ou extrêmement réticent à l’admettre.
Raison factuelle ? La prise de Jerusalem en 1099?
Vous prenez tous les Arabes pour des c…?
Ce n’est pas mon cas .
Un seul exemple. En 1799 ( moins loin que 1099) les Français de Bonaparte s’installent en Égypte, et doivent essuyer des révoltes de la population ( et pas seulement la résistance des mamelucks, jusque là dictateurs de l’Égypte et dont Bonaparte présentait l’élimination comme un bienfait pour les Égyptiens).
20 ou 30 ans après, Mehemet Ali, le modernisateur de l’Égypte, avait les meilleures relations avec la France et l’obélisque de la place de la Concorde en témoigne ( et avec la GB également). Les cadres de l’Égypte nouvelle étaient Français, et la France avait une grande réputation en Égypte.
Mehemet Ali etait le contraire d’un c…
ECHO : Raison factuelle ? La prise de Jerusalem en 1099?
‐‐—————————————–
Heu….on parle bien des raisons factuelles qui font que certains arabo musulmans haïssent l’occident?
Au hasard : Bugeaud, Cavaignac, Lamoricière, les enfumades…c’est bien des raisons factuelles, non ?
Et s’il n’y avait que ça…
Le croasse,
Arrêtez de nous khasser les khouilles avec vos gentils bougnouls tous pleins d’amour!
Pendant près de 500 ans les barbaresques, bougnouls d’aujourd’hui essentiellement d’Algérie, ont écumé les côtes de la Méditerranée, celles de vers chez nous, les koufars. Le littoral de France, la Corse, la Sardaigne, les vaisseaux qui tentaient l’aventure entre ce magnifique pont culturel de Marseille à Alger. Nous eûmes même une congrégation religieuse spécialisée dans le rachat des captifs, qui mendiait le rachat de Don Quichotte auprès de nos rois, je vous mets le lien tellement que votre idéologie vous aveugle, à moins que vous ne soyez trop khon….
Le rachat de captifs espagnols à Alger au XVIe siècle. Le cas de la rédemption de Diego de Cisneros (1560-1567).
Ils ont tellement khassé les khouilles des blancs que même les USA sont venus, deux fois, 1801 et 1815, pour y mettre bon ordre deux fois….Ce sont des faits historiques parfaitement documentés. Mais le croase pense que s’il y a 4% de bougnoules dans la population générale et 28% d’entre eux au gnouf c’est juste une coïncidence…
Après si vers 1830 on leur a rendu la monnaie de leur pièce, et bien tant mieux!
😄!
Benito, mettez-vous bien avec WTH : « les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds ». C’est du Rimbaud.
Oui Benito. Tout ce que vous voudrez Benito.
urne argumentaire vide chez le serbique.
Reset !
Reset ? Vous êtes trop bon.
Il y en a, qui meurent d’envie de régler mon sort en appuyant sur la touche « delete »..
Jean-Paul Brighelli 1 septembre 2025 à 18h08
C’est le problème avec les musulmans : hier c’est aujourd’hui, et aujourd’hui c’est demain, puisqu’Allah est incréé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nous n’avons pas du tout la même vision de l’histoire que les pro-palestiniens du Moyen Orient.
Pour Abdullah Al-Amadi, journaliste qatari, la bataille pour Gaza est une répétition d’une bataille contre les Mongols au 13ème siècle;c’est une étape dans la guerre pour rétablir je ne sais quel empire mahométan. Bien sûr la disparition d’Tsraël, l’extermination des Juifs sont nécessaires et donc au programme.
» The Zionist barbarity and tyranny are no different from those of the Mongols at the time. The crushing of Gaza means that the Zionists’ tyrannical campaign against the Arab and Islamic world will continue, unless there is a new [Battle of] Ayn Jalut.[3] I believe Gaza is now retracing the path of Qutuz[4] and the Mamluk believers against the evil infidel Mongols, »
Les israélienes sont des Mongols;au 13ème siècle on a battu les Mongols. Ce sera pareil avec
les Mongols que sont les Israéliens.
Vous me direz ,on a bien ici un Occidental qui raconte que le pogrom du 7 octobre est une conséquence des croisades…
https://www.memri.org/reports/qatari-journalist-victory-jihad-fighters-gaza-will-spell-end-zionist-era
Donc la haine des Algériens déteint sur les Palestiniens ou les Arabes du Moyen Orient?
Je ne dis pas que ça n’existe pas, chez les partisans d’une idéologie. On en reparlera sans doute.
Le narratologue vous refait le coup de la diversion et de l’excentricité; il veut changer de sujet et partir sur l’Algérie. Il sait très bien que ça n’a rien à voir…
Je pense qu’il a compris que ses petites esquives et manoeuvres obliques sont bien perçues comme telles.
Alors il change de sujet,et il prend un thème qui peut raviver une polémique.
Les sornettes de JG n’ont guère d’intérêt en elles-mêmes;ce sont vos réponses à ces sornettes qui sont intéressantes.
Merci, j’apprends beaucoup.
Je me demande de plus si tout cela n’est pas un jeu pour lui.
Jeu névrotique, mais jeu.
Je me demande de plus en plus:ce n’était pas mon hypothèse de départ,mais au fil du temps, en voyant comment l’individu se comporte…
« il veut changer de sujet »
Justement non : c’est le même sujet…
Qu’est-ce que ça peut être fatigant de s’adresser à des gens qui comprennent lentement, qui voient les problèmes de façon parcellaire et jamais de façon globale, qui n’ont pas l’esprit de synthèse…
Être instructionniste, ça n’est pas facile tous les jours.
Je dis une seule chose : le monde arabo-musulman n’a pas besoin de se chercher ni de se trouver des raisons de détester l’Occident : il les a, car l’Occident lui en a fourni pléthore.
Le monde arabo-musulman est vaste. Eh bien du Maghreb jusqu’au Émirats, l’Occident a au fil du temps fait tout ce qu’il fallait pour se faire détester.
C’est factuel, vérifiable, sur plusieurs siècles.
Ça vous déplaît ? Dommage, c’est la dure réalité de l’Histoire, et vous n’y pouvez rien changer.
Mendax 31 août 2025 à 13h25
L’argument sur l’invincibilité de la russie, c’est vous-même qui le ressortez régulièrement, sous une forme un tout petit peu plus sophistiquée : la population russe est plus nombreuse que la population ukrainienne, donc la russie va forcément gagner .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ces phrases faisant partie d’une réponse à Lormier le vous-même de lla première désigne Lormier.
Mais, vraiment, sincèrement « l’argument sur l’invincibilité de la Russie », cela ne ressemle pas du tout à Lormier, lequel n’a cessé de dire qu’on ne savait rien de ce qui se passe en Ukraine
(la CIA en sait plus, mais Lormier ?).
Il est possible, tout au plus que Lormier ait un jour mentionné que la disproportion des populations jouait un rôle, à ne pas négliger.Qui peut dire le contraire ?
Il est possible qu’il ait cité Todd qui dit à peu près cela.
Mais Lormier se prononcer sur l’issue ? Jamais de la vie .
Il faudrait ignorer tout de l’histoire récente pour parler d’invincibilité de la Russie. Et l’Afghanistan alors? L’invincible armada fut défaite. personne n’est « invincible ».
Mendax me reprocherait-il de déplorer les morts russes aussi bien que les morts ukrainiens ?
Me reprocherait-il de refuser de traiter les Russes d’orcs ? J’admets ce genre de choses de la part de soldats ukrainiens sur le champ de bataile; en tant que Français vivant tranquillement en France je ne me reconnais aucun droit d’insulter tout un peuple.
Dugong 1 septembre 2025 à 17h17
Suffit de tirer dans les pneus pour immobiliser cette chose voire la couler
Mais pourquoi voudriez-vous la couler ? Toujours cette manie du sabotage.
NB Les modèles récents sont suffisamment légers et ont des fermetures suffisamment étanches pour ne pas couler,même pneus dégonflés.
Il y a des moments où la lassitude me gagne. Vouloir instruire contre leur gré celles et ceux qui ne veulent pas savoir, vouloir conduire à la rivière les ânes qui croient ne pas avoir soif, vouloir rendre un tout petit peu plus intelligents les membres de la fachosphère qui, forcément, partent de loin, tout cela est épuisant.
Je me dis parfois que le jeu n’en vaut pas la chandelle, et que je ferais mieux de laisser tomber.
Puis la pulsion prométhéenne qui m’anime reprend le dessus. Je me dis alors que je ne peux pas laisser Lormier dans son état actuel de médiocrité, je me dis que WTH, suiviste comme elle est, gagnerait au change à me suivre, je me dis que ECHO, ayant déjà fait la preuve de son désir d’apprendre, pourrait être sauvé, je me dis que Dugong…(non, en fait, au sujet de Dugong je ne me dis rien). Et je me dis que ma mission rédemptrice n’est pas terminée. Alors, je repars au combat, tel Don Quichotte avec ses moulins et son inaccessible étoile.
Ma bonté me perdra.
🙂
« je ne peux pas laisser Lormier dans son état actuel de médiocrité »
Vous devriez.
Y aura t-il une rencontre entre Poutine et Zelensky dans un avenir proche ? Pourparlers ?
Cette guerre va-t-elle finir ?
Difficile de tirer quelque chose de précis de cette émission; que veut dire le vice ministre ukrainien des Affaires étrangères ?
https://www.youtube.com/watch?v=JHasIjapiOU
C’est prodigieux:Starmer parle plus de deux minutes pour ne rien dire. Deux ou trois fois on l’entend dire « some sort of » (une espèce de sorte de , quelque chose comme);le commentateur appelle ce discours « waffle » et c’en est l’exemple même (baratin).
Il y a autour de cette table des gens puissants, dont Trump, dont des dirigeants européens.
Ils sont venus de loin… pour entendre ça ! On est à la Maison Blanche et cette réunion de puissants ne sert à rien.
https://www.youtube.com/watch?v=-GFz4EyqYmg
Starmer ressemble de plus en plus à Quatremer. Sont-ils désormais discrètement interchangeables ?
Le névrosé a quand même obtenu une reconnaissance,celle de Ghazi Hamad…mais ça n’a pas l’air de lui suffire.
Jean-Paul Brighelli 1 septembre 2025 à 18h08
C’est le problème avec les musulmans : hier c’est aujourd’hui, et aujourd’hui c’est demain, puisqu’Allah est incréé.
Comparer les atrocités commises par les croisés à celles commises par les Arabes, à Hebron en 1929,n’est-ce pas dire qu’hier c’est aujourd’hui ?
JG 1 septembre 2025 à 17h38
atrocités commises par les Croisés (encore pires que le pogrom de 1929
Le GPS d’Ursula bricolé par les popovs. Résultat : elle débarque dans un bouge d’Istanbul pratiquant la traite des blanches. Les autres non-élus du comice se demandent si ça vaut le coup de l’exfiltrer.
JG 1 septembre 2025 à 22h37
Je dis une seule chose : le monde arabo-musulman n’a pas besoin de se chercher ni de se trouver des raisons de détester l’Occident : il les a, car l’Occident lui en a fourni pléthore.
JG les Allemands ont aussi fourni aux Français pléthore de raisons pour être détestés, pourtant 15 ans à peine après Auschwitz, Oradour, Jean Moulin et j’en passe la réconciliation était largement acquise. Nous nous sommes battus pendant des siècles avec les Anglais de Jeanne d’Arc à Mers El Kébir et de Trafalgar à Fachoda, et puis il y a eu l’Entente Cordiale.
Sur la scène intérieure les catholiques ont allègrement massacré les protestants, des cathares et des albigeois à la Saint-Barthélémy (la notion n’existait à l’époque mais techniquement c’était un véritable génocide) et Richelieu a affamé La Rochelle et pourtant aujourd’hui aucun protestant ne pose de bombes dans les églises.
Les légions romaines ont réduit en esclavage une bonne partie des vaincus d’Alésia et pourtant personne ne songe à faire un mauvais procès à Rome.
Jusqu’à quand doit-on remonter dans l’histoire en brandissant les exactions des uns contre les autres? La fin de la guerre d’Algérie c’était il y a 63 ans et les caciques du FLN qui ont mis le pays en coupe réglée et maintiennent délibérément leur population dans un sous-développement économique et intellectuel chronique continuent d’agiter le chiffon rouge des méfaits de la France pour distraire leur opinion publique.
La guerre d’Algérie a eu, de mon point de vue car j’y ai vécu et que j’y ai rencontré non pas des bougnoules mais des Algériens qui avaient vécu les événements, toutes les caractéristiques d’une guerre civile. Ce fut une guerre fratricide entre des pieds-noirs qui se sentaient algériens et des Algériens qui voulaient être français. Et comme dans toutes les guerres civiles les exactions, particulièrement contre les civils, furent nombreuses et des deux côtés, et cela aucun historien sérieux ne le conteste. Donc un partout et la balle au centre.
Le baratin de Josip Crapulovic est en parfaite harmonie avec celui des stratèges du Hamas:pour rétablir la justice au Moyen Orient,il faut rendre aux « Arabes » ce qu’on leur a pris,il est nécessaire détruire l’Etat Israël.
Ghazi Hamad adoube les pro-palestiniens occidentaux, qu’il s’agisse de connards et connasses ou de crapules.
Bullshit d’un médiocre qui aspire à le rester.
« Donc un partout et la balle au centre »
Seulement un ?!
N’avez-vous pas vu que le terrain était en pente ? Devinez dans quel(s) sens…
Lu dans l’Osservatore Ecolo
« Dette oblige, le gouvernement en sursis de François Bayrou est à la recherche de 44 milliards d’euros d’économie pour l’année à venir et imposer son régime d’austérité. Parmi les mesures préconisées figure la suppression ou la fusion de 30 % des opérateurs publics de l’État, dont font partie les onze parcs nationaux français.
Un rapport sénatorial publié le 1er juillet suggère ainsi, entre autres, de rassembler ces derniers et de les intégrer à l’Office français de la biodiversité (OFB), pour des raisons de lisibilité administrative. Or les personnels et acteurs des parcs craignent que ce projet ne mette en péril le bon exercice de leur mission. Et que dans ce contexte d’austérité, ce soit au bouquetin et à la salamandre, dont ils assurent la sauvegarde, de trinquer »
Déguiser les personnels en bouquetins est, a priori, plus facile que de grimer des bouquetins en salamandres (putains de cornes alakhs !). Les touristes doivent être informés qu’il sera normal de croiser beaucoup plus de grosses salamandres à cornes qu’avant en randonnée
(😁)
Un Lointain Lecteur
« La guerre d’Algérie a eu, de mon point de vue car j’y ai vécu et que j’y ai rencontré non pas des bougnoules mais des Algériens qui avaient vécu les événements, toutes les caractéristiques d’une guerre civile »
Bien entendu, comment vous donner tort ?
Je fais seulement une remarque
Comparez l’Algérie avec l’Afrique du Sud.
Les « Blancs » sont restés ( parfois mal mais ils sont restés) Évidemment on pourrait faire une longue liste des differences entre les deux pays.
Mais la principale différence ( pour moi ) est que les Européens d’Algérie n’avaient pas pu ou voulu rompre le cordon avec la mère patrie , et a fortiori, la mère patrie , si soucieuse de combattre toute velléité autonomiste, n’avait pas voulu les faire évoluer vers l’ indépendance.
Je pense que les choses auraient ete différentes si l’Algérie avait pu évoluer vers une » indeoendance- colons » comme l’Afrique du Sud ( indépendante depuis au moins 1931, voire 1926, sans aucun tambour ni trompette, juste par une déclaration du PM brit constatant que les dominions étaient souverains).
Il y aurait eu , si ce modèle avait pu être suivi, en Algerie une lutte politique comme il y en a eu une en Afrique du sud, mais pas une guerre d’indépendance avec ses horreurs ( du moins c’est une hypothèse que je fais).
Pour le plaisir
Miss Mia Le Roux, miss South Africa 2024
https://www.misssa.co.za/2024/08/12/mia-le-roux-is-crowned-miss-south-africa-2024/
Meilleure photo de Mia Le Roux
https://x.com/AfricaFactsZone/status/1822356093542019337/photo/4
Voir 4 eme photo .
En fait je m’aperçois que les lauréates de ce concours sont depuis quelques années plutot métissees quand elles ne sont pas noires.
Concession au politiquement correct ? Autrefois, blanches , noires et métissees alternaient il me semble.
Le post du lointain lecteur (il mérite ici que je ne l’appelle pas Benito. Benito le facho éructe, le lointain lecteur tente d’aligner deux ou trois réflexions cohérentes et de les exprimer dans un langage articulé) reprend des éléments de langage que j’ai entendus déjà mille fois au cours de ma pourtant jeune carrière.
Je retiens néanmoins cette petite phrase tout à fait intéressante : « Jusqu’à quand doit-on remonter dans l’histoire en brandissant les exactions des uns contre les autres? »
Deux remarques en guise de début de réponse :
– il faut remonter parfois très très loin si l’on veut avoir une vision globale d’un problème, en comprendre la nature, et comprendre les ressorts psychologiques qui peuvent expliquer les positionnements d’aujourd’hui.
– c’est tellement vrai que je constate que le Sionisme remonte très très loin (plusieurs millénaires…) dans l’Histoire du « peuple juif » pour se justifier en tant que corpus idéologique et justifier la revendication de la « Terre Sainte ». C’est un constat auquel personne ne peut échapper, pas même votre serviteur. Et ce constat-là ne choque personne. Deux poids deux mesures.
Le lointain lecteur adopte l’attitude intellectuelle hémiplégique classique : « je prends l’histoire en compte quand ça m’arrange, et je la congédie quand elle m’embarrasse. »
Comparer les deux énoncés suivants :
a) il faut remonter parfois très très loin si l’on veut avoir une vision globale d’un problème, en comprendre la nature…
b) Tout ce que je sais c’est que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022
Je valide et confirme le bien-fondé des deux énoncés.
– Il faut remonter loin pour comprendre cette « opération spéciale ».
– Le volcan grondait depuis un certain temps. Et l’éruption a été déclenchée militairement en février 2022 par la Russie.
Ça vous déplaît ? Tant pis.
« Ce fut une guerre fratricide entre des pieds-noirs qui se sentaient algériens et des Algériens qui voulaient être français. »
130 ans après le début de la colonisation, la population arabo-musulmane d’Algérie n’avait toujours pas les mêmes DROITS CIVIQUES que les pieds-noirs. Je crois que ça vaudrait la peine de réfléchir à ce simple fait pour comprendre que ce qui a démarré en 1954 n’était pas seulement une guerre civile.
Congédier l’Histoire quand elle vous embarrasse, c’est tellement commode…
Pour élargir le problème : je disais hier que le monde arabo-musulman a quelques raisons objectives d’être hostile à l’Occident. L’Empire Britannique au Moyen-Orient, c’est aussi du très lourd. Vous voulez qu’on en parle ?
Prenons du recul pour avoir une vision globale d’un problème : c’est alors, et alors seulement, qu’on voit que les problèmes nés de la création de l’état d’Israël s’inscrivent dans une Histoire infiniment plus large, et que ce problème a une étymologie : il puise ses racines, entre autres, dans la façon quelque peu cavalière (euphémisme) qu’a eu et qu’a encore l’Occident de considérer le monde arabo-musulman.
Pourquoi cela, qui me semble évident et somme toute plein de bon sens, apparaît-il à certains comme une élucubration mythologico-gazeuse ? Mystère, mystère…
Dugong 2 septembre 2025 à 9h46
Lu dans l’Osservatore Ecolo
« Dette oblige, le gouvernement en sursis de François Bayrou est à la recherche de 44 milliards d’euros d’économie pour l’année à venir…
Dette oblige…et augmentation des dépenses militaires oblige.
(On rappelle qu’à la demande de Trump-auquel Macron obéit comme un caniche-le budger de l’armée va passe à 5% du budget de l’Etat.)
Rappelons aussi, que comme l’a indiqué Zelensky lors du « sommet » de Washington, les armes que l’Ukraine achète aux Américains sont payées par l’Europe. L’Amérique vend, elle
ne donne plus.
L’Europe contribue ainsi -par d’autres voies aussi- à la prospérité des Etats Unis.)
(1 septembre 2025 à 11h26 : Il n’y avait qu’une seule contrepèterie et pas deux comme annoncé, je suis désolé d’avoir fait sécher Lormier)
L’Empire Britannique au Moyen-Orient, c’est aussi du très lourd. Vous voulez qu’on en parle ?
Pourquoi pas ? Un empire commet toujours des fautes et parfois des crimes. Mais cela vaut pour tous les empires et même les dominations de moindre envergure. Et je ne vois pas de crime majeur des Britanniques au Moyen Orient. Mais je n’ai pas tout en tête.
Je reviendrai peut etre sur cette idée des crimes de l’Europe ou de l’occident, qui selon vous, justifieraient la haine des non occidentaux.
Heureusement que les Occidentaux sont plus oublieux, sinon les Suedois ne pourraient pas visiter l’Alsace sans prendre des pierres, ou les Espagnols dépenser leurs euros a Anvers..
Ni oubli, ni pardon;devoir de mémoire:
Stanislas Nordey ,étron puant, a dit à Libé:
« Je pense en tout cas que les artistes ont pour mission d’être à l’avant-garde d’un certain nombre de choses et qu’ils sont censés être des éclaireurs, donc autant continuer à l’être d’une autre manière. »
Ceci est un commentaire de son initiative vaccinolâtre:faire signer par 200 membres du show biz une tribune appelant les Français à se faire injecter une substance expérimentale.
Parler d’avant-garde quand on est un obscurantiste vendu au pouvoir !
L’unique motivation de l’étron puant ? Pouvoir rouvrir son théâtre,c’est le marché conclu avec Macron.
Vénalité et obscurantisme;refus de se poser la moindre question sur le fonctionnement du prétendu vaccin, refus de considérer leprincipe fondamental du droit dela peronne à disposer de son corps.
Quant à se prendre pour un éclaireur…à estimer que cela va de soi,cela rappelle un peu les prétentions des narratologues-crapules à instructionner les autres.
https://www.liberation.fr/france/2021/01/07/l-appel-de-stanislas-nordey-et-de-200-artistes-pour-la-vaccination-c-est-le-seul-moyen-de-sortir-de-_1810594/
L’instructionnisme, c’est simple.
Il y a celui qui sait, et ceux qui ne savent pas.
Celui qui sait transmet ce qu’il sait à ceux qui ne savent pas. Il arrive même que ceux qui ne savent pas demandent à celui qui sait de transmettre ce qu’il sait.
Lormier voudrait sans doute que celui qui sait transmette son savoir en y mettant les formes, en usant d’exquises courtoisie, en caressant dans le sens du poil celui qui ne sait pas, pour éviter de le vexer.
Bref, Lormier voudrait que l’instructionnisme prenne des apparences meirieusardes.
C’est du joli !
exquise sans S.
« Le «Great Trust », ce projet étudié par l’Administration Trump pour transformer Gaza en «Riviera» » (lefigaro) – (😁)
« Sur le document Intitulé « The Great Trust »,
pour « Gaza Reconstitution, Economic, Acceleration and Transformation » qui circulerait à Washington,
des tours futuristes et des supertankers au mouillage montrent
une bande de Gaza aux allures de Dubaï méditerranéenne. »
Le plan dévoilé par le Washington Post révèle un document de 38 pages qui envisage la transformation totale de la bande de Gaza et son évacuation.
Ce sont six villes en forme de « parts de tarte. »
Reliées par le boulevard périphérique « Mohammed Ben Salman » (!)
et l’autoroute « Mohammed Ben Zayed », du nom des dirigeants saoudiens et émiriens,
Petits rappels :
– Pour les pays du Golfe, primauté est donnée aux affaires, business côté Ouest, comme Est, y compris redémarrage des accords d’Abraham ;
– les ayatollahs commencent à sérieusement avoir du plomb dans l’aile ;
– l’Indonésie, sous la coupe de Xi, et autres, sera forcée de se faire discrète ;
– l’Algérie, maintenant affilié aux BRICS, et business florissant, entre autre avec l’Italie,
n’emmerdera plus que
la France,
ainsi que les islamisés sub-sahariens (…), n’ayant rien à gagner (!) ici – les petits blancs locaux tirant, pour beaucoup, le… diable par la queue -,
tout comme ils emmerdent le RU – certains… en particulier Pakis, devraient être reconduits très loin des frontières,
de même qu’ici les… OQTF.
L’Europe de l’ouest continue donc de s’en prendre plein la figure, de tous côtés (!)
et sans protester.
https://i.f1g.fr/media/cms/704x396_cropupscale/2025/09/01/4df17a0316de723107594960a9915d5539bc1d80663d4113ce86a104c574b153.jpg
Le post du lointain lecteur de 9h10 a aussi le mérite de rappeler que la notion d’ « ennemi héréditaire » est toxique, mortifère, et que quand on fait preuve d’un minimum d’intelligence on peut mettre en sourdine ces affrontements meurtriers : Ainsi France vs UK, ou bien France vs Allemagne.
Bien bien, je souscris.
Il se trouve que pour mettre fin à ces affrontements incessants et institutionnaliser ce nouvel ordre européen, des gens pas trop idiots, en France, en Allemagne et dans toute l’Europe, ont imaginé la création d’une Union Européenne.
Que croyez-vous qu’il arriva ?
Les mêmes qui voulaient la fin des affrontements meurtriers n’ont de cesse de tirer à boulets rouges sur cette UE et de se réjouir des coups qui lui sont portés. On peut donc se réjouir de la fin des guerres intra-européennes et tout mettre en œuvre pour saper les fondations de la seule organisation institutionnalisée qui assure à peu près les conditions nécessaires à cette paix en Europe.
Peut-on parler de schizophrénie ?
Oui.
Oui, bien sûr, l’UE ne fonctionne pas bien, elle a des handicaps et des tares sévères. Mais… »On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va ». Alors il faut faire avec ce qu’on a.
If you’re not with the one you love, love the one you’re with.
L’UE est (d’abord et avant tout) une création fortement encouragée par les EU – cf l’importance d’un certain Jean Monnet, banquier int’l et atlantiste.
Une UE qui s’avère de plus en plus soumise à « l’ogre »… américain,
et une monnaie, l’euro, qui ne semble pas vraiment faire le bonheur des peuples,
comme l’espérait J. Delors, en 1999 : « Les onze (!) se sont doté d’un instrument qui peut leur permettre d’avoir une croissance durable et de réduire très sensiblement le chômage. »
Exemple de bouillie pour les chats:
« La situation actuelle du Moyen-Orient a bel et bien une étymologie. »
L’étymologie, ça concerne les mots.
Lormier : « L’étymologie, ça concerne les mots. »
Oui, Lormier. Je dirai même plus : le feu ça brûle, et l’eau ça mouille.
Lormier voudrait donc que l’on bannisse du langage un petit truc pourtant bien utile qui s’appelle « la métaphore ».
Ce petit truc bien utile dont un romancier d’une certaine envergure (initials MP) disait : « Seule la métaphore peut donner une sorte d’éternité au style ».
Ce Lormier a encore tant de choses à apprendre que même les plus convaincus des instructionnistes vacillent devant l’ampleur de la tâche.
Si le Figaro se permet d’imprimer cette « déclaration » *
c’est qu’il y a de l’eau dans le gaz (après le sabotage des gazoducs).
La vérité sortira du puits, petit à petit…
Les EU s’en sortent très bien – après de très bonnes affaires là-bas, BlackRock, la famille Biden, etc, et l’achat d’armements par l’UE, et qui ne devrait que s’accentuer…
Une fois de plus donc,
c’est la faut’ à l’Europe…
On se rappelle pourtant que,
2014… : Hollande comme Merkel ont reconnu qu’ils se sont moqués de l’accord de Minsk,
tout comme l’OTAN avait promis de ne pas s’étendre à l’Est…
Ne reste plus donc que
– faire croire encore à « l’ogre »
dangereux, pour de petits Etats en quasi faillite d’Europe de l’Ouest – et sans matières premières de grand intérêt dans ses sous-sols –
– faire du spectacle en mode pschitt :
Il n’y a plus que Cramer et Merz – Starmer devrait se faire plus discret sur ordre américain,
(tiens, on n’entend plus guère la… Pologne – excepté récemment le « un avion russe a brièvement violé mardi l’espace aérien polonais, selon Varsovie »)
jusqu’à la Russie soupçonnée d’avoir brouillé le signal GPS d’un avion transportant la Hyène… en Bulgarie – visite d’une (!) usine de munitions (!) destinées à l’Ukr (!)
*
https://www.lefigaro.fr/international/cette-crise-est-le-resultat-d-un-coup-d-etat-vladimir-poutine-defend-la-guerre-en-ukraine-et-blame-l-occident-20250901
(Cramon et non Cramer !!)
Après le limogeage de Monarez,plusieurs membres du CDC démissionnent.Pourquoi?
Parce que Kennedy demande que l’ACIP et le CDC s’intéressent aux effets indésirables ds vaccins, qu’on soigne ceux qui en souffrent ou en ont souffert et qu’on les indemnise.
Les vaccinolâtres du CDC (installés par les précédents gouvernements ) ne sont pas d’accord car ils pensent qu’une telle démarche va « encourager l’hésitation vaccinale. »
C’est pourquoi ils ont démissionné.
Comme on pouvait s’y attendre la presse pro-Démocrates raconte que les démissionnaires sont la science et que Kennedy est l’anti-science.
Le terme « adverse effects » apparaît trois fois dans le document qui fixe les orientations du Comité sur l’immunisation (constitué de membres du CDC).
https://www.cdc.gov/acip/downloads/COVID19-TOR-508.pdf
WTH 2 septembre 2025 à 12h39
la Russie soupçonnée d’avoir brouillé le signal GPS d’un avion transportant la Hyène… en Bulgarie
C’est possible,techniquement, de brouiller un signal, pour un seul avion ?
Faudrait expliquer à IAL les principes de base du GPS. Mais comme il pédale dans la semoule dès l’addition des entiers, c’est mal barré…
Une réponse par oui ou par non eût suffi à Lormier.
Bonne question…
Autre bonne question : l’assassinat de l’ex président du Parlement A. Paroubiy, à Lviv :
Un coup des Popovs ? Ou, selon d’autres, le ménage commence… (Maïdan, 2014…)
« Les principes de bases » (Dugong) :
» Depuis le 29 août, Ursula von der Leyen fait la tournée des sept Etats européens frontaliers de la Russie et de la Biélorussie (Finlande, pays baltes, Pologne, Bulgarie et Roumanie),
afin de rappeler les engagements des Vingt-Sept à renforcer leurs capacités de sécurité et de défense »
(lemonde)
Les OQTF seront expulsés vers la Terre Adélie. Cette décision semblait simple et adaptée. Malheureusement les discussions avec les manchots empereur achoppent sur l’engagement des manchots de traiter en priorité leurs « propres » déchets.
Les partis bulgares d’extrême droite (Vazrazhdane et Velichie ) sont-ils manipulés par Poutine ? En tout cas des membres e ces partis ont traité Van der Leyen de nazie et ont caillassé comme des cailleras sa voiture lorsque elle est venue vister une usine d’armements qui fournit armes et munitions à l’Ukraine.
https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-visit-spotlights-bulgaria-uneasy-role-europe-arms-hub/
Breton a parlé de « grammaire de la finance »;c’est tordu mais moins que de parler d' »étymologie » des crises politiques et des pogroms.
Dans le même genre de bouillie: Attali disant que l la langue de la micro-biologie est la même que celle de l’informatique: les deux parlent de « code ».
C’est précisément ce vocabulaire confus qui est dangereux. Ca vous donne un Bancel,PDG de Moderna qui se targue de fabriquer n’importe quel vaccin en une semaine:il suffit de taper un code.
Bien sûr qu’on peut utiliser une métaphore dans un raisonnement (philosophique par exemple), mais il faut le faire avec rigueur.
Tout cela est très bien expliqué dans les « Eléments pour la lecture des textes philosophiques »
de Frédéric Cossutta, déjà cité.
Josip Crapulovic ne le lira pas parce que
i) F.Cossutta est cloutard et JC ne supporte pas les cloutards (névrose d’échec)
ii) JC ne comprend rien à la philosophie
iii) JC ne raisonne pas; en bonne crapule, il fait de la rhétorique.
Un jour peut-être Lormier comprendra que ce sont les cloutards qui, s’ils étaient mesquins (il y en a) et atteints de névrose d’échec, auraient des raisons de ne pas me supporter.
Mais Lormier ne veut pas savoir.
Mais il remet sans cesse ce sujet sur le tapis, tant ça le taraude.
On retiendra les raisons ii) et iii). C’est suffisant.
PS En tant que specimen de laboratoire,Josip Crapulovic est très intéressant. On ne se demande pas si un animal de laboratoire est « supportable ».
JG 2 septembre 2025 à 12h40
Lormier voudrait donc que l’on bannisse du langage un petit truc pourtant bien utile qui s’appelle « la métaphore ».
Encore ce « donc » incongru.
Lormier ne veut pas du tout qu’on bannisse les métaphores ;il veut seulement qu’on en fasse, dans un raisonnement historique, scientifique,philosophique…un usage rigoureux et non un usage sophistique, fallacieux. D’autre part le fonctionnement de la métaphore dans un roman est bien différent.
L’homme qui a été nommé à la tête d’un groupe de surveillance de la « désinformation médicale »:
https://x.com/i/status/1666065076502028289
https://youtube.com/shorts/gv7i0akQCAg?si=5NhobZ8lZcM6XWC_
A écouter intégralement (c’est très court).
No comment.
L’intervenant qui conteste les propos du député des Républicains est un haut-gradé de l’armée française, le Général Richoux.
« consultant défense sur LCI » : un gage de qualité !
(le colonel Goya et le général Yakovleff : autres gradés… disparus de LCI – étonnant non ?!)
WTH
2 septembre 2025 à 17h25
« consultant défense sur LCI » : un gage de qualité!
Commentaire de WTH qui ne sert strictement à rien, com’dab.
Gaza riviera mais pas pour son peuple :
https://www.lefigaro.fr/international/le-great-trust-ce-projet-etudie-par-l-administration-trump-pour-transformer-gaza-en-riviera-20250901
Les quelques qui seront autorisés à rester : chargés de l’entretien des sous-sols et parkings, ou pas ?
Ils feront venir des Philippin(e) sans papiers (puisqu’on les leur confisquera dès leur arrivée). Taillables et corvéables à merci par ceux qui n’arrêtent pas de beugler actuellement.
Le moyen-âge ne passe pas à la même vitesse partout…
De plus, la majorité des Philippins sont cathos, « donc » massacrables à volonté..
Les milliers de « travailleurs » venus… bosser au Qatar (FIFA 2022) : originaires en majorité d’Asie du Sud-Est.
(lemonde, nov 22) :
« enquête du Guardian, février 2022, non qataris morts dans le pays entre 2011 et la fin de 2020. »
(construction de toutes les infrastructures pour la Fifa)
« En s’appuyant sur les registres de décès produits par les ambassades ou services gouvernementaux de cinq pays ayant de nombreux ressortissants au Qatar (Inde, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, Pakistan),
le journal londonien a dénombré sur cette période de dix ans 6 751 décès confirmés de travailleurs,
en précisant au passage que ce nombre pourrait être nettement sous-estimé,
car il n’inclut pas les ressortissants d’autres pays (Philippines, Kenya,…) très nombreux au Qatar » !!
» If you’re not with the one you love, love the one you’re with. »
Proverbe connu sous la forme française ( qui remplace » the one » par le plus général » ce qu’on » ) : Quant on n’a pas ce qu’on aime , il faut aimer ce qu’on a . »
Applicable à toutes les situations ( domaine social, amoureux, politique et autres ), vrai proverbe conservateur, par exemple rend inutile le divorce, les » bloquons tout » , la decolonisation ..
Curieux de la part de JG.
ECHO, vous me prenez trop au sérieux. D’un côté ça me flatte, mais de l’autre ça évacue la possibilité que je sois AUSSI un petit plaisantin…
« If you’re not with the one you love, love the one you’re with », c’est pour moi le refrain d’une chanson de Stephen Stills !
Et rien de plus…
J’ai seulement voulu pousser votre formule jusqu’au bout de sa logique.
Je vous dois aussi une deconstruction de votre thèse selon laquelle les pays non occidentaux ( en fait arabo – musulmans) , d’une part, gardent memoire des méfaits innombrables des occidentaux., d’autre part, ont raison de le faire. J’espère vous démontrer qu’il s’agit d’un sophisme (ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe pas, bien évidemment).
« ont raison de le faire »?
Je ne crois pas avoir dit ça. J’ai dit : « ont DES raisonS de le faire ». Raisons qui leur ont été généreusement données par l’Occident.
Ceci me rappelle une enfant de dix ans écoutant le slogan « Les enfants ont tous DES droits » et comprenant « Les enfants on tout LES droits ». Mais cela n’a rien à voir, les commentateurs ici ont plus de dix ans, ne comprennent jamais de travers, ne sont jamais de mauvaise foi, n’ont pas d’obsessions et il paraît que certains, même, ont « fait normale »… alors…
Des raisons, oui. Soit des motivations explicables rationnellement, qui justifient un comportement, et non des manifestations impulsives et déraisonnables qui expliquent un comportement sans le justifier.
A partir du moment où vous trouvez justifiée leur attitude, je m’estime fondé à dire que , pour vous. » ils ont raison de le faire « . Je maintiens donc ma formulation.
Je vous répondrai, patience.
Mais vous avez parlé de monde arabo musulmans, ce qui dépasse de loin le cas algérien.
@ECHO
Tant que vous y êtes, ECHO, déconstruisez aussi ça :
130 ans après le début de la colonisation, la population arabo-musulmane d’Algérie n’avait toujours pas les mêmes DROITS CIVIQUES que les pieds-noirs. Je crois que ça vaudrait la peine de réfléchir à ce simple fait pour comprendre que ce qui a démarré en 1954 n’était pas seulement une guerre civile.
Il faut un peu contextualiser. Neuf millions »d’Algeriens » dont une proportion non négligeable d’illettrés (aucune stigmatisation, un simple constat), et un million de « pieds noirs » au même niveau d’instruction que la population française de 1960. Qu’aurait donné un droit de vote identique ? Qu’on ait très mal réalisé cette décolonisation c’est vrai. Mais comparée à d’autres colonies, Indochine, Maroc… il y avait en Algérie, chez les pieds noirs, une représentation de toutes les couches sociales. Ce n’étaient pas que des colons ou des fonctionnaires qui devaient être déplacés. C’est une origine du drame.
« Qu’aurait donné un droit de vote identique ? »
Donc, selon vous, la France a bien fait de ne pas appliquer le principe pourtant simple « One man = one vote » ?
Bien ou mal je ne sais pas. Ma question n’est pas morale mais organisationnelle. Comment publier les professions de foi, expliquer les enjeux, dépouiller sans risque… entre autres dans le plus profond du « bled » ? Comment garantir l’égalité des contextes entre un bureau de vote à El Biar et une mechta dans les Aures ? Sur cette question algérienne que je connais un peu et sur l’opposition occident islam je crois (eh oui ce n’est qu’une opinion) qu’on peut trouver un équilibre entre l’inacceptable mépris envers les arabes et la repentance béate.
Hcc1 : je crois (eh oui ce n’est qu’une opinion) qu’on peut trouver un équilibre entre l’inacceptable mépris envers les arabes et la repentance béate.
Je le crois aussi.
La repentance béate n’est pas mon genre, et ce d’autant moins que personnellement je n’ai rien fait qui puisse justifier le moindre repentir de ma part.
En revanche, en tant que citoyen français, je veux que mon pays regarde son histoire « droit dans les yeux » (si je puis dire), sans hypocrisie, avec lucidité.
L’histoire de la colonisation de l’Algérie par la France est encore tellement sensible que quand un journaliste parle des exactions de l’armée française dans les années 1830 (oui oui, 1830), il provoque une levée de boucliers. Ça, je n’arrive pas à m’y faire. Ça n’est pas un comportement adulte.
ECHO
2 septembre 2025 à 19h12
Je vous répondrai, patience.
Mais vous avez parlé de monde arabo musulmans, ce qui dépasse de loin le cas algérien.
Oui oui, je parle bien du monde arabo-musulman et pas seulement de l’Algérie.
Pour le problème palestinien je fais un lien avec l’ensemble du monde arabo-musulman face à l’Occident d’hier et d’aujourd’hui.
JG,
Il se trouve que pour mettre fin à ces affrontements incessants et institutionnaliser ce nouvel ordre européen, des gens pas trop idiots, en France, en Allemagne et dans toute l’Europe, ont imaginé la création d’une Union Européenne.
JG de nouveau vous étalez votre naïveté qui, je vous l’ai déjà dit, confine à la bêtise. Ce nouvel ordre européen a été porté sur les fonds baptismaux par Jean Monnet agent stipendié de la CIA, Robert Schuman exemple chimiquement pur du haut-fonctionnaire aux ordres et à l’échine souple qui vota les pleins pouvoirs à Pétain, et dont les archives personnelles de 40/44 ont miraculeusement disparues. Puis l’UE se dota d’un premier président Hallstein qui était nazi à l’insu de son plein gré comme Virenque.
Quelle est belle votre Europe!
Et ce Tartuffe de Delors qui promettait un âge d’or d’abondance, sans chômage, ni guerre grâce à l’UE….On voit le résultat aujourd’hui!
Voui ! – mon 12h59 :
« L’UE est (d’abord et avant tout) une création fortement encouragée par les EU – cf l’importance d’un certain Jean Monnet, banquier int’l et atlantiste.
Une UE qui s’avère de plus en plus soumise à « l’ogre »… américain,
et une monnaie, l’euro, qui ne semble pas vraiment faire le bonheur des peuples,
comme l’espérait J. Delors, en 1999 : « Les onze (!) se sont doté d’un instrument qui peut leur permettre d’avoir une croissance durable et de réduire très sensiblement le chômage. »
J’ai toujours souhaité une Europe forte. Et je continue à dire que le problème n’est pas qu’il y a trop d’Europe, mais au contraire qu’il n’y en pas assez.
Je souhaite qu’on passe le plus vite possible à une Europe Fédérale avec un exécutif fort doté de vrais pouvoirs et élu au suffrage universel par tous les peuples européens.
C’est un système qui, vous l’aurez peut-être remarqué, ne fonctionne pas trop mal outre-Atlantique…🙂
En attendant, notre UE est bancale, un peu impuissante, exaspérante par ses tergiversations. Mais je refuse de jeter le bébé avec l’eau du bain.
JG,
Si vous acceptez de ne plus faire le croasse ou le gauchiste de service je pourrais abandonner Benito pour Benoît…Brisefer, toutefois….
La notion de fédération m’a toujours laissé dubitatif, voire perplexe…La Suisse est une fédération mais rien ne ressemble plus à un Suisse du demi-canton d’Appenzell Rhodes Intérieures (manque d’iode là-bas) qu’un Genevois. De même qu’un red-neck du Nord Texas est semblable à un White-trash des Appalaches, ceux dont est issu JD Vance et qu’il a si bien campé dans Hillbilly Elégie. Ces deux « fédérations » sont de toute évidence des états-nations aussi solides et légitimes que la France. Les USA c’est juste l’Amérique de mon oncle, même si le flingue est autorisé.
La Suisse s’appelle Confédération Helvétique mais finalement c’est juste une Suisse comme le sont l’Espagne ou le Sénégal. Et les USA, l’archétype de la fédération, cf. FBI, c’est juste un grand et unique pays où il y a des régionalismes particulièrement marqués, mais globalement le bobo de NYC, celui de LA ou l’écrivain à succès exilé au Montana sont un même peuple. Y’a bien quelques différences à la marge entre « open carry » et « concealed carry » et le droit de fumer un joint thérapeutique parce que l’on s’est retourné un ongle mais de l’Alaska à Hawaï c’est des amerloques, ce qui ne sera jamais le cas de l’UE surtout si on y incorpore de force les turcs.
Ce ne sera jamais le cas de l’UE car des millions de pages de traités ne feront jamais nation, il faut des siècles de sang, de douleur, de victoire, d’espoir et de vision pour cela…
Je suis né italien, puis ai choisi de devenir français par le service national, je pourrais verser mon sang pour ces deux pays mais jamais pour Bruxelles ou Strasbourg, et je n’ai rien à voir avec l’Allemagne. Les européens, géographiques, qui me sont les plus proches, à tous points de vue, ce sont les glaouchs, nos ennemies héréditaires, ces fils de pute qui ont brûlé Jeanne d’Arc, coulé notre flotte, saboté le marché commun, pompé les subventions agricoles de l’UE, et nous ont battus à Trafalgar.
Jamais je ne serai européen.
Réponse rapide mais ferme : l’Europe n’a pas besoin de gens comme vous pour se faire.
Elle se fera donc sans vous.
Ça prendra le temps qu’il faudra, mais ça se fera.
JG
Si réellement vous croyez que l’UE fera nation c’est que vous êtes totalement perdu… Et qu’en dépit de votre fabuleuse formation académique, bien supérieure à celle d’un vieux cloutard, vous ne connaissez rien aux Hommes…
Il faudra que les porte-avions européens puissent évoluer sans toucher les bords dans la petite France à Strasbourg…
Je ne sais pas si l’Europe peut faire nation (culturellement elle le peut), mais je sais qu’elle peut faire Union Fédérale.
Je ne vois à vrai dire qu’un seul problème très épineux, dont la solution est loin d’être évidente même à moyen terme, c’est le problème linguistique : trouver et adopter une langue commune.
abcmaths 2 septembre 2025 à 11h51
(1 septembre 2025 à 11h26 : Il n’y avait qu’une seule contrepèterie et pas deux comme annoncé, je suis désolé d’avoir fait sécher Lormier)
Merci pour votre contrition…Ne soyez pas trop désolé:je n’ai pas séché longtemps,car après avoir résolu une contrepéterie, j’ai oublié qu’il y en avait une autre.
Un Lointain Lecteur 2 septembre 2025 à 22h26
Ce nouvel ordre européen a été porté sur les fonds baptismaux par Jean Monnet agent stipendié de la CIA, Robert Schuman exemple chimiquement pur du haut-fonctionnaire aux ordres et à l’échine souple
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a) L’idéologie qui sous-tend l’institution n’est pas très reluisante…
voir:
The Tainted Source: The Undemocratic Origins of the European Idea
John Laughland
b) Quand on voit comment fonctionne cette union, on n’a qu’une envie,c’est qu’elle se dissolve; on pourrait remonte loin, mais regardons le présent et le passé récent.
Van der Leyen se comporte comme si elle était la chef de tout. Elle va visiter des usines d’armement, déclare qu’il faut se préparer à la guerre etc.
Pendant le covid, l’Union Européenne ne s’est guère soucié du droit fondamental de la personne humaine à disposer de son corps; Très peu de députés ont posé des questions sur les vaccins. Van der Leyen a passé commande directement à Bourla. On nesait toujours pas ce qu’ils se sont dit ou écrit.
« John Laughland » un nom qui prête à rire
Martin Zizi aussi.
IAL est resté très enfant…
Union européenne:le Premier Ministre de Slovaquie, à Pékin, converse en présence de journalistes avec Poutine.
il se réjouit d’acheter du gaz aux Riusses, espère que les Russes vont venir collaborer à la construction d’une nouvlle centrale nucléaire, approuve les vues de Poutine siur l’OTAN et l’Ukraine.
Bref, ce Fico est un dissident.
https://www.youtube.com/watch?v=cxhkER83nn0
Ca yest:on sait comment les Russes ont brouillé le GPS d’Ursula
(légende de l’image: »Vas y, c’est l’avion d’Ursula.)
https://pbs.twimg.com/media/Gz15Vn8WcAA4Q28?format=jpg&name=small
Les Russes ont, très tôt, compris que le bricolage est souvent plus performant que la demande par voie hiérarchique de la pièce 965/ter/O/Vanessian/314
Pièce dont le centre de Vladivostok dispose de 5 exemplaires dans que personne ne sache pourquoi…
Sur la photo, on distingue la partie centrale du dispositif, un tambour de machine à laver. Tambour qui fait partie du patrimoine que le Peuhls trimbalent et, surtout, exhibent fièrement lors de leurs pérégrinations.
Un lointain lecteur
» rien ne ressemble plus à un Suisse du demi-canton d’Appenzell Rhodes Intérieures (manque d’iode là-bas) qu’un Genevois. De même qu’un red-neck du Nord Texas est semblable à un White-trash des Appalaches ».
Peut-être un peu sollicité pour les besoins de la cause. Les Suisses parlent volontiers du rostigraben ( il y a peut être un tréma quelque part) pour désigner le » fossé » entre Suisses francophones et Suisses alemaniques ( le rosti est un plat typique de Suisse alemanique ) et chaque » canton » chérit a raison son identité et ses différences : il y a presque partout un hymne cantonal, les jours de fêtes différent selon les cantons, certains cantons portent officiellement l’appellation de république, d’autres prennent celui d’Etat ( allez sur internet par exemple et vous trouverez l’administration de Vaud sous le nom d’Etat de Vaud), l’acquisition de la nationalité suisse est en fait l’acquisition de la nationalité cantonale, les nouveaux citoyens et les fonctionnaires prêtent double serment au canton et a la Confédération etc.
Rien a voir avec les États tracés à la regle des USA où des pionniers que rien ne différenciait se sont retrouvés appartenir à un Etat plus qu’un autre, avec quelques exceptions historiques ( Louisiane …)
Bref comme dans une chanson de Sardou les Suisses ont trouvé le moyen d’allier, non l’autorite et le charme, mais l’union ( ou l’unité) et la différence acceptée et revendiquée.
Oui, mais un Helvète est un Helvète et quelle que soit la langue dans laquelle vous dites « Confédération » (« helvétique » est sous-entendu) tout Suisse se reconnaît comme y appartenant.
Quand je croise en France un Suisse ou une Suissesse, je ne dis pas: « ah, vous êtes suisse! » mais: « vous venez de la Confédération ».
Aux bains d’Ovronnaz,on m’a demandé ma carte d’identité avant de me remettre un peignoir;cette carte allait être conservée par la direction jusqu’à la restitution du peignoir.
Alors j’ai dit: »en somme, si je ne rends pas le peignoir, je ne peux pas sortir de la Confédération ? »
C’est comme ça qu’on parle aux Suisses,c’est comme ça qu’on leur fait oublier (un peu) qu’on est un troud’cul de Français.
Dans les courriers que le gouvernement fédéral adresse aux cantons, la formule de politesse est Chers Confédérés,
Il y a quelques années une députée avait protesté et demandé qu’on ecrive Chères et chers Confédérés.
Le gouvernement avait répondu que l’expresion désignait les cantons et non les individus.
Un Lointain Lecteur 2 septembre 2025 à 22h26
« … de nouveau vous étalez votre naïveté qui, je vous l’ai déjà dit, confine à la bêtise »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le problème de la naïveté:le cas Villani
Villani n’est ni bête, ni névrosé, ni une crapule. (Il a eu,il est vrai une courte période de crapulerie,lorsque il s’est acoquiné avec la Uber-krapule Blanquer…mais son intelligence lui a permis d’en sortir vite).
Villani vient de donner au journal l’Humanité un billet intitulé Mathématique de la vie et de la mort où il commente la rencontre d’Alpbach (Tyrol) .
Quelques extraits
depuis quatre-vingts ans cette discipline[la mathématique] n’a jamais été aussi intriquée avec la géopolitique. Depuis le front ukrainien jusqu’au massacre de Gaza, et dans les arrière-boutiques de défense partout dans le monde, on affine les drones d’inspection et combat, les programmes de cyberattaque et propagande, et la mort algorithmisée.
Selon un général américain, l’intelligence artificielle est en train d’apporter la plus vaste transformation de la guerre jamais vue – juste au moment où les grandes puissances débordent de pulsions de domination et où l’Europe est bombardée par la Russie, rongée en interne par l’extrême droite, et si dépendante d’une Amérique qui se fascise à grande vitesse.
Si c’est pas naïf tout ça !
Gaza, Gaza …L’Histoire commence à Gaza !
C’est bizarre parce que les pro-palestiniens nous répètent que le conflit Israël/Hamas ne commence pas le 7 octobre;certains remontent même aux croisades,au grand Mongol, voire à Romulus et Remus.
Mais Cédric Villani ne connaît rien qui précède Gaza.
Et le reste du monde ?
« l’Europe est bombardée par la Russie »
Alors là…je m’inquiète; Cédric Villani (qui fréquente ou fréquentait les « rave parties » aurait-il essayé le peyotl ?
l’Europe est … rongée en interne par l’extrême droite
Bon, ça c’est un cliché, le cliché qui a servi à faire passer Macron…Normal que Villani ne sache pas que Virginie Joron (de l’extrême droite) s’est battue, aux côtés de Michèle Rivasi (écologiste) contre la montée du néo-mengeléisme.
Villani est vaccinolâtre (ou en tout cas l’a été );il n’a pas bougé le petit doigt pour défendre Amin Umlil révoqué pour avoir dit la vérité à une commission présidée par Villani.
« une Amérique qui se fascise à grande vitesse. »
Le pompon:à peu près comme crier: CRS SS
La naïveté de Villani crée-t-elle un danger ? Je ne sais pas. En tout cas c’est moins dangereux que la crapulerie des dirigeants.
https://www.humanite.fr/sciences/cedric-villani/mathematique-de-la-vie-et-de-la-mort
(Villani n’exhibe plus de broche arachnéenne ; son araignée il l’a maintenant au plafond, épicétou)
Les slogans et maximes qu’on n’a jamais encore proférés (suite)
« La Suisse, c’est l’Afghanistan de l’Europe »
L’expression.
Bien sûr on peut aussi utiliser l’expression dans des discours officiels pour parler des individus
Exemple
Fully, 31.07.2025 — Allocution de M. le Conseiller fédéral Guy Parmelin Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à l’occasion de la Fête nationale 2025 Fully, le jeudi 31 juillet 2025
Seule la version orale fait foi !
Chères Confédérées, chers Confédérés,
Chers amis valaisans, Chers hôtes de passage, Mesdames et Messieurs, J’apprécie sincèrement de me voir offrir le privilège de m’exprimer ce soir à Fully, sur ce terroir granitique qui rend la Petite Arvine si fine et si élégante, et ses consommateurs robustes et vifs d’esprit.
Je suis heureux que notre Fête nationale favorise l’oecuménisme en offrant à un vigneron vaudois l’occasion de faire l’éloge des vins valaisans et de souligner les vertus ancestrales et nobles du Vieux-Pays, vertus qui sont aussi celles de la Suisse moderne.
Etc
https://www.bag.admin.ch/de/newnsb/q7eZdABrHncHCH7vFAJhi
Fait suite à mon message
ECHO 3 septembre 2025 à 9h53
Le journal va t il surnager ?
L’huma s’embarque ( du moins un journaliste) sur la Sumud Flotilla
https://youtube.com/shorts/m-RsfJIUINU?si=uJglDhCgtiAgWszL
Ils s’entourent d’« énormément de précautions »,
« énormément de juristes travaillent avec les équipages, pour leur dire comment se comporter »,
s’assurent de la « protection diplomatique, « consulaire »,
« le monde entier réuni », etc…
(« codes » au lieu de « côtes » gazaouis –
et le gus qui cause, mal, où qu’il est son keffieh ?!
Code NATO : No Action, Talk Only – que nenni avec de pareils couillus !)
Et le gus qui cause, mal, où qu’il est son keffieh ?!
Il est utilisé momentanément pour nettoyer la table apres le repas vegan servi aux militants.
Le front n’est plus ce qu’il était (suite)
On connaissait la guerre par procuration, voilà la guerre par précaution
Un Lointain Lecteur 3 septembre 2025 à 8h49
JG
« en dépit de votre fabuleuse formation académique, bien supérieure à celle d’un vieux cloutard, vous ne connaissez rien aux Hommes… »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cette phrase ironique est à mettre en rapport avec quelques déclarations du petit péteux:
exemples:
JG 29 août 2025 à 13h51
ma douce et tendre épouse … connaît mon CV…
il existe d’autres ENS que Saint-Cloud, d’autres Grandes Ecoles prestigieuses, peut-être encore plus prestigieuses que Normale Sup, en France mais aussi à l’étrange
JG 2 septembre 2025 à 13h35
ce sont les cloutards qui, s’ils étaient mesquins (il y en a) et atteints de névrose d’échec, auraient des raisons de ne pas me supporter.
Septembre, saison des listes.
Aujourd’hui, liste d’ordures néonazies appartenant à diverses professions du soin: médecins,infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes.
Les ordures figurant sur cette liste ont des repsonsabilités dans des ordres professionnels;
Devoir de mémoire;ni oubli ni pardon.
=========================================================
Les Ordres des professions de santé
appellent l’ensemble des soignants à se faire vacciner
Paris, le 7 mars 2021,
… aujourd’hui, les ordres des professions de santé appellent d’une seule voix l’ensemble des soignants à se faire vacciner. …
Pour rappel, tous les professionnels de santé peuvent aujourd’hui avoir accès au vaccin, quel que soit leur âge et leur état de santé. Des doses leurs ont été spécifiquement réservées et continueront à l’être. Comme l’ont indiqué hier M. Jean CASTEX, Premier ministre et M. Olivier VERAN, ministre des Solidarités et de la Santé, le vaccin Astra Zeneca, qui est proposé aux soignants les plus jeunes et en bonne santé, est sûr et son efficacité est amplement démontrée par les études réalisées en Israël et en Grande Bretagne où il a été largement administré. Rien ne s’oppose donc désormais à ce qu’ils accèdent à la vaccination et nous en appellerons directement aux pouvoirs publics si tel n’était pas le cas.
Signataires :
Patrick BOUET, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins
Anne-Marie CURAT, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes
Patrick CHAMBOREDON, Président du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers
Serge FOURNIER, Président du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes
Pascale MATHIEU, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
Eric PROU, Président du Conseil National de l’Ordre des Pédicures-Podologues
Carine WOLF-THAL, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
========================================================
Vous avez bien lu:ils appellent leurs confrères à se faire vacciner à l’Astra Zeneca !
Et ils en appelleront « aux pouvoirs publics » s’il y a des réfractaires !
https://www.ordre-infirmiers.fr/les-ordres-des-professions-de-sante-appellent-l-ensemble-des-soignants-a-se-faire-vacciner
Le premier mort connu de l’injection d’Astr Zenca s’appellle.Anthony Rio. Il y en a eu d’autres,jusqu’à ce que le Ministre décide de retirer ce produit des étagères.
https://www.20minutes.fr/sante/4083289-20240326-covid-19-parents-etudiant-mort-apres-injection-astrazeneca-veulent-savoir-verite
NB AZ n’est pas un vaccin à ARN messager,c’est un vaccin à « vecteur » viral. Le messsage est apporté par ce »vecteur » aux cellules et déclenche la production de prtéines pathogènes (comme le font les vaccins à ARN messager).
(à écouter, éventuellement)
https://www.youtube.com/watch?v=96m93ZF0F6g&t=6122s
WTH 3 septembre 2025 à 12h02
(Villani n’exhibe plus de broche arachnéenne ; son araignée il l’a maintenant au plafond, épicétou)
En êtes-vous sûre ?
Son intermède en politique,lui aura au moins fourni l’occasion de quitter sa femme-épouvantail-à-moineaux et d’en trouver une autre,sans doute plus présentable (mais il la cache).
D’où l’usage fréquent d’un « safe word » qui interrompt toute pratique que l’Autre juge, en cet instant, insoutenable. L’ignorer équivaut à une rupture de contrat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En cas de « rupture de contrat », que se passe-t-il ?
La Soumise est déliée de toute obligation et peut aller se faire battre ailleurs.
L’avenir de Gaza ?
38 pages de « Great Trust » (Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation)…
« From a Demolished Iranian Proxy to a Prosperous Abrahamic Ally » ! 😁
Introducing :
Saudi binladin group
Arabian construction co
Futtaim group
Ikea
Tetra Tech inc
Rms Uxo ltd
Wasco
Academi Aegis
Dyn corp int’l
Ake group
Mag aerospace
Caci
Gas
Mission Essential
AdvanFort
Education Above All
Karmod
Blumont
Aecom
Etisalat
Ihcc (.sa)
Systra (!)
Tesla
Aws (Amazon web services)
Tsmc (Taïwan…)
Mandarin oriental (hotels)
Ihg (hotels & resorts)
[cf aussi : « Tony Blair’s staff took part in ’Gaza Riviera’ project with BCG », Financial times, 07/07/25 –
« Tony Blair thinktank worked with project developing ‘Trump Riviera’ Gaza plan » – the Guardian, 07/07/25 –
(« Fondation T. Blair » ; Bcg : Boston Consulting group ; Img: int’l marketing group)]
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/the_great_trust.pdf
Et Vinci ?!
(ni veni ni vidi ni vici)
Un motif bien connu de la crapulerie: l’appât du gain.
Des lanceurs d’alerte ont rendu public un document qui aurait circulé entre les membres d’un conglomérat de crapules (appelé BIO) ayant des responsabilités chez et de gros intérêts dans Big Pharrma.
En gros:plan pour se débarrasser de Kennedy Soyons prudent:toutes les véfications nécessaires n’ont pas encore été faites.
Je donne quand même un extrait:
The Plot Exposed
The document opens with a blunt political calculation: Kennedy’s candidacy threatens investor confidence, regulatory predictability, and the long-term viability of the vaccine business. BIO leadership in the apparent leaked document states plainly: “It is time to go to The Hill and lobby that it is time for RFK Jr to go.”
…
as Vaxcyte COO Jim Wassil apparently warned, “investors have stated they are leaving until the next data readout,” citing Kennedy’s “unpredictability” as a systemic disruption to the vaccine capital pipeline.
Given Kennedy’s demand for restored liability, long-term data, and placebo-controlled trials, BIO appears to view Kennedy’s proposals as a threat to the entire shortcut pipeline BIO built under EUA conditions.
https://brownstone.org/articles/the-plot-to-get-rfk/
Dugong 3 septembre 2025 à 13h04
IAL est resté très enfant…
Beaucoup d’adultes rigolent quand ils lisent des commentaires de Martin Zizi, l’affublant de surnoms tels que « zigounette ».
Tordant
« Tordant » !!
… Et tandis que le « Tony Blair thinktank » (comme bien d’autres) se penchent sur des questions hautement lucratives,
« La Fondation Jean-Jaurès vient de publier une note intitulée ‘Le capitalisme de la solitude à l’assaut des liens humains’…
De Tinder à TikTok, les plateformes en ligne organisent la solitude pour en capter les bénéfices »
(lefigaro).
La Fondation :
« Dans sa troisième note de la série ‘La nouvelle condition sociale’,
après celles consacrées au sommeil et à la sédentarité,
Paul Klotz alerte sur ce qu’il nomme le « capitalisme de la solitude », un système qui fragilise les liens humains, creuse les inégalités et coûte des milliards à la collectivité.
Il plaide pour que la lutte contre l’isolement devienne une priorité politique,
avec la création d’un véritable service public du lien social,
afin de restaurer la cohésion et l’émancipation collectives.
Dugong 3 septembre 2025 à 9h05
« John Laughland » un nom qui prête à rire
Dugong 3 septembre 2025 à 16h35
Tordant
Business is business (suite) –
– Critical Metals corp.
– Tanbreez (Australie – « Mining forGreener Technologies »)
– « The BFS work is being led by Danish engineering firm NIRAS » (Bfs : bankable feasibility study) – (Niras – « Sustainable progress of society ») *
‘Heureusement que le Sinistre Barrot récemment en visite au Groenland a exprimé la « solidarité » de la France.
*
https://www.mining.com/critical-metals-says-tanbreez-feasibility-on-course-for-q4-completion/
En cas de « rupture de contrat », que se passe-t-il ?
Jean-Paul Brighelli 3 septembre 2025 à 17h07
La Soumise est déliée de toute obligation et peut aller se faire battre ailleurs.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Ruture de contrat:le latex et l’hippopotame:
Elle raconte s’être rendue chez sa victime avec son sac et son matériel sadomasochiste Sur place, ils boivent un coca, mangent du gâteau. «Comme deux enfants.» Ensuite, ajoute-t-elle, Edouard s’allonge sur le lit. il lui demande de l’aider à enfiler sa combinaison de latex.
«J’avais encore l’impression d’être utilisée, de ne rien pouvoir lui refuser.» Puis vient la phrase qui fait tout exploser. «En l’entendant me dire un million c’est cher payé pour une pute, j’ai compris . Comme un automate, décrit Cécile B., elle est allée chercher une arme avant de lui tirer une balle entre les deux yeux. Puis encore trois autres. «En le voyant allongé par terre, j’ai eu peur qu’il souffre. C’est pour cela que j’ai tiré plusieurs fois. L’image de l’agonie d’un hippopotame en Afrique m’était revenue à à l’esprit.»
https://www.letemps.ch/suisse/edouard-stern-mort-vecu
Un hippo en combinaison latex, c’est de la souffrance animale augmentée, non ?
Funny culaires : les touristes sont priés de se lever le cul à partir de dorénavant.
Dans l’article du Temps cité par Lormier
» Sur l’insistance de Me Marc Bonnant, l’avocat de la famille Stern… »
Marc Bonnant , avocat genevois bien connu .
Extrait d’une interview
:
» Au gré de la vie, il y a aussi des choses que vous ne plaideriez plus. A 20 ans, je pouvais plaider pour un violeur. Depuis que j’ai eu des filles, cela a été plus difficile. Je pouvais plaider pour un gauchiste. Depuis que ma sensibilité droitière s’est affirmée, je ne le voudrais plus. Je le pourrais sans doute, mais je ne le voudrais plus. »
https://leregardlibre.com/forum/marc-bonnant-avocat-interview/
Ca nous manquait. Bientôt ce genre de « profil » sur le continent ?
https://reporterre.net/Zack-Polanski-un-electron-libre-propulse-a-la-tete-des-Verts-anglais
Voui. Un clown de théâtre, en mode Zélensk’, et qui a fait ses études sur les planches, en Géorgie.
Non, pas celle de l’Est, celle de l’Ouest, où il a découvert…
« les inégalités et le racisme », inexistants, comme chacun sait, en GB.
« Végane, gay et juif, il compte sur son expérience d’acteur pour adopter une politique au style direct, qui revendique le besoin de « raconter des histoires » pour capter l’électorat ».
Aucune chance qu’il fasse aussi bien que Mr. Bean.
Bien qu’en ne « racontant » en effet « que des histoires », allez savoir !
Que des histoires, autrement dit que des salades, voire même accompagnées de quelques lancers de tomates ;
quoi de plus cool pour un green ?
Lu dans l’Osservatore Ecolo : » Ce qui pose problème aux gens, ce sont les centrales syndicales, qu’ils trouvent trop molles à l’échelle nationale. »
Les centrales à charbon bien solide fabriquent du dioxyde de carbone bien gazeux. Liquider les centrales à charbon, oui mais comment ?
Lormier,
« …juste au moment où les grandes puissances débordent de pulsions de domination et où l’Europe est bombardée par la Russie, rongée en interne par l’extrême droite, et si dépendante d’une Amérique qui se fascise à grande vitesse. »
Je n’aurais pas l’outrecuidance de mesurer mon maigre encéphale à celui de Villani qui est certainement en vibranium chromé alors que le mien n’est que vulgaire ferraille.
Mais sa brève incursion dans le fange politicienne parisienne a été un désastre, un naufrage. Un gus dont l’esprit se meut à une vitesse proche de c dans la stratosphère des mathématiques était incapable de résoudre un truc aussi simple que le vandalisme des Vélib…
On peut-être très très intelligent, et Villani l’est assurément, et « en même temps » totalement dénué de sens commun.
Sur un plan plus subjectif son accoutrement soigneusement choisi et mis en scène m’a toujours inspiré beaucoup de défiance à l’égard de ce personnage, d’autant plus que Klein l’a imité assez rapidement.
Gothendieck, lui ne faisant pas semblant.
Klein (et Reeves) sont des créatures médiatiques. Pas Grothendieck (de son vivant)
« Un gus dont l’esprit se meut à une vitesse proche de c dans la stratosphère des mathématiques était incapable de résoudre un truc aussi simple que le vandalisme des Vélib…
On peut-être très très intelligent, et Villani l’est assurément, et « en même temps » totalement dénué de sens commun. »
Admirable illustration par le Lointain Lecteur de ce que Barthes appelait « anti-intellectualisme poujadiste. » Car pour Poujade, l’antidote aux méfaits des intellectuels, c’était ce « sens commun » dont se réclame le Lointain Lecteur.
Admirable confort du néant.
le vandalisme des Vélib a été résolu par leur disparition
lls n’ont pas disparu.
Où sont-ils maintenant ?
Pardon, Grothendieck.
Lu dans les archives Grothendieck cet éloge de la chèvre, vecteur du rayonnement des mathématiques couchées dans le réel matériel :
« Le dépoussiérage intégral du fonds a été réalisé à l’aide de balayettes en poil de cheval et de chèvre, ainsi que d’éponges en latex, selon les prescriptions de la Bibliothèque nationale de France datant de mai 2003. Outre l’intérêt lié à la conservation des documents papier, cette opération a permis de préserver la santé des agents chargés de la numérisation mais également le matériel utilisé, notamment le scanner professionnel. »
https://grothendieck.umontpellier.fr/
Que dit Villani ?
– les grandes puissances débordent de pulsions de domination
– l’Europe est bombardée par la Russie
– l’Amérique se fascise à grande vitesse.
Ces trois affirmations sont aisément vérifiables. Si ça vous intéresse vraiment, un simple citoyen comme votre serviteur peut très facilement vous en donner quelques exemples/preuves.
Mais est-ce que ça vous intéresse vraiment ? J’en doute fort quand je vois à quel niveau vestimentaire et symbolique se situent les critiques envers Villani venant de Lormier et du Lointain Lecteur.
Ils sont bien embêtés, d’ailleurs, Lormier et le Lointain Lecteur. Ils sont bien obligés d’admettre que Villani est extrêmement intelligent, beaucoup plus qu’eux-mêmes. Mais quand Villani balance 3 vérités qui les défrisent, comme ils ne peuvent pas contester son intelligence, ils l’attaquent sur autre chose.
En bien ça, voyez-vous Mesdames et Messieurs, c’est la marque de fabrique de la fachosphère depuis toujours. Ça en est la minable signature.
On trouvera ici la réponse à une question qui se pose au quotidien en ces lieux :
https://www.lemonde.fr/intimites/article/2025/09/04/le-dilemme-peut-on-insulter-un-robot_6638829_6190330.html
Le petit péteux (alias Josip Crapulovic) propose à Lormeir de lui donner des « preuves ».
Non merci.
Lormier sait ce quie le petit péteux appelle « preuves »;alors, une foius encore, très sincèrement ,non merci.
Lormier, mon pauvre Lormier, quo usque non descenderes ?
Dugong 4 septembre 2025 à 9h49
Lu dans les archives Grothendieck cet éloge de la chèvre…
A Montpellier où Grothendieck a enseigné, y compris à des niveaux élémentaires,il arrivait que, pour les examens,il fasse confectionner des trucs tridimensionnels en carton. (Cela était sans doute un peu plus difficile à fabriquer que les parallélipèdes rectangles de l’école primaire)
Evidemment, ces machins emmerdaient beaucoup l’administration:comment stocker ?
Apparemment, les archives n’ont pas de traces (ni des énoncés, ni des corrigés).
Grothendieck était-il doué manuellement ? (Physiquement,il était très costaud,ayant cassé la figure à un policier, mais ça n’ a rien à voir).
Des mecs très éthérés (qu’on comprend pas toujours ce qu’ils écrivent) étaient manuellement extrêmement doués. Wittgenstein était execellent mécanicien.
Mallarmé, pour ses enfants, fabriquait des jouets, des cathédrales en cartonet il prenait grand soin de son canot.
Dugong manie habilement le marteau,la truelle, le fer à souder et bien d’autres choses encore. Cela semble aussi important pour lui que de savoir jouer de la physique quantique .
Il a eu parfois ici des propos très méprisants sur les gens qui ne savent pas se servir d’un marteau.
Symétriquement, Villani cite (dans Théorème Vivant,je crois) Boris Vian.
De mémoire:
On peut dire ce qu’on veut, pour moi le type qui vous dit qu’il ne comprend rien aux
mathématiques,c’est un imbécile.
Je ne sais trop ce qu’il faut en penser.
Personnellement je me refuse par exemple ,a priori comme a posteriori , à considérer le petit péteux comme un imbécile, je l’ai déjà dit.
Cependant,il fait tant de fautes de raisonnement,il écrit de telles khonneries …que je me dis
quand même:s’il s’était essayé aux maths,il n’en serat pas là.
Beati animi simplices!
Un Lointain lecteur 4 septembre 2025 à 9h38
Sur un plan plus subjectif son accoutrement soigneusement choisi et mis en scène m’a toujours inspiré beaucoup de défiance à l’égard de ce personnage
Pourquoi ?
Il voulait se donner l’allure de Franz Liszt.
La langue de pute courante,c’est celle qui vous fait de grands sourires et dit du mal de vous derrière votre dos.
Plus rare et plus habile est celle qui s’arrange pour que vous viennent aux oreilles des propos
désobligeants t enus par un tiers et vous concernant.
Exemple:faire savoir,obliquement, à un cloutard,agrégé des Lettres et auteur d’une ouvre considérable qu’aux yeux de tel ou tel il n’est qu’un « simple agrégé ».
– mouton lobotomisé
– cuistre névrosé
– crapule narratologue
– petit péteux
– langue de pute
O fortunatos nimium, sua si bona norint, poujadistas simplicis animos !
La malveillance oblique (vicarious), Lormier en parle en spécialiste (qu’il recherche donc les raisons pour lesquelles je l’ai traité un jour de faux-cul mesquin et minable). Elle fait à tel point partie de son propre quotidien qu’il la voit partout, même chez les âmes les plus pures…
« les grandes puissances débordent de pulsions de domination » (JG) –
Cépafo ; exemple :
« La marque iconique Petit Bateau passe sous pavillon américain…
la célèbre marque française de vêtements pour enfants cédé au fonds d’investissement Regent…
Regent, dont le siège se situe en Californie, est connu pour avoir relancé plusieurs maisons dont DIM en France, Bally en Suisse ou La Senza au Canada. »
(lefigaro) (😁!)
Les fonds d’investissement investissent dans le fond de culotte. Elles y trouvent des lignes directrices
(« l’Europe est bombardée par la Russie » : re JG.
Pas que : la preuve ci-dessus, sans compter… tout le reste,
et sans compter les Xi.
‘Heureusement « Google, comme Shein géant chinois du commerce électronique, écopent de lourdes amendes de la part du régulateur français – gendarme français de la vie privée, la CNIL – pour violations des règles relatives aux cookies. »
En titre sur le figaro hier, déjà disparu aujourd’hui ! – 😁!)
Petit Bateau aurait dû s’appeler « Futur Mat »
« Lormier sait ce quie le petit péteux appelle « preuves »;alors, une foius encore, très sincèrement ,non merci. »
1. Chemin parcouru par Lormier pour désigner votre serviteur :
– mouton lobotomisé
– cuistre névrosé
– crapule narratologue
– petit péteux
Certain.e.s s’étonnent que je le considère comme un médiocre. Le commentariat jugera.
2. Lormier : « Lormier sait ce quie le petit péteux appelle « preuves »;alors, une foius encore, très sincèrement ,non merci. »
« Quo usque non descenderes ? », lui demandai-je à la suite des propos ci-dessus.
Élément de réponse : au stade actuel, il est au niveau de WTH, qui conteste ou pas les contenus en fonction de qui les lui fournit, avant même d’examiner lesdits contenus.
Lormier pourra-t-il descendre plus bas que WTH ? Il en serait bien capable, le bougre.
Toujours désopilant – sans être « tordant » :
le Business,
qui ne fait pas que dans la dentelle (de lingerie), mais aime pratiquer le mélange des genres.
Ainsi, le fond d’investissement Regent – hors culottes – fait dans d’autres fanfreluches, ayant racheté
« En 2019, la maison de couture Escada à une filiale de la multinationale Arcelor Mittal » (!)
« En 2021, la marque « Club Monaco » (!) de Ralph Lauren corp. »
Et même…
« les marques Diamondback Bicycles et Redline Bicycles et ainsi que plusieurs autres entreprises de cyclisme à la société de bicyclettes néerlandaise Accell »
(wiki)
Une expression à analyser: »créer des richesses ».
BernardArnault rachète Birkenstock ( le seul fabricant qui produise des chaussures en forme
de pied) et met en route un plan de création de richesse. Pour cela,il introduit la société en
bourse, puis pour faire grimper la valeur des actions,il modifie la gamme de produits.Il
demande à des sylistes de reprndre certains modèles ,de les redessiner (exemple,la ligne
Filson). Ces modèles seront vendus deux fois plus cher.
A terme, Arnault va éliminer les modèls anciens et transformer Birkenstock en marque de luxe aux profits élevés.
C’est ce qu’une certaine presse (suivie par beaucoup de gens) appelle « créer des richesses ».
Cette création de richesses appauvrit une masse de gens qui ne pourront plus se payer de chaussures en forme de pied.
( Ce processus déjà été mis en oeuvre à la Samaritaine ;il est en cours au Bazar de l’Hôtel de Ville, dont la faillite est organisée afin de permettre le rachat des murs.)
On affirme que la création de richesses sortira les Français de la pauvreté. Or pour acquérir des richesses, il faut payer.
Le mocassinLondon de Birkenstock,revu par Filson (ligne 1774)
https://www.birkenstock.com/fr/filson-london-moccasin-leder/londonmoccasin-filsonaw24-leder-0-rubber-u_12102.html?dwvar_londonmoccasin-filsonaw24-leder-0-rubber-u__12102_width=N&dwvar_londonmoccasin-filsonaw24-leder-0-rubber-u__12102_size=265&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=pmax&utm_campaign=evergreen-cat_FR&utm_content=Sneakers&gad_source=1&gad_campaignid=19341887933&gbraid=0AAAAADRmFooLJhamJJKP10NyoOyXp-WgW&gclid=EAIaIQobChMI1ZKTl_6-jwMVK8t5BB3IbDnxEAQYAiABEgI81vD_BwE
Qui peut porter cette horreur a 325 euros ?
Je préfère le modèle historique,mais vous verrez qu’il y aura des amateurs du Filson.
Le mocassin London « histrorique ». (mocassin en forme de pied de chez Birkenstock)
https://www.birkenstock.com/on/demandware.static/-/Sites-master-catalog/default/dwf2e97846/166541/166541.jpg
Dugong 4 septembre 2025 à 9h07
Un hippo en combinaison latex, c’est de la souffrance animale augmentée, non ?
a) La « peau de l’hippopotame est très résistante. On devrait faire des combinaisons pour motards en cuir d’hippopotame.
b) Relisez: le dom avait revêtu la combinaison au moment où la sub a décidé de l’abattre (forme radicale-voire ultime- de la rupture de contrat). Pas d’hippopotame en vue.
c) C’est l’image-souvenir d’un hippopotame agonisant (vu à la télé) qui a poussé la sub à tirer encore deux balles dans la tête du gisant pour être sûre qu’il était bien mort et ne souffrait pas.
Même si le contrat était rompu,il n’y eut pas d’inversion des rôles:ce n’est pas au dom de souffrir mais à la sub.
NB On peut souhaiter que les flagellations laissent des traces durables sur la peau du/de la
sub (durables mais pas nécessairement permanentes.)
Il est bon de savoir que des coups de fouet violents portés plus haut que les fesses peuvent endommager les reins. A bien négocier lors de l’établissement du contrat.
Lormier,
Je pense que vous vous trompez. Le gars en combinaison de latex c’est lui le sub pas celle qui tient le flingue. Le récit raconte la meurtre d’Edouard Stern par sa maîtresse, maîtresse au sens bdsm, et non pas sexuel. Un sub couche rarement avec maîtresse.
Il existe un livre qui résume assez l’affaire Le Fils du Serpent
Lormier,
Je ne pense pas que l’on fasse des combinaisons en peu d’hippopotame mais on en fait de redoutables fouets. Le sjambok qui ressemble plus à une grosse badine qu’à un fouet était l’outil de prédilection des forces de maintien de l’ordre en RSA du temps de l’apartheid. Lors de mon départ du Kenya mes employés m’en ont offert un magnifique exemplaire.
Sjambok.
Pas forcément oublié en RSA et autres Etats africains.
https://m.polity.org.za/article/saps-must-arrest-sjambok-cop-immediately-2021-01-20
Comme au Zimbabwe
https://www.africa-press.net/zimbabwe/all-news/soldiers-sjambok-villagers-after-break-in-at-minister-july-moyos-homestead
ECHO,
La sjambock, oui, très répandu en Afrique de l’Est, y compris au Kenya, Ouganda, Tanzanie mais ça reste un symbole emblématique de la répression blanche due la RSA ou de la Rhodésie, bien que les cogneurs fussent en général des Noirs.
Celui que j’ai reçu en cadeau de départ était une marque de respect teintée d’humour britannique… wewe ni kiboko yao.
Un Lointain Lecteur 4 septembre 2025 à 18h48
Lormier,
Je pense que vous vous trompez. Le gars en combinaison de latex c’est lui le sub pas celle qui tient le flingue.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oui,on voit mal pourquoi un dom mettrait une combinaison en latex…et puis vous avez lu le livre définitif sur cette affaire.
Lors du procès de Cécile Brossar (la meurtrière) les deux familles (la sienne et celle de Stern) se sont mises d’accord pour qu’on en sache le moins posible;le procès s’est peut-être déroulé à huis clos.
Stern connaissait Fabius, Sarkozy…Les Genevois n’ont pas bavardé.
L’article du Temps donne peu de détails mais laisse entendre que c’est Cécile qui subissait…
J’ai parcouru Libé et le Nouvel Obs:même impression.D’où mon erreur.
Bof:de toute façon, le contrat a été rompu…avec des conséquences légèrement plus lourdes
que celles évoquées par le Maestro.
Il y a d’ailleurs quelques articles dans la presse médicale relatant des décès ou blessures
graves provoquées par les pratiques sado-maso.
Apparemment ,les jeux les plus dangereux sont ceux qui impliquent la
respiration:étouffement, stangulation.
Je me demande comment on fait pour dire le « safe » word quand on a une balle de tennis
coincée dans le gosier et du Duct tape tout autour de la bouche et de la mâchoire…
ou quand, tout simplement le dom vous écrase un oreiller en plume d’oie sur le visage.
Dans ces conditions, l’articulation devient difficile, tous les phonologues vous le diront.
(et je ne parle pas de différences subtiles mais signifiantes telles que celle entre voyelles longues
et voyelles brèves -entre le « a » de bath et le « a » de cat.)
A propos du « safe word » ,le Maestro a ,je crois, considérablement simplifié: dans le vrai BDSM
(pas le truc des mauviettes) on continue après l’énoncé du « safe word » ou bien,il n’y en a
pas du tout, ou bien il y en a un qui n’est pas le vrai et un autre qui est plus vrai que le
premier.
Chaque fois qu’on achète une paire de chaussettes sur un site internet,il faut s’inscrire et créer un code d’accès.
Et bien sûr, à la prochaine commande on a oublié le code.
Alors pourquoi n’oublierait-on jamais le safe word ?
Pourquoi, je vous le demande ?
Duck tape;
La « communauté » BDSM est une « communauté » dans laquelle le viol est fréquent;
When safe words are ignored
Women in the bondage and kink scene are speaking out about sexual assaults in the community, and calling for change
By Tracy Clark-Flory
https://www.salon.com/2012/01/29/real_abuse_in_bdsm/
Lormier,
Certaines mises en scène bdsm empêchent la phonation, il est d’usage dans ce cas de conserver un petit objet (dé, clef, bijou, ou simple bille d’agate…) dans une main. Le laisser choir équivaut au safe word
JG
Admirable illustration par le Lointain Lecteur de ce que Barthes appelait « anti-intellectualisme poujadiste. » Car pour Poujade, l’antidote aux méfaits des intellectuels, c’était ce « sens commun » dont se réclame le Lointain Lecteur.
Admirable confort du néant.
Vous êtes stupide en niant l’existence du « sens commun » et en évoquant un « anti-intellectualisme poujadiste ». Je n’ai rien contre les « intellectuels » quoi que ce concept puisse recouvrer il semble même que la plupart des gens me classe dans cette catégorie, pas vous bien sur, pour qui je ne suis qu’un beauf bas du front adepte du manganello ou du sjambock.
Mais si vous aviez un tant soit peu suivi le bref et lamentable parcours politique de Villani acoquiné avec Hidalgaga et les plus débiles de verts parisiens vous comprendriez que l’on peut évoluer dans les plus hautes sphères éthérées et être totalement démuni face à la trivialité quotidienne. Ce type a quand même proposé de recourir à l’IA pour nettoyer les rues de Paris alors que Mouloud et Mamadou avec deux balais seraient bien plus efficaces. Il voulait, si j’ai bonne mémoire, faire une grande promenade exclusivement piétonne du centre de Paris à chez moi dans le 9-3 jusqu’au stade de France, rien que pour ça on aurait dû lui retirer sa médaille Fields.
Affaire Stern
Quelques indications
https://www.letemps.ch/suisse/cecile-b-vrai-visage-revelations?srsltid=AfmBOoresCkGbJ9p_62L7SR1fYHjTqEI8RtP0wGK5cj9CqoBWUhzzlyl
Un autre journal indique que Stern et sa future meurtrière formaient un » couple a la derive « .
Un Lointain Lecteur 5 septembre 2025 à 0h54
Lormier,
Certaines mises en scène bdsm empêchent la phonation, il est d’usage dans ce cas de conserver un petit objet (dé, clef, bijou, ou simple bille d’agate…) dans une main. Le laisser choir équivaut au safe word
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ni moquette ni tapis au sol, alors.
ECHO 4 septembre 2025 à 20h45
Sjambok.
Pas forcément oublié en RSA et autres Etats africains.
https://m.polity.org.za/article/saps-must-arrest-sjambok-cop-immediately-2021-01-20
extrait:
The Democratic Alliance (DA) is disgusted by the behaviour of a member of the South African Police Service (SAPS) captured on video beating a man with a sjambok, allegedly for not wearing a mask.
L’incident remonte à l’époque de la folie covidiste;il semblerait que le policier ait battu un homme parce qu’il ne portait pas de masque.
En France,on n’a pas de sjamboks, mais on a des matraques. Plus tard nous saurons si des fgens ont été matraqués pour avoir acheté plus de coca cola que permis.
( On a déjà des images montrant des flics et des CRS jouir de leur pouvoir. Faire appliquer des directives absurdes, bariller des ordres, cela a été le pied pour un certain nombres d’abruti(e)s en uniforme.)
Un policier de RSA accusé d’avoir battu un jeune de 13 ans suspecté de vol, avec un sjambok. Le policier est relâché sous caution.
https://iol.co.za/news/crime-and-courts/2024-10-21-cop-accused-of-assaulting-13-year-old-boy-with-sjambok-released-on-r2000-bail/
Les blessures du sjambok peuvent être mortelles , voir ci dessous.
sjambok:un mot à l’étymologie fabuleuse.
On remonte au sanscrit…शम्बूक,mot qui a plusieurs sens,dont « coquille d’escargot » Hum…
https://www.learnsanskrit.cc/translate?search=shambUka&dir=se
NB On peut aussi fabriquer un sjambok avec de la peau de rhinoceros. L’hippopotame a une peau très lisse, ce qui fait de lui un très bon nageur et plongeur;pas le rhinoceros.
Unidentified man dies after brutal sjambok attack in Free State, police seek public help
https://iol.co.za/news/crime-and-courts/2025-03-20-unidentified-man-dies-after-brutal-sjambok-attack-in-free-state-police-seek-public-help/
Free State : autrefois Etat libre d’Orange, une des provinces de RSA ( qui est un Etat fédéral) mais l’expression » d’ Orange » n’est plus en vigueur.
Après leur défaite lors de la guerre des Boers, l’Orange et le Transvaal devinrent des colonies britanniques puis des provinces de la nouvelle Union sud africaine, mais l’appellation Etat libre d’Orange fut officiellement conservée comme une marque identitaire par la population. Afrikaner. C’est cette marque identitaire que la RSA post apartheid a souhaité faire disparaître.
A Derba, si on a l’imprudence de sortir le soir de son hôtel et d’aller se promener vers l’intérieur, on risque d’être confronté à des groupes de chiens sauvages très agressifs.
Un sjambok peut alors s’avérer utile. A défaut,si comme le Maestro on en porte un, frapper avec son ceinturon.
Le ceinturon est un objet multi-usage:s’il peut servir à fouetter le derrière d’une joueuse de tennis,il peut aussi éloigner des chiens.
Moins classe quand meme que le sjambok, et puis si on enlève son ceinturon a l’exterieur, le pantalon doit tomber un peu ce qui manque d’élégance !
C’est pour ça que deux ceinturons c’est mieux (et pas de couffin)
Oui…
(réactivation des acquis de Lormier)
Djerba
On peut aussi fouetter un hippo (un seul à la fois, c’est plus prudent)
Le naïf Villani est obnubilé par Gaza au point d’avoir complètement oublié le 7 octobre.
La directive Hannibal a-t-elle été appliquée le 7 octobre et par la suite ?
https://www.youtube.com/watch?v=FcShjcjC2no
https://reporterre.net/Les-cigales-rendues-muettes-par-la-chaleur
Yaka leur changer les piles
Et en plus (Photo) : une « plébéienne » sur « le domaine de château » !
Elle compte bien faire entendre sa voix le 10 sept !
Les marques (suite) –
Lajaunie (cachous), c’est fini.
Ce n’est pas l’actroce Haenel qui reprendrait la pub, surtout devant un Depardiou !
« retirée du cinéma » (!) elle s’engage dans la « défense des droits humanitaires » et rejoindra Greta&co à bord de la Global Sumud.
https://www.youtube.com/watch?v=Z7yh5yVpxuU
Grabuge au Sénat américain, le 4 septembre:les néo-nazis veulent la peau du Ministre de la Santé. Incroyable mais vrai: Elizabeth Warren est scandalisée parce que dit-elle, à cause de Kennedy,il n’est plus si facile d’obtenir un booster anti-covid ! Il y a donc aux Etats Unis, des parlementaires vaccinolâtres qui croient encore que le vaccin anti-covid est sûr et efficace et qu’il faut se faire faire un booster !
Je ne fais pas de pronostic…je pense que la bataille est et sera rude; Comme je l’ai déjà dit, Gates ou Bourlat ont les moyens de faire assassiner Kennedy. Il n’en est pas question encore, mais s’ils voient que les campagnes d’intoxication et les manoeuvres au parlement ne suffisent pas,ils auront recours aux mesures radicales (méthode américaine).
En face des néo-nazis, il y a quand même le Sénateur Ron Johnson (d’extrême droite) qui rappelle des fairts:les morts par injection, les myocardites et qui montre combien les instances officielles sont corrompues:quand un fait est gênant, on le cache à la population;
https://www.youtube.com/watch?v=dwNZnXjimFM
Dugong 5 septembre 2025 à 12h37
On peut aussi fouetter un hippo (un seul à la fois, c’est plus prudent)
Avec un fouet en peau de rhinoceros ?
que deux ceinturons c’est mieux (et pas de couffin)
que deux seins tOUt ronds c’est mieux (et pas de cUl fin)
Pour IAL, un de ses « ambassadeurs », Durex veut développer un sextoy en peau de rhino.
Le 10 septembre nous avons Bloquons tout.
Le 13 septembre, 100 000 patriotes sont attendus à Londres, « to have their country back »
I’m not afraid to take the stand.
Une des nombreuses vidéos avec la musique de Rule Britannia
https://youtube.com/shorts/l5AVH5bWp5Q?si=bQcuXTgWkO_fLZrZ
Erreur, la vidéo annonce non 100 000 mais 1 million de patriotes.
Pendant ce temps le sympathique ( il l’est) roi visite la chambre du cardinal Newman a l’occasion de sa beatification.
Accueilli probablement par les autorités municipales ( le maire qui a l’air d’etre indien et une femme en sari) il est ensuite cornaque par les pères de l’oratoire avec leurs grandes robes noires et leurs barrettes et un conservateur des lieux presqu’aussi élégant que le roi.
https://youtu.be/7IDRHxL-y_g?si=u3el7k8ylMIrFTTH
Bientôt 48 heures sans une seule intervention de JG.
A – t-il rejoint la Global Sumud Flotilla ?
Il ne figure en tous cas parmi les VIP annoncés.
Les personnalités suivantes prennent part ou ont indiqué prendre part à cette initiative (dans l’ordre alphabétique) :
Juan Bordera, député, Espagne
Ada Colau, ancienne maire de Barcelone, Espagne
Liam Cunningham, acteur, Irlande
Alexis Deswaef, militant, Belgique
Naoise Dolan, érivaine, Irlande
Eduard Fernández, acteur, Espagne
Emma Fourreau, députée européenne, France
Bruno Gilga, militant, Brésil
Adèle Haenel, actrice, France
Mandla Mandela, chef tribal, Afrique du Sud
Marie Mesmeur, député, France
Mariana Mortágua, députée, Portugal
Thomas Portes, député, France
Susan Sarandon, actrice, États-Unis
Gustaf Skarsgård, acteur, Suède
Greta Thunberg, militante, Suède
(Wiki)
Emma Fourreau-Moulin
Y en-a-t-il qui soient a-mariné(e)s ?
Th. Portes : c’est pas un gars d’la Marine !
Un temps copain avec la Sardine R.
Cheminot à l’arrêt (un classique).
On compte sur les orques… qui s’agacent de temps à autres, en Méditerranée !
(autre)
Il ne figure pas …
Ils ont internet sur le bateau, il pourrait donc donner signe de vie.
Et qu’il ne craigne pas que Lormier le harcèle, on lui promet tous de le lâcher après quelques messages.
Oui…
(facile pour Lormier)
lâcher après quelques messages.
lEcher après quelques mAssages.
Elizabeth Warren
Je crois que c’est simplement une pauvre khonne et pas une ordure(même si elle émarge chez Big Pharma).
Elle ne comprend pas la différence entre ne pas recommander un vaccin pour toute la population et empêcher ceux qui veulent ce vaccin de se faire piquer.
Elle n’écoute pas Kennedy qui tente de lui expliquer qu’il ne recommande pas un produit pour lequel n’existe aucune donnée clinique qui justifierait cette recommandation.
Elle voudrait qu’à partir de l’âge de six mois tous les Américains reçoivent un booster anti-covid.
C’est une vaccinolâtre complètement abrutie;il suffit que sur la boîte il soit marqué « vaccin » pour qu’elle croie que c’est un vaccin , sûr, efficace, grâce auquel vous éviterez la maladie.
Aucun espoir qu’une personne comme elle se renseigne.
J’ai l’impression que la secte américaine des vaccinolâtres est beaucoup plus irréductible que celle française (on s’en rend compte queand on parcourt les commentaires de lecteurs de journaux.)
Le problème avec Elizabeth Warren est qu’elle est sénatrice,a donc du pouvoir et qu’elle participe à une cabale anti-Kennedy. Auprès d’elle,il y a de véritables crapules, bien mieux armées intellectuellement.
Elizabeth Warren n’est pas qu’un mouton lobotomisé parmi d’autres.
Tout ce monde est copieusement financé par l’industrie phramaceutique
https://www.youtube.com/watch?v=hRSq6f8dbQ4
Tout ce monde est copieusement financé par l’industrie phramaceutique
Warren took $822,573 between 2019 and 2020 from employees or PACs affiliated with pharmaceutical and health product companies, though not from the companies themselves, according to Open Secrets.
She was second only to Vermont Independent Sen. Bernie Sanders, who took $1,417,633.
Sanders and Kennedy had their own moment during the second day of the latter’s confirmation hearing when he outed Sanders for taking Big Pharma money.
Sanders defended himself against Kennedy by making the distinction that this money did not come from « the executives, » but from Big Pharma « workers. »
This seems to be the game Warren is playing here.
She may have said that she does not take money from « executives, » but Big Pharma gave her money and still does.
Whatever word games Warren and Sanders want to play, they’ve been outed. One way or another, they are effectively bought.
They take Big Pharma money and therefore oppose Kennedy to lead HHS for his opposition to Big Pharma.
https://www.msn.com/en-us/news/politics/warren-s-claim-to-be-clean-of-big-pharma-money-falls-apart-as-it-s-revealed-they-give-her-millions/ar-AA1yFMt3
« money » :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQySM7wBEDHUaosM0vZfqpJb8EEepx8_GkGccu0bHkoeuPoXP8nw0qpCX7JPDsyheE_308&usqp=CAU
abcmaths 6 septembre 2025 à 10h41
JG…A – t-il rejoint la Global Sumud Flotilla ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il était volontaire…mais Rima a opposé son veto;en effetil a commencé à faire son baratin narratologique et elle s’est dit:faut pas emmener ce mec,il va être une plaie;il va casse l’ambiance sur le bateau;il va nous faire chier dès l’embarquement.
De toute façon, Crapulovic se réserve pour les célébrations du 7 octobre à Doha.
Lors de la plandémie,on a beaucoup entendu cet argument,de la part des vaccinolâtres et
des néo-nazis:le vaccin à ARN m n’a pas d’adjuvant;il est donc bien plus sûr que les vaccins
traditionnels qui, eux, nécssitent des adjuvants pour être efficaces;pas d’adjuvant, pas
d’effet secondaire.
Les mêmes aujourd’hui traitent Kennedy de con malfaisant parce qu’il demande qu’on étudie
les effets des adjuvants (en particulier les dérivés de l’aluminium) sur les jeunes enfants
(notamment leur cerveau).
Il y a eu aux Etats Unis une rapide et énorme progression des cas d’autisme.
Cela aurait-il un rapport avec les 953 vaccins obligatoires administrés aux petits américains
entre leur premier jour d’existence à l’air libre et l’âge de six mois ?
Scandaleux de poser cette question, disent ensemble vaccinolâtres, crétins lobotomisés, néo-
nazis et « chercheurs » payés 500 000 dollars chaque année par les fabricants de vaccin.
Il n’y a aucun lien entre autisme et vaccination;cela est amplement démontré.
Mais alors s’il n’y a aucun lien et si,plus généralement les adjuvants ne présentent aucun
danger pour la santé, pourquoi vous félicitez-vous que les « vaccins » à ARN messager n’en
contiennent pas ?
ECHO 5 septembre 2025 à 11h17
Moins classe quand meme que le sjambok, et puis si on enlève son ceinturon a l’exterieur, le pantalon doit tomber un peu ce qui manque d’élégance !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vrai.
Mais
a) S’il s’agit d’éviter de se faire déchiqueter par une meute de chiens sauvages affamés,on peut renoncer provisoirement à l’élégance.
b) Quand le ceinturon sert à une flagellation pré-enculatoire,il y a bien un moment où on le retire du pantalon…avant de retirer le pantalon lui-même (je veux bien que ceratins partiquent à braguette ouverte mais enfin ce n’est pas courant.)
c) Il est vvrai que pendant la marche,un pantalon a tendance à glisser vers le bas. Si la
coupe est bonne,il glissera moins.
Et puis, il n’y a pas que la marche. A VTT, la superposition d’une ceinture (ou ceinturon) avec
la ceinture lombo-ventarle du sac à dos crée une gêne . C’est pourquoi Patagonia propose
pour le VTT le Dirt Craft, un pantalon sans passants de ceinture (mais avec une taille
élastquée et une coupe très bien étudiée). A condition que la taille du pantalon soit adaptée
à vos propres mensurations, ce pantalon ne glissera pas .
https://eu.patagonia.com/fr/fr/product/mens-dirt-craft-mountain-bike-pants/23880.html?dwvar_23880_color=SMDB
Sac à dos pour VTT ae;le problème de la pendulation.
Un des problèmes posés par le sac à dos lors d’un pacours vtt est sa tendance à se déporter lors des virages. Cela provoque un déplacement du centre de gravité qui peut perturber dangereusement la trajectoire. Sur un single ,en descente,à grande vitesse,vous risquez de valser dans le décor.(Particulièrement dangereux en montagne sir vous êtes sur une arête avec ravin hyperpentu côté extérieur du virage.)
Chez Evoc, ils ont équipé leur sac d’une ceinture double:premier niveau, contre le ventre: une ceinture large, respirante, élastique qui ferme par auto-agrippant.Par dessus une ceinture classique à boucle.
Franchement,vous auriez envie d’avoir un ceinturon de pantalon en dessous de tout ça ?
https://evocsports.com/products/fr-tour-e-ride-30?srsltid=AfmBOorlyxO2kEkDO2yd_hCa31iXnsWmFWfhjmsIriza6i90PFprx9fY
Les couilles qui pendent génèrent aussi de la « pendulation »
pour les germanistes:
https://evocsports.com/de/products/fr-tour-e-ride-30?srsltid=AfmBOorlyxO2kEkDO2yd_hCa31iXnsWmFWfhjmsIriza6i90PFprx9fY&variant=50951664501000
Vaccins adjuvantés avec de l’oxyhydroxide d’aluminiuminium;aucun problème pour la santé ?
Vraiment ? Tout a été débunké ? Kennedy est un khon ? Vraiment ?
Biopersistence and Brain Translocation of Aluminum Adjuvants of Vaccines
Romain Kroum Gherardi 1,*, Housam Eidi 1, Guillemette Crépeaux 1, François Jerome Authier 1, Josette Cadusseau 1
Author information
Article notes
Copyright and License information
PMCID: PMC4318414 PMID: 25699008
Abstract
Aluminum oxyhydroxide (alum) is a crystalline compound widely used as an immunological adjuvant of vaccines. Concerns linked to the use of alum particles emerged following recognition of their causative role in the so-called macrophagic myofasciitis (MMF) lesion detected in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue/syndrome. MMF revealed an unexpectedly long-lasting biopersistence of alum within immune cells in presumably susceptible individuals, stressing the previous fundamental misconception of its biodisposition. We previously showed that poorly biodegradable aluminum-coated particles injected into muscle are promptly phagocytosed in muscle and the draining lymph nodes, and can disseminate within phagocytic cells throughout the body and slowly accumulate in brain. This strongly suggests that long-term adjuvant biopersistence within phagocytic cells is a prerequisite for slow brain translocation and delayed neurotoxicity. The understanding of basic mechanisms of particle biopersistence and brain translocation represents a major health challenge, since it could help to define susceptibility factors to develop chronic neurotoxic damage. Biopersistence of alum may be linked to its lysosome-destabilizing effect, which is likely due to direct crystal-induced rupture of phagolysosomal membranes. Macrophages that continuously perceive foreign particles in their cytosol will likely reiterate, with variable interindividual efficiency, a dedicated form of autophagy (xenophagy) until they dispose of alien materials. Successful compartmentalization of particles within double membrane autophagosomes and subsequent fusion with repaired and re-acidified lysosomes will expose alum to lysosomal acidic pH, the sole factor that can solubilize alum particles. Brain translocation of alum particles is linked to a Trojan horse mechanism previously described for infectious particles (HIV, HCV), that obeys to CCL2, signaling the major inflammatory monocyte chemoattractant.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4318414/
Un argument à la mords-moi-l’noeud pour prouver que l’oxyhydroxide d’aluminiudans les vaccins est sans danger.
NB Paul Offit,le millionaire vaccinolâtre a été viré par Kennedy.
Can you explain why adjuvants, like aluminum, are in some vaccines?
PAUL A. OFFIT, MD: An adjuvant is something added to a vaccine to enhance
the immune response so that one can give either lesser quantities of the vaccine
or fewer doses of the vaccine. The only adjuvant that we’re currently using in
the United States is aluminum salts.
MARK SAWYER, MD: But what you need to know is that aluminum is in our
environment everywhere in the world: aluminum cans, formula that we feed
babies has aluminum in it; even breast milk has aluminum in it. So the amount of
aluminum that you’re exposed to through vaccines is extremely small compared
to the amount that we face every day in our daily life.
https://vaccinateyourfamily.org/wp-content/uploads/2018/07/FAQ_3-6_AdjuvantsAluminum.pdf
Allez y les gars, cherchez l’alu partout. Ca vous occupera.
Dugong 7 septembre 2025 à 11h07
Allez y les gars, cherchez l’alu partout. Ca vous occupera.
Al Z=13 3ème élément le plus abondant sur Terre après l’oxygène et le silicium! C’est certain que ça recherche va occuper pas mal de monde!
Dans les années 40/50 y’avait des casseroles en alu, dans les années 90 chez moi, elles servaient de gamelles aux chiens, abandonnées au profit de l’inox 10/18 ou 304, du 316L chez Lormier qui n’achète pas une fourchette à moins de 200 boules. Des années de cuissons de pâtes « al dente » les avaient érodées avec de belles criques de corrosion saline. Nous avons, moi et ma fratrie, pendant au moins 25 ans, mangé les spaghettis qui y étaient cuites, et aujourd’hui encore, lorsque lorsque ma mère prépare le sugo, ou les carbonaras et des spaghettis pour 10/12 personnes (150g/pax et 10 fois plus d’eau) elle utilise encore un vieux fait-tout de 20 litres en alu. Personne chez nous n’est autiste ni ne souffre de myofacite à macrophages, mon père ne l’aurait pas toléré. D’après le croasse moi j’aurais plutôt une myofasciste incurable.
Je devine que Lormier possède une solide formation littéraire et qu’il est assez remonté contre les vaccins COVID, à juste titre d’ailleurs. Mais il y a des dizaines de millions d’africains vaccinés avec succès contre la rougeole, la variole, la méningite, la rage, ou la fièvre jaune et ici ces affaires d’autisme ou de myofacite à macrophages (cellules qui mange Macron?)
C’est pourquoi je serais plus nuancé sur le rapport bénéfice/risque des vaccins. Rage, rougeole, fièvre jaune, tétanos y’a rien à leur reprocher. COVID, Shingrix ou GARDASIL, ça peut se discuter entre gens de bonne compagnie.
Ca ressemble beaucoup à des problèmes de blancs qui, pour exister ou occuper une existence vide, postent d’innombrables selfies de leur nombril. Les vaccins comme tous les médicaments, ou substances actives, peuvent, ont, des effets secondaires et/ou indésirables, mortels parfois. Mais il faut avoir vu, au début des années 90, un village de 300/500 âmes en Haute-Volta décimé par la méningite, pas un homme de 16/35 debout, tous sub-claquants. La ceinture méningitidique de Lapeyssonnie ce n’est pas un accessoire de mode de la Paris Fashion Week.
Le diagnostic de la méningite c’est la ponction lombaire, si pas d’infection le liquide (LCR) coule clair comme « de l’eau de roche » cette expression poétique est dans tous les bouquins de médecine. Si infection le liquide prend l’aspect de « l’eau de riz » idem dans tous les bouquins de médecines. Au Burkina vers 92/94 le liquide ne coulait pas, fallait aspirer à la seringue une morve jaunâtre tellement les patients étaient infectés. Aujourd’hui grâce aux vaccins ces horreurs ont presque disparues et y’a plein d’aluminium dans ce vaccin, sous forme d’hydroxyde d’aluminium. Les termes « alum » et « oxyhydroxyde » dans un article qui se veut « scientifique » me laissent rêveur…Mal nommer les choses….
(Cher maestro : en tant que fan – certes quelque peu fanée – j’espère votre retour ici, sous peu ;
« comments are closed » : trois mots abhorrés, véritable opprobre – attention à la prononciation de ce mot, d’un maniement délicat -)
Evidemment c’est du lourd(aud), parce que c’est du belge…
N’empêche que cette belgitude est servie par la RTBF, toujours vivante.
Ici un tel sketch vaudrait renvoi immédiat direction les Kerguelen.
https://www.youtube.com/watch?v=S8Jwe4ygBcg&t=506s
Dugong 7 septembre 2025 à 11h35
Les couilles qui pendent génèrent aussi de la « pendulation »
a) les couilles sont beaucoup moins lourdes qu’un sac à dos
b) sous pantalon le dirt craft on enfile un caleçon protecteur (avec « chamois ») qui maintient les couilles et les empêche de penduler.
(On peut utliser le liner Patagonia qu’on séparera du short dirt craft;si on n’a pas l’intention de se servir d’un short, on peut se procurer un caleçon protecteur d’une autre marque, Fox
par exemple)
https://i0.wp.com/blacksheepadventuresports.com/wp-content/uploads/2022/11/DSCF9596-patagonia-dirt-craft.jpg?resize=1024%2C683&ssl=1
Soulignons par ailleurs qu’au-delà de l’effet physqiue de la pendualtion, il y a son effet psychique. A VTT, on a besoin que le sac soit bien solidare du dos;une bretelle qui glisse sur l’épaule peut déconcentrer le pilote;si cela se passe à un moment délicat, un incident aussi minime suffit à provoquer une chute.
Le sous-short avec chamois de G-form combine utilement la protection de la zone périnéale (« chamois ») et des hanches (« panneaux de G-flex sur les côtés »).
Le G-flex (breveté ) est une matière étonnante:souple au repos, elle durcit en cas d’impact.
Le principe est inspiré du principe de l’érection pénienne:le Gflex est percé d »une myriade de nano-tunnels,remplis d’un mélange gazeux très particulier qui prend un volume considérable ,en cas d’impact, durcissant ainsi la matière.
https://g-form.com/cdn/shop/files/X4_Shorts_Men_Front_1200.png?v=1752517697&width=823
Dugong 7 septembre 2025 à 11h07
Allez y les gars, cherchez l’alu partout. Ca vous occupera.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ils ont déjà trouvé (voir l’article cité en référence).
Ce qu’il faut continuer à faire maintenant, c’est explorer les processus biologiques par lesquels il affecte le fonctionnement de l’organisme.
Lormier the nut, dont l’intérêt pour les nuts est sans équivalent !
Je vous ferais remarquer que celui qui remet sans cesse les « nuts » sur le tapis ,c’est Dugong .
Sans doute le tréponème les a-t-il attaqués aussi.
N’écoutez pas votre écureuil, Nuts aux noisettes c’est très bon !
IAL veut monter une coterie d’aluminothérapeutes. Rien que des allumés de l’alu.
WTH 7 septembre 2025 à 11h46
véritable opprobre – attention à la prononciation de ce mot, d’un maniement délicat -)
Et suuout quand on jtte le bébé,il ne faut pas jeter l’opprobre en même temps.
L’algorithme de Google cache ce type d’information en dixième psition…n’em^che qu’on peut la trouver.
Un memorandum issu de BIO (Biotechnology Innovation Organization (BIO)) -organsation mafieuse vendeurs de « vaccins » a fuité.
On y apprend l’existence d’un complot, financé à hauteur de deux millions de dollars, pour faire démissionner Kennedy.
On peut y lire
“It is time to go to The Hill and lobby that it is time for RFK Jr. to go.”
et en effet ,
The threat to the cartel is clear. Kennedy has insisted on long-term safety data for vaccines, full publication of trial results, and the restoration of manufacturer liability for injuries. These proposals would dramatically slow down the fast-track approvals and legal protections that have allowed vaccine makers to rake in billions while avoiding accountability. In the eyes of BIO, this is not just policy reform – it is a direct attack on its business model.
méthode:la psy-op
Buying Influence
The most revealing part of the plan is financial. BIO has committed $2 million to a new communications campaign titled ‘Why We Vaccinate.’ But this is no ordinary public health initiative. According to the memo, its goal is not education but “inspire and frighten” messaging designed to sway the “movable middle” of public opinion. Essentially, by tying vaccination to national security, economic productivity, and workforce resilience, the campaign seeks to use fear as a political weapon.
This is not science. It is psychology. Instead of engaging Kennedy’s arguments on their merits, BIO plans to drown out discussion with a flood of fear-based advertising and carefully managed surrogates. Among those mentioned as possible allies are Dr. Mehmet Oz and Senator Bill Cassidy. These figures are expected to provide a veneer of bipartisan legitimacy while avoiding any real debate about the substance of Kennedy’s proposals.
Comme Lormier l’a déjà noté,il n’est pas nécessaire d’arroser la grosse khonnasse d’Elizabeth Warren: elle est tellment idiote qu’elle croit à ce qu’elle raconte;
https://www.globalresearch.ca/pharma-coup-attempt-cartel-insiders-plotting-oust-robert-f-kennedy-jr/5899659
Paul et Vanessa : Fin de la fiction.
-Oui, cela fut très long et douloureux, il m’a fallu gagner la complicité de Louise, la gouvernante, afin qu’elle s’abandonne à quelques confidences.
-Et ?
-Eh bien, c’est pire que ce que je soupçonnais.
Louise, qui connaît sa patronne depuis plus de dix ans, est catégorique :
« Virginie est devenue une femme méprisable, dure, inhumaine, matérialiste, incapable de la mondre affection, du moindre attachement pour quelqu’un. Quant à sa fille, c’est une psychopathe . »
Et effectivement, ces derniers temps, Virginie me parlait de façon de pus en plus autoritaire. Depuis que j’avais sympathisé avec Louise, elle m’avait relégué au rang de domestique.
Jamais je n’aurais imaginé un tel changement de comportement .
La jeune et jolie fille fragile et émouvante qui m’avait déposé un déchirant mot d’amour sous la selle de ma moto il y a quarante ans, était devenue une femme distante, méprisante à mon égard.
Quel naufrage et quelle désillusion !
» Souviens-toi d’oublier »
Je vais relire Nietzsche, et dorénavant, suivre ses conseils. Je sais maintenant que l’oubli est une condition sine qua non du bonheur.
En m’ordonnant d’aller rejoindre cette femme, tu m’as infligé, Sylvie, un châtiment cruel…
Mais tu m’auras aussi permis d’avoir de nouveaux yeux.
J’ai modifié les deux derniers chapitres, la fin précédente ne me plaisait pas.
La version définitive (avant envoi du manuscrit à l’editeur) est ici :
https://fictionpauletvanessa.blogspot.com/
Merci d’en offrir la primeur au commentariat.
C’est un peu votre fiction.
Sans les commentaires assidus, encourageants et parfois enflammés de Lormier, je n’aurais rien écrit.
Correction
…et ici ces affaires d’autisme ou de myofacite à macrophages (cellules qui mange Macron?) n’existent tout simplement pas.
IAL, alumeinate de sots idiomes.
De nuts, aux noisettes – hazelnuts, peut-être épargnées par la loi Duplomb – puis aux cahouètes salés – peanuts… !
Le nombre total de bateaux devant dépasser les cinquante , JG aurait réussi à embarquer (depuis la Croatie et malgré le veto de Rima) . Et comme il est interdit de quitter les bateaux, Lormier va devoir se passer de son partenaire pendant quinze jours au moins.
Oui…
« Aujourd’hui grâce aux vaccins ces horreurs ont presque disparu et y’a plein d’aluminium dans ce vaccin, sous forme d’hydroxyde d’aluminium. »
Si je ne me trompe pas, le vaccin dont vous parlez dans cette phrase, c’est celui contre la méningite. Et les autres ? Sont-ils adjuvantés ? Avec quoi ?
A l’époque du H5 N1, je me souviens d’avoir entendu une biologiste à la télé dire que l’adjuvant du vaccin alors proposé était loin d’être anodin.
Il y a bien vaccin et vaccin;ne mélangeons pas tout; je suis vacciné contre le tétanos et je fais mes rappels; j’ai été vacciné contre la poliomiélyte (mais avec l’ancien vaccin.)
Si j’ai donné la référence de cet article (non rétracté) c’était pour opposer un contre-argument à à ceux qui affirment:aucun lien entre vaccination et autisme, c’est démontré.
—————————————————————————————————-
Les termes « alum » et « oxyhydroxyde » dans un article qui se veut « scientifique » me laissent rêveur…
« alum », qui est entre parenthèses, pourrait bien être le nom communément donné à cette substance (le nom pas scientifique, un peu comme « esprit de sel pour « acide chlorhydrique »)
Quant à « oxyhydroxyde » cela m’a tout l’air d’être le terme anglais qu’utilisent les chimistes;il peut y avoir de légères différnce d’une langue à l’autre
quitter les bateaux
Biter les Cathos
Aujourd’hui un virus de la poliomélyte circule:c’est celui du vaccin oral contre la poliomélyte.
« Vaccine-derived poliovirus is a well-documented strain of poliovirus mutated from the strain originally contained in OPV. OPV contains a live, weakened form of poliovirus that replicates in the intestine … »
OPV:oral poliomelytis virus.
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON571#:~:text=Vaccine%2Dderived%20poliovirus%20is%20a,immunity%20by%20building%20up%20antibodies.
Un lointain lecteur 7 septembre 2025 à 15h35
Si infection le liquide prend l’aspect de « l’eau de riz »
Les argumnts des anti-complotistes ont cette coloration. J’avais dit « eau de cuisson des pâtes » « Eau de riz » est meilleur.
D’où l’usage fréquent d’un « safe word » …
fréquent…donc il n’y en a pas toujours. (Chez les mauviettes, si.)
Le Lointain :
« il y a des dizaines de millions d’africains vaccinés avec succès contre la rougeole, la variole, la méningite, la rage, ou la fièvre jaune » –
Ben oui, ici aussi, comme ailleurs !
Sauf que le vax anti-covid :
– le 1er vax… à arn-m
– avec protéine spike
– en phase 3 : « Cette étape permet d’étudier les détails de la réponse immunitaire, de préciser les schémas d’administration (nombre de doses, etc.), et d’identifier les effets secondaires fréquents. Les essais de Phase III incluent plusieurs dizaines voire centaines de milliers de volontaires »
la planète entière c’est encore mieux !
Alors « les petits problèmes de blancs »…
« les petits problèmes de blancs » : le premier, celui d’une précarité galopante – Europe occidentale, par exemple…
On peut évidemment avoir une vision différente, si l’on vit par exemple sur le continent africain, ou ici du côté des nantis.
Le lointain lecteur n’est pas un partisan enthousiaste des « vaccins » anti-covid à ARN m.
Mais là, on parlait des adjuvants présents dans les autres.
L’âge auquel les enfants sont vaccinés,le nombre de vaccins, le délai entre les injections…tout cela doit jouer.
De toute façon, l’augmentation énorme du pourcentage d’enfants atteints d’autisme est un problème de santé publique aux Etats Unis.
On n’a toujours pas trouvé la cause.
Un lointain lecteur 7 septembre 2025 à 15h35
Dans les années 40/50 y’avait des casseroles en alu… Des années de cuissons de pâtes « al dente » les avaient érodées avec de belles criques de corrosion saline. Nous avons, moi et ma fratrie, pendant au moins 25 ans, mangé les spaghettis qui y étaient cuites, et aujourd’hui encore, lorsque lorsque ma mère prépare le sugo, ou les carbonaras et des spaghettis pour 10/12 personnes (150g/pax et 10 fois plus d’eau) elle utilise encore un vieux fait-tout de 20 litres en alu. Personne chez nous n’est autiste ni ne souffre de myofacite à macrophages, mon père ne l’aurait pas toléré.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
C’est peut-être naïf ou erroné de ma part mais je ne crois pas que l’ingestion de très faibles quantité d’aluminium provenant de casseroles ait le même effet que l’injection dans un muscle d’hydroxyde d’aluminium.
Je le répète (l’ayant lu sous la plume de médecins-chercheurs) l’injection de vaccins adjuvantés à l’hydroxyde d’aluminium peut poser problème si elle est faite à des nourrissons, si elle est répétée de nombruses fois à brefs intervalles.
En tout cas, ce sont des paramètres à prendre en compte.
De même,il faut prendre en compte les résultats d’analyses qui ont montré qu’on retrouve parfois dans le cerveau des particules d’hydroxyde d’aluminium.
Qu’on me prouve que c’est inoffensif mais qu’on ne nie pas cette donnée.
Bayroudoudou, faux paysan, aime s’exhiber au volant du tracteur restauré de son père
https://www.lejdd.fr/lmnr/f/webp/rcrop/960,640,FFFFFF,forcey,center-middle/img/var/jdd/public/styles/paysage/public/media/image/2024/12/15/12/bayrou-tracteur-c-alain-jocard-afp.jpg
Envisage-t-il une restauration pour son trône de roi du Béarn ?
Ca risque de gaver.
hydroxyde d’aluminium:du pain sur la planche
Résumé
L’oxyhydroxyde d’aluminium (Alhydrogel®) introduit dans les vaccins en 1926 pour son effet adjuvant immunologique est un composé nanocristallin formant des agrégats. Il est l’adjuvant le plus couramment utilisé dans les vaccins humains et vétérinaires, mais les mécanismes par lesquels il stimule les réponses immunitaires restent mal définis. Bien que généralement bien toléré sur le court terme, il a été soupçonné de parfois provoquer des problèmes neurologiques, sur le long terme, chez des individus sensibles. Les préoccupations de sécurité dépendant en grande partie de la longue bio-persistance inhérente à cet adjuvant, qui peut être liée à son retrait rapide du liquide interstitiel par une sévère absorption cellulaire ; et la capacité des particules d’adjuvant à migrer et à s’accumuler lentement dans les organes lymphoïdes et le cerveau, phénomène documenté dans des modèles animaux et résultant d’une translocation dépendante de MCP1/CCL2 des monocytes chargés en adjuvant (phénomène du cheval de Troie). Ces éléments indiquent que les modalités d’analyse de la pharmacocinétique et de la sécurité des adjuvants aluminiques doivent être complètement réévaluées.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1286011516000254
NB
i) On constate que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi
ii) Il serait temps d’étudier de plus près ce qui se passe quand on injecte ce genre de produit…surtout quand on répète l’opération 953 fois dans les 6 prmières années de la vie.
« On constate que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi »
En babiologie, c’est plutôt la norme. Mais est ce si grave pour eux ?
Effets de l’hydroxide d’aluminium sur le cerveau;étude in vitro sur des cellules souches
Abstract
Aluminum (Al) has been classified as a cumulative environmental pollutant that endangers human health. There is increasing evidence to suggest the toxic effects of Al, but the specific action on human brain development remains unclear. Al hydroxide (Al(OH)3), the most common vaccine adjuvant, is the major source of Al and poses risks to the environment and early childhood neurodevelopment. In this study, we explored the neurotoxic effect of 5 μg/ml or 25 μg/ml Al(OH)3 for six days on neurogenesis by utilizing human cerebral organoids from human embryonic stem cells (hESCs). We found that early Al(OH)3 exposure in organoids caused a reduction in the size, deficits in basal neural progenitor cell (NPC) proliferation, and premature neuron differentiation in a time and dose-dependent manner. Transcriptomes analysis revealed a markedly altered Hippo-YAP1 signaling pathway in Al(OH)3 exposed cerebral organoid, uncovering a novel mechanism for Al(OH)3-induced detrimental to neurogenesis during human cortical development. We further identified that Al(OH)3 exposure at day 90 mainly decreased the production of outer radial glia-like cells(oRGs) but promoted NPC toward astrocyte differentiation. Taken together, we established a tractable experimental model to facilitate a better understanding of the impact and mechanism of Al(OH)3 exposure on human brain development.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651323003676
Le seul nom admissible pour le produit formé d’ions Al3+ et d’ions hydroxyde OH- est celui de l’Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA): hydroxyde d’aluminium. Ce produit est insoluble dans l’eau
C’est bien le nom qui apparaît dans l’extrait ci-dessus.
Evidemment, les babiologistes dont les connaissances en chimie sont plutôt ancrées dans un passé révolu sont plutôt des protochimistes…
Dugong 8 septembre 2025 à 7h26
Bayroudoudou, faux paysan, aime s’exhiber au volant du tracteur restauré de son père
Quant à Dugong,il se souvient avec émotion du temps où son oncle le viticulteur lui avait permis de piloter seul son tracteur; il avait 13 ans. Un Massey-Ferguson ?
Yes !
Conséquences directes du plan Marshall, par ex, Mac Cormick s’était établi en France (usine à Saint Dizier dans l’est…)
Ceintures, ceinturons, le cas de l’escalade.
Lormier a epliqué plus haut pourquoi les VTTistes se passent très bien de ceinture.
sur-épaisseurs (ceinture à boucle+baudrier)
Les alpinistes et les grimpeurs n’aiment pas non plus les sur-épaisseurs (ceinture à boucle+baudrier).
NOGRAD est une ceinture,certes, mais sans boucle;elle a été conçue pour réduire lasur-épaisseur.
https://nograd.fr/passion/
ceinture AEROBELT de NOGRAD:
https://nograd.fr/wp-content/uploads/2021/02/aerobelt-full-black-600×800.jpg
Quand Dugong,heureux et innocent encore,chantait: »J’ai besoin d’personne sur mon Massey-Ferguson:
https://www.youtube.com/watch?v=xzhtfFfuL84
Maltraitance animale (suite)
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/gard-le-spectateur-d-une-fete-votive-meurt-renverse-par-un-cheval-un-taureau-puis-heurte-par-une-voiture-20250907
On ignore si la voiture s’est débattue.
Il était à bicyclette.te, et heureusement sans Paulette.te.
Les commentaires sont fermés.