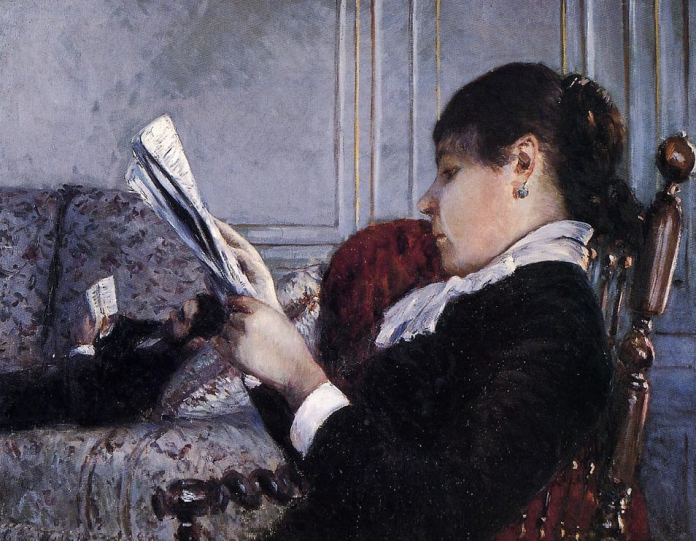
C’était dans des premières années d’enseignement. J’avais bûché, pour entrer à l’ENS Saint-Cloud, le double recueil de Jean Rousset, Anthologie de la poésie baroque, où figurait le poème de Marbeuf évoqué ci-dessous. Et j’eus l’idée d’en faire profiter mes collégiens du Neubourg, où j’avais été nommé en première affectation en 1976. Histoire aussi de leur expliquer les règles du sonnet — et l’esthétique baroque. À l’époque, nous n’avions pas de centres pédagogiques de formation pour nous expliquer que la culture, c’est mal — sans compter que c’est blanc, et probablement néo-colonialiste.
Mes petits Neubourgeois n’en sont pas revenus. Ce que ces élèves de Troisième voyaient remonter du tableau, et dans un second temps de leurs feuilles de brouillon, tenait de la magie noire. Une combinaison de lettres, apparemment distribuées au petit bonheur sur la page, donnait littéralement le sens du poème. Ou si vous préférez, l’articulation sonore du texte, par mimétisme phonétique, suffisait pour induire le sens.
D’où la nécessité de faire lire à voix haute — ce que l’on a cessé de faire depuis que le petit Delogu a fourni aux pédagogues un nouveau standard de l’élève moyen, et un souci nouveau : ne pas humilier l’élève.
Voici l’objet du délire :
Et la mer et l’amour ont l’amer pour partage,
Et la mer est amère, et l’amour est amer,
L’on s’abîme en l’amour aussi bien qu’en la mer,
Car la mer et l’amour ne sont point sans orage.
Celui qui craint les eaux, qu’il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu’on souffre pour aimer,
Qu’il ne se laisse pas à l’amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.
La mère de l’amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l’amour, sa mère sort de l’eau,
Mais l’eau contre ce feu ne peut fournir des armes.
Si l’eau pouvait éteindre un brasier amoureux,
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,
Que j’eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.
Pierre de Marbeuf (1595-1645), Recueil de vers, 1628
Nous sommes partis du premier vers : « Et la mer et l’amour ont l’amer pour partage… » « Regardez bien les lèvres de votre voisin lorsqu’il articule ce fragment. Vous voyez les lèvres qui se joignent et se disjoignent dans l’articulation de « m » — oui, Maryse, « m », c’est « aime », bien vu. Pas un hasard, c’est un poème d’amour. Pas un hasard si les phonéticiens disent que le « m » est une consonne « occlusive » — oui, c’est la même racine que « clore »…
Quant à savoir quelles lèvres s’ouvrent et se closent dans l’amour…
Alors, nous sommes partis à la chasse aux « m », tout au fil du texte. Puis j’ai posé la question : « Y a-t-il d’autres consonnes que l’on retrouve en grande abondance ? » Leur faire constater la sur-représentation de « l » et des « r » ne fut pas bien difficile. Pour les « r », il m’a fallu expliquer qu’en ce début du XVIIe siècle, et en Normandie, le « r » final des verbes infinitifs du premier groupe se prononçait. Et dans un sonnet régulier, on disait « aimere » et « enflammere ». D’ailleurs, très longtemps, à partir du « amare » latin, on a dit « amer » en français – d’où le participe présent substantivé « amant », aux XIIe-XIIIe…
« Amant »… Un je ne sais quoi de languide est remonté à la surface de certaines prunelles.
L / r / m, donc — oui, dans cet ordre, parce que c’est celui qui rend plus aisée la diction de ces trois consonnes. Essayez de prononcer r/m/l…
« Et des voyelles ? Quelle est la voyelle la plus fréquente ? » Parce qu’enfin, c’est comme en hébreu et nombre de langues primitives : des consonnes, il faut bien les vocaliser pour les prononcer…
Là encore, l’étude du premier vers incitait à déclarer que le « a » était fort abondant, alors qu’en français, c’est de très loin le « e » qui domine. Ah ah, cela serait-il fait exprès ? Ces « a » ont-ils du sens ? »
« Ah… » a gémi la même enfant fûtée. C’était si bien mimée qu’un parfum d’orgasme a envahi la classe, qui s’est mise à rire et à articuler des « ahhh » de plus en plus amoureux. Ce fut un beau gang-bang phonétique, pendant quelques instants.
« Fort bien. Et si nous insérons ce « a » dans notre combinaison l / r / m ? »
C’est un exercice qui s’apparente un peu au scrabble. Et on arrive forcément très vite à « larm(e) » — parce que ralm, marl, et autres arml, ça ne marche pas.
« M’sieur ! M’sieur ! C’est le dernier mot du poème… »
« Eh oui, Véronique, bien vu ! Tout le poème vise à produire le dernier mot — de sorte que lorsqu’on arrive à « larmes », on l’a déjà en tête, sans s’en apercevoir… Et la destinataire du poème aussi. La communication, vous savez, cela consiste à faire croire ce que l’on veut à l’interlocuteur. Et ça passe moins par les mots que par la diction, les mimiques, le regard, et autres merveilles non verbales.
Bien sûr, quand nous eûmes achevé de décortiquer ce petit bijou de poème, ce ne fut qu’un cri : « Mais M’sieur, vous êtes sûr qu’il l’a fait exprès ? » Mais comme le fit remarquer tout de suite une gamine plus fûtée que les autres : « Et Van Gogh, quand il met un peu de jaune, il le fait exprès ? »
Oui, un écrivain le fait exprès. Il pèse chaque mot, chaque syllabe. Il parle son texte en écrivant, en éprouve la chair et la substance, en exprime le jus.
(Oui, ce furent essentiellement les filles qui menèrent la classe ce jour-là — comme tous les jours : à 15 ou 16 ans, elles ont deux ans d’avance sur ces grands niais de garçons.)
J’ai réitéré l’opération quelques années plus tard, au lycée de Corbeil-essonnes, mère de toutes les ZEP. Premier cours de l’année avec une classe bourrée de redoublants dont on m’avait vanté la turbulence — ils avaient eu la peau de leur prof de Français l’année précédente, qui s’était pourtant ingéniée à leur faire étudier des textes de Libé sur la banlieue —, et j’ai commencé par le sonnet de Mallarmé bien connu :
« Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d’aile ivre
Ce lac dur oublié que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n’ont pas fui !
Un cygne d’autrefois se souvient que c’est lui
Magnifique mais qui sans espoir se délivre
Pour n’avoir pas chanté la région où vivre
Quand du stérile hiver a resplendi l’ennui.
Tout son col secouera cette blanche agonie
Par l’espace infligée à l’oiseau qui le nie,
Mais non l’horreur du sol où le plumage est pris.
Fantôme qu’à ce lieu son pur éclat assigne,
Il s’immobilise au songe froid de mépris
Que vêt parmi l’exil inutile le Cygne. »
Passons sur les étapes intermédiaires, que le lecteur recomposera sans difficulté. Les consonnes les plus fréquentes sont l / v / r, vocalisées en « i » — ce qui nous amène au mot caché qu’est « livre » : ou comment un texte ne parle au fond que de texte. Du coup, le cygne qui passe dans ces quatorze vers n’est-il pas celui qui, symboliquement, fournit la plume avec laquelle on écrit ? Et ce bassin glacé des Tyileries ne serait-il pas la page blanche sur laquelle le poète pose des cygnes… pardon : des signes ?
Et l’on imagine très bien les lèvres de Mallarmé fredonner ces fricatives labio-dentales sonores (je parle du « v », bien sûr) avec le demi-sourire de celui qui joue un bon tour au lecteur.
J’ai raconté dans l’un ou l’autre de mes essais sur l’Ecole que quelques mois plus tard, l’un de ces chenapans, ayant appris par un cousin qu’au lycée Henri-IV ils avaient étudié le même poème, le déclara publiquement, ce qui fit ressentir à ces voyous organisateurs de combats de chiens et autres facéties un orgueil démesuré. Comment ! Ils étaient la lie de la France, et ils avaient étudié le même poème hermétique que les bourgeois du Ve arrondissement !
J’ai déjà expliqué qu’on ne risque rien à initier des hilotes aux subtilités de la langue et de la littératures françaises. Mais je voudrais insister sur cet aspect purement musculaire, dans la prononciation et l’élocution. « C’est ce qui fait, expliquai-je ce jour—là, que si vous dites avec gentillesse et onctuosité à votre pitbull « espèce de petit enculé, je vais t’exploser ta race, si tu ne gagnes pas ce combat », il viendra vous lécher les mains. Si vous le hurlez, en revanche, c’est vous qu’il mangera. »
Et chaque phrase de ce qui précède a été testée sur le bout de la langue avant de passer à l’écrit.
Jean-Paul Brighelli
(1) J’emprunte ce titre à un livre précieux au titre identique d’André Spire (1868-1966), poète et essayiste, paru en 1949 — et réédité en 1986. Il a bercé mon enfance, et le peu que je connais de la prose française me vient de lui.




Il y a « ah » et « ah » . On observe que dans les deux aux-khul-rances ci-dessous « ah » exprime quelque chose qui est du registre de la satisfaction.
Encore que…(comme disait Culioli).
« Ah… » a gémi la même enfant fûtée. C’était si bien mimée qu’un parfum d’orgasme a envahi la classe, qui s’est mise à rire et à articuler des « ahhh » de plus en plus amoureux. Ce fut un beau gang-bang phonétique, pendant quelques instants. »
« Le temps de lui éjaculer dans la bouche, ce qu’elle a accueilli, après avoir avalé d’un seul coup de glotte le sperme qu’elle avait suscité, avec un « ah ! » de satisfaction. »
Intéressant rapprochement par Lormier de ces deux « ah! », le premier produit par une élève et le deuxième par une « esclave » de jeu sexuel.
Mais….quelqu’un n’a-t-il pas récemment, dans une analyse textuelle peut-être parodique, rapproché le rapport Maître/Esclave du rapport Maître/Élève ?
Je crois bien que si. 🙂
exploser ta race ou déchirer ta race ?
(Oui, ce furent essentiellement les filles qui menèrent la classe ce jour-là — comme tous les jours : à 15 ou 16 ans, elles ont deux ans d’avance sur ces grands niais de garçons.)
Vous imaginez ce qu’eût été votre vie si vous aviez été relégué chez les mâles (établissement genre Prytanée militaire de la Flèche ?)
Le Prophète Mao mais. a plusieurs fois avancé l’hypothèse d’une bi-sexualité cryptée (ou inavouée) chez Brighelli. Au Prytanée militaire de La Flèche, on peut donc tout imaginer sur les postures brighelliennes.
Brighelli va bien nous sortir un jour ou l’autre un texte à ce sujet, où nous aurons pour mission de repérer les indices qui ancrent le texte dans le domaine du réel, ou dans le domaine de la fiction…